Victor GUENEAU Mémoires de la Société
académique du Nivernais – 1927
Justement, sur le boulevard Pierre de Coubertin, face à
la station service Esso, l'imposante Tour Saint-Eloi (aperçue
dans le reportage INA) assiste impassible depuis 1422, à
la mutation inexorable de son quartier.

La Tour St Eloi, seul repère immuable depuis 1422. Image
réactive.
Vue identique aujourd'hui et au temps du quartier insalubre des
Pâtis au début du siècle dernier.
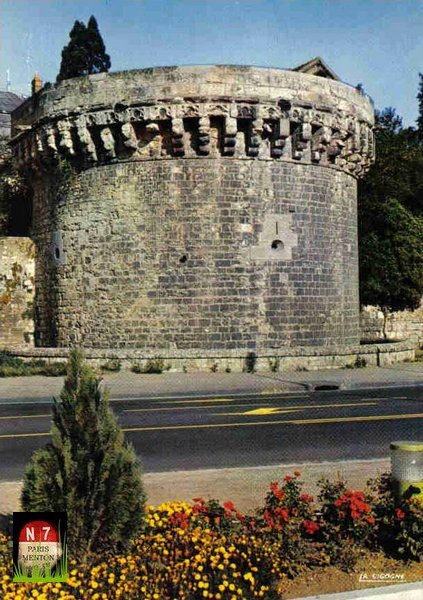
La Tour St Eloi et la RN7 avec la signalisation jaune.

Autrefois, la rivière Nièvre passait au pied de la
tour délimitant avec les fortifications, les frontières
de la ville.
Dès 1194, des remparts sont érigés autour de
Nevers. Ils seront renforcés par l'adjonction de tours et
de portes fortifiées lors de la Guerre de Cent Ans.
Dans le courant du XVIe siècle, les remparts perdront leur
utilité défensive et serviront de carrière
de pierres.
La Tour Saint-Eloi est un vestige de ces fortifications, bâtie
en 1422, elle est couronnée de mâchicoulis tréflés.

Ancienne station service quai de Mantoue, mais aussi ancienne
permanence politique dont le logo, la rose, est encore visible sur
le fronton.
Photo Jf Lobreau
En route -
Bientôt les quais. La Loire apparaît sur la gauche,
ainsi que le Pont de Loire.
C'est ici que se rejoignent les trois tracés qui traversent
la ville par le centre, l'est (D907) et l'ouest (D907Bis) 

Mais avant de franchir la Loire, partons maintenant sur la piste
du tracé originel, au temps où il n'était pas
encore question d'éviter le cœur de la ville.
Retour sur le parcours originel, celui d'avant 1968. 
A la jonction des trois tracés, prenons cette fois-ci tout
droit par l'avenue Colbert, anciennement RN7 et Rue de Paris.

Avenue Colbert, un garage pour Poids Lourds
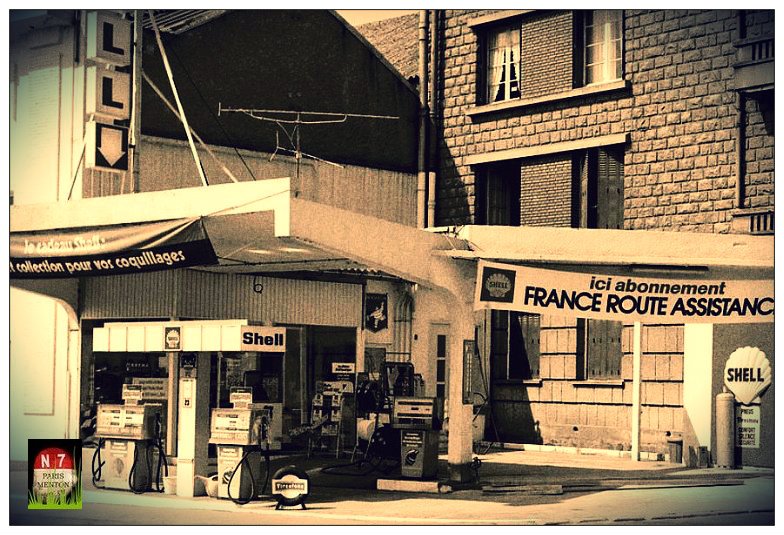
Une station Shell, au pied d'un immeuble, en plein centre-ville.
Impensable aujourd'hui. Image réactive.
A la bifurcation avec la rue Paul Vaillant-Couturier,
nous sommes dans l'ancien "Faubourg de la Chaussée",
une ancienne zone maraîchère.
Lors des épidémies de pestes qui durèrent près
de 50 ans à Nevers, c'est dans ce quartier que les pestiférés
étaient envoyés, hors de la ville fortifiée.
Le tracé de la route de Paris n'était apparemment
pas encore totalement fixé.
En 1606 la route venant de Pougues, traversait le "Faubourg
de la Chaussée" par la Rue de la Chaussée (ex
Félix Faure actuelle Paul Vaillant-Couturier) et non par
la rue de Paris.
Plus tard, lors de la mise en sens unique des ruelles du centre-ville
dans le sens des retours, les vacanciers réemprunterons cette
route sur leur trajet aller. Nous y reviendrons.

Tout droit la rue de Paris. Image réactive.
A droite l'ancienne rue de la Chaussée devenue Rue Félix
Faure aujourd'hui rue Paul Vaillant Couturier.
Au centre, la croix des pèlerins. Photo actu Claude.K
Un petit calvaire posté à l'intersection
des deux rues depuis 1678, atteste du passage du chemin de Compostelle
à Nevers. Nous sommes place des Pèlerins. 
En 1678, à la suite d'une mission prêchée
par 20 capucins, une croix fut placée sur la route de Paris,
en face de l'hôpital récemment construit.
Située dans un quartier mal famé, elle fut transférée
en 1785, à la demi-lune, en face de la rue Bovet, «
attendu que dans l'emplacement actuel, soit à cause des casernes,
soit par rapport aux cabarets, il s'y commet presque journellement
des indécences ».
Les croix de la ville disparurent pendant la Révolution,
celle de la rue de Paris fut rétablie en 1804 aux frais des
descendants des confrères de Saint Jacques,
ce qui lui valut le transfert du nom de Croix des Pèlerins.
Elle fut refaite en fer en 1848. Le Christ en faïence qui figurait
sur la précédente fut vendu à l'antiquaire
Barat en 1864.
La place des Pèlerins, appelée, en 1877, Square de
la rue de Paris, dut, à cette époque, être plantée
d'arbres et recevoir la croix.
Source : https://www.gennievre.net/wiki/index.php
En route -
Continuons la remontée de l'avenue Colbert
(ancienne rue de Paris).
Sur la gauche, le quartier de l'ancien hôpital
de Nevers fait peau neuve. Les promoteurs immobiliers sont à
l’œuvre.
En 1665, un hôpital fondé par lettres
patentes du roi est construit, hors des murs de la ville.
Il remplace l'hôtel Dieu qui se situait à l'origine
dans l'enceinte de la ville fortifiée.
Le nouvel hôpital possède une chapelle dédiée
à Notre-Dame de la Pitié et les bâtiments hospitaliers
forment un large ensemble architectural massé en U.
Les travaux de construction s'étaleront du
XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle.
En 2003 le site ferme définitivement ses portes remplacé
par le nouveau centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers,
l'hôpital Pierre Bérégovoy.
La chapelle aujourd'hui désacralisée, les bâtiments
disposés en U et les pavillons d'entrées sont conservés,
car classés à l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques
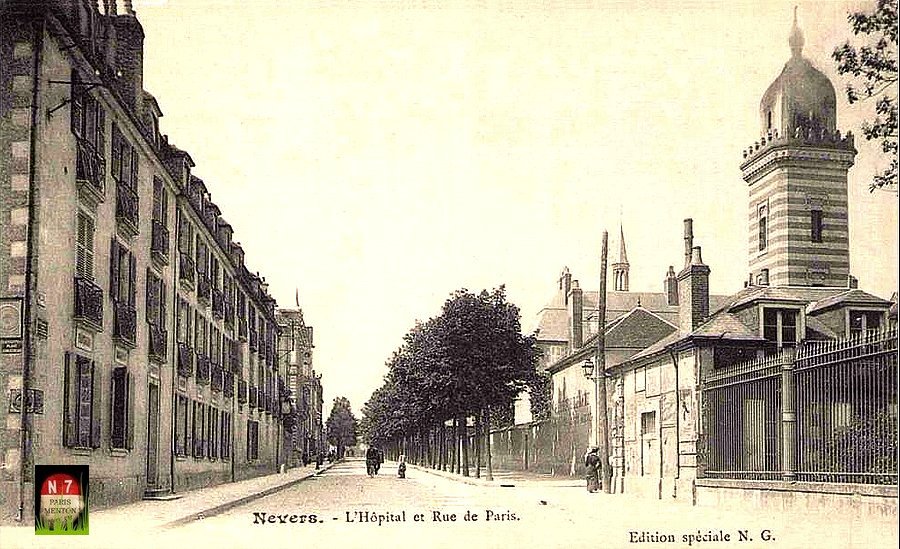
Une vue de la rue de Paris en direction de Pougues les Eaux.
A droite l'ancien hôpital.
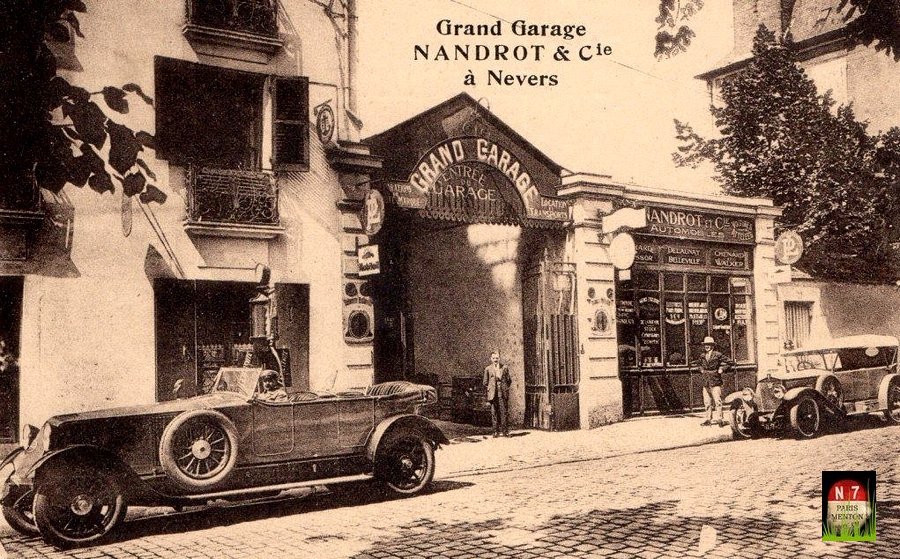
Au 4 de la rue de Paris, aujourd'hui rue Colbert, face à
l'hôpital,
le grand Garage Nandrot, agent Panhard et Levasseur, Delaunay-Belleville,
Chenard et Walker. Image réactive.
Au bout de l'avenue, à l'angle du Square de la Résistance,
on trouvait jadis l'Hôtel de France, un établissement
prestigieux et renommé sur la nationale 7.
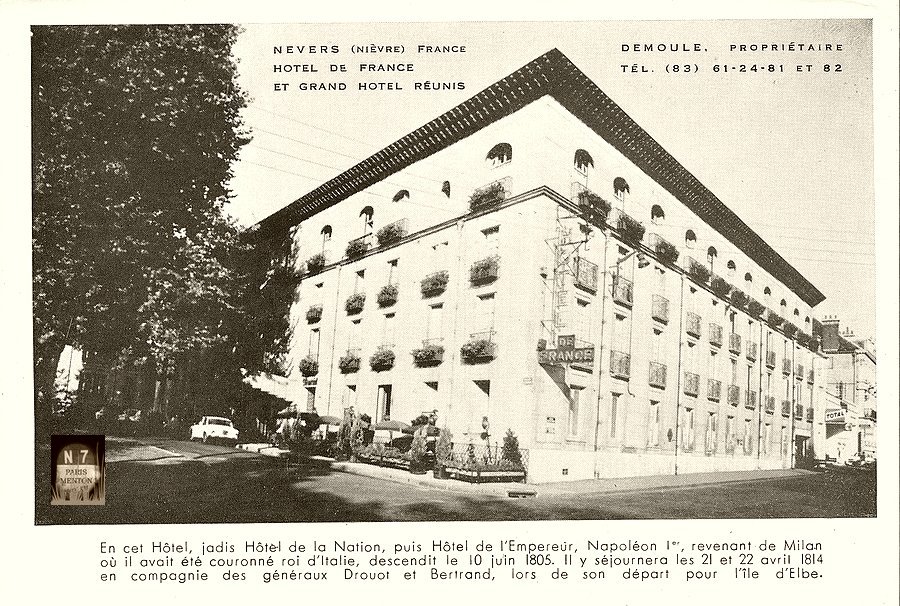
Face à l'hôpital, L'hôtel de France. (Remarquez
la station Total en lieu et place du garage Nandrot). Image réactive.
|
|
Ce n'était jadis qu'un
petit pavillon carré où il y avait une guinguette
pour les sous-officiers du Royal-Piémont.
La guinguette alla toujours en croissant et devint, pendant
la Révolution, l'Hôtel de la Nation.
Le ministre de la police Fouché y logea en 1793 et
sa femme y accoucha d'une fille.
En 1805, après le passage à Nevers de Napoléon
qui revenait de se faire sacrer roi d'Italie, l'établissement
prit le nom d' "Hôtel de l'Empereur".
Se rendant à l'île d'Elbe, Napoléon y
descendit également le 21 avril 1814 et en repartit
le lendemain 22, à six heures du matin.
A la Restauration, l'établissement devint l'Hôtel
de France.
Derrière le bâtiment principal se tenaient les
écuries qui pouvaient contenir 150 chevaux.
Le 18 février 1846, l'ambassadeur du Maroc s'y arrêta
quelques heures avec sa suite.
La façade changea d’aspect dans les années
1930 et l'hôtel de France s'accola au grand Hôtel.
Le Grand Hall, salon agencé dans les années
1926, était un lieu de rencontres internationales :
Joliot-Curie en 1949, Mistinguett en 1950, Maurice Chevalier
en 1952, François Mitterrand ou encore le chanteur
Jacques Brel en appréciaient l'élégance.
Carte Postale Hôtel de France et Route Bleue. |
Dans le prolongement de l'avenue Colbert, vous ne pourrez la manquer,
voici la Porte de Paris. 
Récemment rénovée (mai 2019), 273 ans après
sa construction la porte a retrouvé sa "paleur"
et son éclat d'antan.
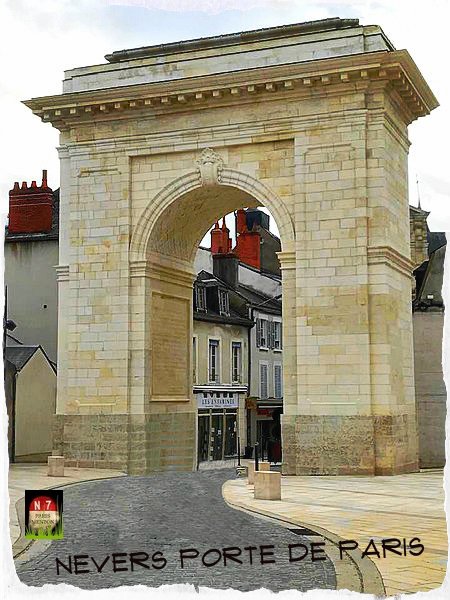
Mais est-ce une porte ou un arc de triomphe ?
Et bien les deux mon capitaine !!
A l'origine c'est l'une des 7 portes que comporte l'enceinte de
la ville élevée par Pierre de Courtenay (1194).
La porte des Ardilliers - déformation de artilliers, car
des tirs à l'arquebuse se déroulaient dans les fossés
tout proches - est reconstruite en 1434 par les gens de Varrennes-les-Nevers,
qui en en ont la charge et l'entretien.
En 1734 le duc Mazarin-Mancini permet la démolition de
plusieurs portes de la ville à condition que ses armes figurent
sur les nouveaux ouvrages bâtis.
La ville de Nevers décide de remplacer la porte médiévale
des Ardilliers et construit à ses frais de 1742 à
1746 un nouvel édifice plus au goût du jour : la Porte
de Paris.
Ce n'est plus une porte mais un Arc de triomphe de style antique,
La Porte de Paris célèbre la victoire de Louis XV
à Fontenoy en 1745.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_Paris_(Nevers)
Source : guide pittoresque dans la Nièvre 1854.
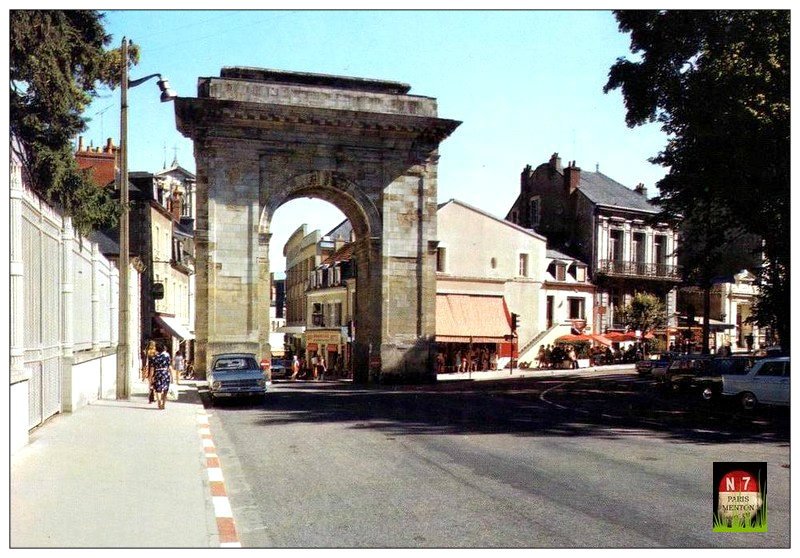
La nationale 7 passe en sens unique sous la porte de Paris.
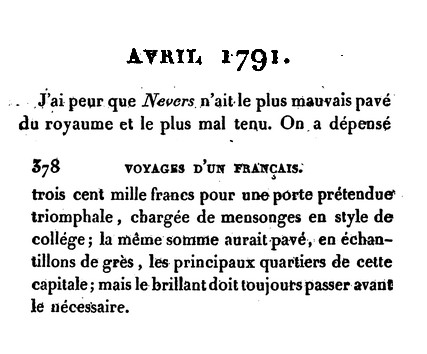
Un propos toujours d'actualité quelque soit la municipalité.
Attention , la porte est à sens unique dans
la direction Sud - Nord, depuis le milieu des années 60,
de plus le secteur des ruelles est aujourd'hui entièrement
piétonnier.
Pour passer sous l'antique porte, il faudra donc laisser la voiture
et s'aventurer à pied dans le centre.
Compter 500 mètres tout au plus pour traverser la ville jusqu'à
la Loire, en suivant les traces de la RN7..
Passons sous la porte et pénétrons dans
l'enceinte de la ville fortifiée.
L'étroitesse de la rue des Ardilliers surprend, et pourtant
les véhicules de milliers de vacanciers sont bien passés
par ici (depuis 1965 uniquement dans le sens des retours)
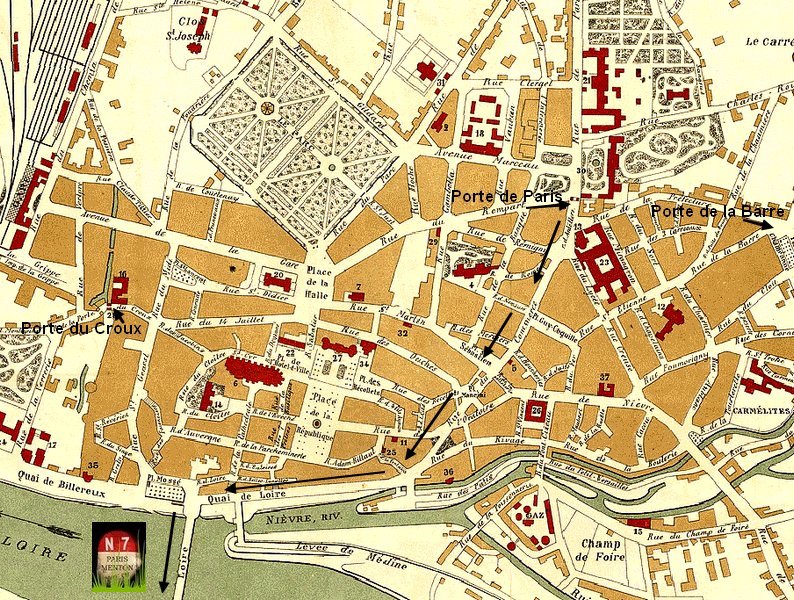
Flèches noires, la traversée de Nevers
à partir de 1577.
|
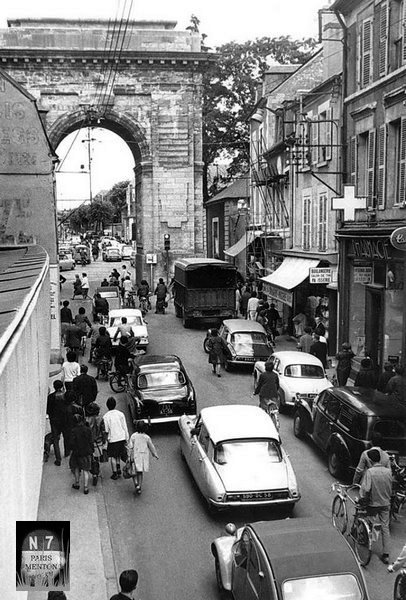
Scène de rue vers les années
1970 : La rue des Ardilliers |
De toute ancienneté la route de Paris passait
à l'origine par la Porte du Croux (voir plus loin).
Cette direction fut abandonnée pour celle de la Porte de
la Barre qui fut à son tour délaissée en août
1577, pour celle des Ardilliers.
En 1606, la route de Paris abandonna un temps la Porte des Ardilliers
pour passer par le faubourg de la Chaussée, en venant de
Pougues et Vernuche, pour finalement être ramenée à
la Porte des Ardilliers, qui prit définitivement le nom de
Porte de Paris.
La rue des Ardilliers fut souvent désignée par le
nom de rue de la Porte-de-Paris.
Le terme Ardilliers s'emploie à l'origine pour
désigner un lieu fait de ronces et d'épines.
Mais il est plus probable qu'en ce qui concerne notre rue, ce soient
les artilleurs qui s'entraînaient dans les fossés proches
de la porte qui donnèrent leur nom à la rue, la rue
des Artilliers (par déformation devenue Ardilliers).
Presque dans l'axe de la porte de Paris, voici l'entrée
de l'église St Pierre construite en 1612.
La rue des Ardilliers prend fin au niveau de la placette Maurice
Ravel.

A l'angle de la place Maurice Ravel et de la rue des Ardilliers,
une plaque de cocher nous rappelle le passage de la route nationale
7.
Image réactive. Photos Claude.K

Une belle fresque moderne pour une pharmacie, rue du commerce.
Photo JF Lobreau. |

Même lieu, et déjà une pharmacie en
1916.
|
La route nationale continuait tout droit, par la rue
du Commerce, ancienne rue des Marchands, devenue rue François
Mitterrand en 1996, aujourd'hui entièrement piétonnière.

Jusqu'au début du XIXe siècle, toutes les boutiques
de la rue du Commerce, avaient conservé leur devanture Moyen-âgeuse.
Ce n'est qu'après 1800 que l'on vit apparaître les
premières devantures modernes.
Les maisons étaient fort basses et l'on était souvent
obligé de descendre plusieurs marches pour entrer dans les
magasins. (wiki58)

L'ancien Beffroi de la ville.
Si la rue des Commerces est sans ambiguïté
en ce qui concerne sa vocation première, il en est de même
pour les rue avoisinantes.
Rue des Francs Bourgeois, rue des Merciers, rue des Boucheries,
rue de la Pelleterie (peaux et fourrures).
Qui pourra dire, dans quelques siècles, quels genres de commerces
l'on trouvait dans la Rue François Mitterand ?
Notre ruelle traverse maintenant la petite placette
St Sébastien, jadis "place du marché au blé",
sur laquelle se dressait le pilori.
Une certaine effervescence régnait ici, au carrefour de la
rue des Saulniers (sel), de la rue de la froumagerie (fromage et
oeufs), de la revenderie (commerces).
Dans un joyeux tohu-bohu se bousculaient ici des fermiers et des
commerçants, des manœuvres et leurs ânes venus
apporter leur marchandises.
Des voyageurs et des pèlerins, mais aussi des spectateurs
venus assister à la mise au pilori de quelques manants et
va-nus-pieds.
Au XIXe siècle, la place était toujours
source de "grand mouvement " puisque s'y concentraient
les compagnies de diligence.
Les messageries royales... 2 départs quotidiens pour Paris,
1 pour Lyon, 1 pour Clermont.
Les messageries générales de France..1 départ
pour Paris, Lyon et Clermont.
Les chaises de poste Marseillaises, passage quotidien à 7
heures du soir (Paris - Marseille en 84 heures).
Source : Wiki58, l'encyclopédie, le wiki
Nivernais
Justement, à propos de transport, nous pouvons
avoir un aperçu de l'ancien relais de poste.

Le Relais de Poste. Image réactive (Photo plaque Claude.K)

Situé à l'angle de la place Saint Sébastien
et de la rue François Mitterrand, ce bâtiment du 15ème
siècle fait de bois et de ciment se compose de deux maisons.
Au 19ème siècle, il servait de point de départ
des voitures à cheval à destination de Marseille,
Clermont-Ferrand, Lyon et Paris.
De l'extérieur on devine aisément l'escalier à
vis menant aux étages.
Plus bas, la place Mancini, ancienne place de la revenderie,
nous rappelle la dernière dynastie des Ducs de Nevers. 


Enseignes d'une époque révolue, place Mancini.
Le secteur piétonnier prend fin au niveau de
la place Mancini.
Encore quelques mètres dans le vieux quartier
et nous retrouvons le quai de Mantoue qui longe parallèlement
le boulevard Pierre de Coubertin sur lequel nous venons de circuler
lors du tracé post-68. 
Nous voici revenus au rond-point face au pont de Loire, la boucle
est bouclée pour le tracé originel. Quoi que...

A gauche le Pont de Loire, au centre Le Boulevard Pierre de
Coubertin, à droite le quai de Mantoue.
Nous avons pu le constater, les rues du centre-ville, à
l'époque non piétonnières, étaient trop
étroites pour autoriser le double sens de circulation sans
difficultés.
Il suffit de mesurer l'étroitesse de La Porte de Paris pour
s'en convaincre. Aussi lorsque la circulation devint difficile voir
impossible, au milieu des années 1960, les ruelles passèrent
en sens unique.
Dans le sens Sud-Nord, les automobilistes venant du
Pont de Loire remontaient par la rue du Commerce, la rue des Ardilliers
et passaient sous la Porte de Paris.
(trajet que nous venons d'aborder dans son sens Nord-Sud)
Naturellement, les automobilistes venant de Pougues
inauguraient dès lors une nouvelle variante de la traversée
de la ville.
Cette variante débutait un peu plus haut que la porte de
Paris, à la bifurcation de la croix des Pèlerins dans
le quartier de la Chaussée.
Retour à la croix des pèlerins. 
Laissons cette fois-ci la rue Colbert, et prenons à droite
la rue Paul Vaillant-Couturier.
C'est l'ex-rue Félix Faure, elle même ancienne rue
de la Chaussée qui n'en était pas à son coup
d'essai, puisqu'à partir de 1606, le trafic se détourna
un temps de la porte des Ardilliers pour traverser ce faubourg maraîcher
où l'on envoyait également les pestiférés
à l'écart de la ville.
Le quartier aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel, faubourg résidentiel,
maisons de villes et peu de commerces.
Un peu morne comme quartier, de plus on passe devant la maison d'arrêt,
ce qui n'a rien de réjouissant...
Au carrefour avec la Rue de Lourdes au niveau du parc Salengro,
un panneau indique la "Châsse de Ste Bernadette".
Quel est donc le rapport entre Nevers, Lourdes et Ste Bernadette
?
Bernadette Soubirous, qui enfant témoigna de 18 apparitions
de la vierge Marie à la grotte de Lourdes, décède
à Nevers le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans.
Suite à sa béatification en 1925, son corps parfaitement
conservé, repose dans une châsse de verre située
dans l'ancien couvent Saint-Gildard à Nevers.
http://www.sainte-bernadette-nevers.com/
En route -
Voici une description datant de 1775 et sans complaisance
du quartier dans lequel nous nous trouvons actuellement : Nevers,
voyage d'un Français 1775 (page 376 et suivantes..)
Poursuivons tout droit par la rue Henri Barbusse dont
la particularité est d'être bordée d'une unique
rangée de maison face au parc pour déboucher ensuite
Place Carnot.
(Comparez votre vision du parc avec la description qui en est fait
ci-dessus en 1775 page 377)
Tour à tour place de la halle aux blés,
marché couvert, marché aux bestiaux, grenier à
sel, c'est également sur cette place que se dressait la potence,
puis plus tard un hospice, nous sommes place Carnot.
C'est le poumon de Nevers avec une perspective sur la mairie, le
palais Ducal et la Cathédrale St-Cyr et Ste-Juliette.

La Place Carnot. 

Une célèbre mais défunte institution de la
place Carnot.
Cette publicité avait été peinte en 1964-65.
Laissons la place Carnot derrière nous, et
engageons nous dans l'avenue du Général De Gaulle
en direction de Moulins, à droite. Une Avenue un peu plus
vivante et commerçante.

La rue de la gare, actuelle avenue Général de
Gaulle. Image réactive.
Au milieu de l'avenue, prendre à gauche en
direction de Moulins. La Rue du Midi, confirme par son nom que nous
sommes dans la bonne direction.
Nous retrouvons les étroites et sinueuses ruelles de la cité
médiévale.

A gauche la rue du midi, remarquez la direction Moulins. Même
lieu aujourd'hui. Image réactive.
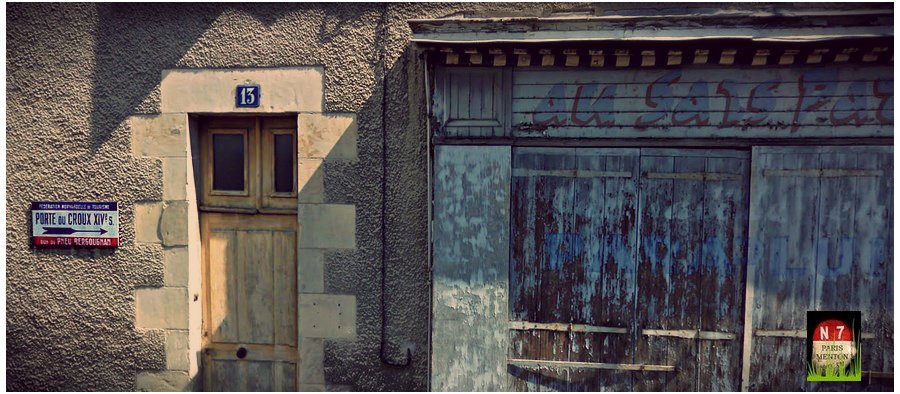
Plaque émaillée, sur le modèle des panneaux
de la Route Bleue, rue du Midi. Ne cherchez plus, elle a disparu.
Image réactive
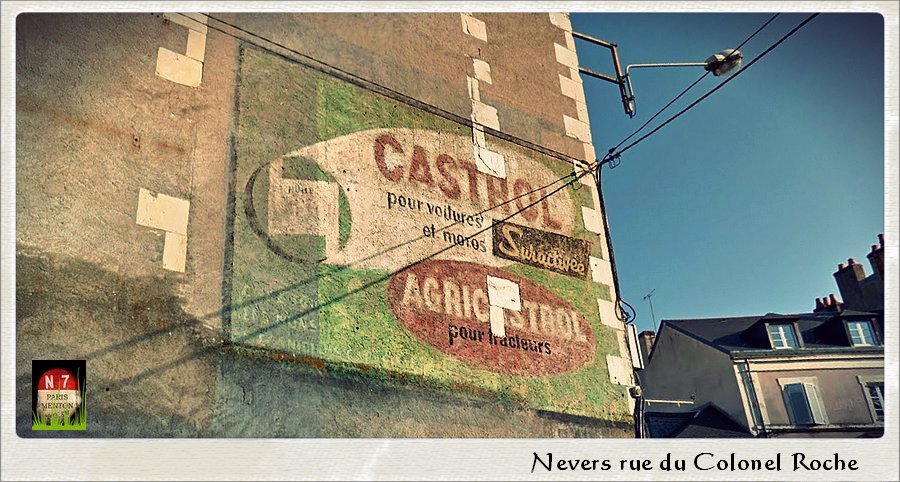
Une belle Publicité peinte à l'angle de la rue
du Midi et de la rue Roche.
La seconde partie de la rue du Midi est passée
en sens interdit dans notre sens de circulation. Il vous faudra
contourner le pâté de maison.
Sur la droite, avant de s'engager dans la rue St Genest, nous
sommes au niveau de la Porte du Croux, la seconde porte sauvegardée
de l'enceinte médiévale. Vous pouvez toujours aller
y jeter un oeil.
Dans le prolongement, la Rue St Genest doit son nom à son
église du XIIe siècle, aujourd'hui déclassée,
successivement transformée au fil du temps en brasserie,
marchand de vins, et garage d'automobiles. 
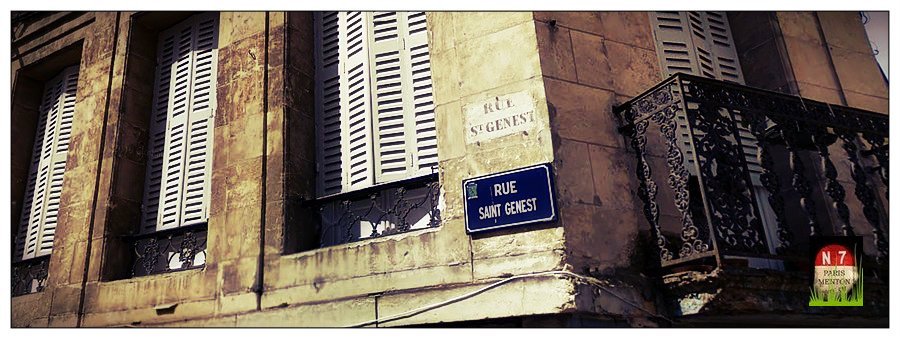
La rue St Genest, un quartier conservé dans son jus.

Ancien commerce, Rue St Genest
Notre trajet touche presque à sa fin, le pont de Loire se
profile bientôt.
En bout de la rue St Genest, un rapide coup d'il dans la rue du
Singe sur la droite, vous fera entre-apercevoir une maison dont
la couleur rouge annonçait sans ambages le caractère
sulfureux de l'établissement.
La nuit, la maison était signalée par une lanterne
rouge, à l'enseigne "Aux trois étoiles".
Ne cherchez plus à vous y aventurer, en 1946 la loi Marthe
Richard est passée par là.
L'établissement coquin est aujourd'hui réhabilité.
http://cfpphr.free.fr/maisonclose58nevers.htm

La "maison rouge" de la rue du Singe
Remarquez maintenant la dernière maison de
la rue St Genest, une vieille bâtisse en coin, presque en
ruine, aux murs de ciment gris, aux vitres cassées et aux
portes murées.

Votre oeil aiguisé aura tôt fait de repérer
là un ancien relais, ou plus exactement l'Hôstellerie
du "Grand Monarque", hôtel du XVIIe siècle
qui reçu en ses murs le Général Napoléon
Bonaparte,
le 15 octobre 1799 alors qu'il revenait d'Égypte.

A quelques mètres du Pont de Loire, l'ancienne Hostellerie,
un temps menacée de destruction. image réactive.
Depuis 1910, une plaque est apposée sur la
façade de l'établissement pour rappeler l'événement.
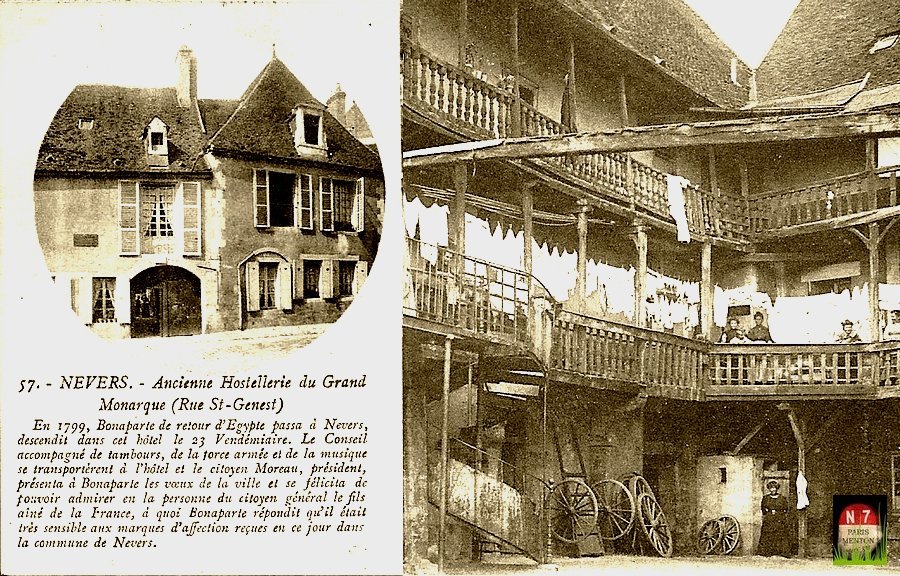
Après plus de vingt années d'abandon et de dégradations,
le site devrait être réhabilité en logements,
commerces, bureaux, et un restaurant devrait également voir
le jour à partir de 2020.
Le projet est dans les mains d'investisseurs privés...

Place Mosse, juste avant le pont. La célèbre Auberge
Saint Louis. Image réactive.
Non loin de là en contrebas, vous trouverez
un petit parking, duquel on a une belle perspective sur le pont
et la Loire.
Tous les chemins de Nevers mènent au pont, nous voici donc
à la jonction finale des traversées de la ville. 

Jonction sud des divers tracés étudiés.
Le pont remonte à l'antiquité, d'abord construit
en bois, puis en pierre, il a subit au fil des siècles, nombre
de destructions.
Le pont actuel composé de 14 arches est en fait la soudure
de deux ponts, le premier datant de 1770, l'autre de 1817. Il totalise
350 mètres de long.

Le Pont de Loire, vu du quai des mariniers.
Deux pavillons, servant aux bureaux d'octroi et de péage,
s'élevaient à l'entrée du pont, du côté
de la ville.
Ils seront supprimés en 1883 et remplacés par un nouveau
bureau de l'octroi situé sur l'autre rive en 1885.
Le pont a résisté aux crues du XIXe siècle,
qui ont dépassé celles de 1790.
En raison de la qualité des pierres du pont, « un grand
nombre de citoyens de la ville et du dehors » avaient pris
l'habitude de venir y aiguiser leurs outils.
Il fallut un arrêté préfectoral (7 février
1833) pour mettre fin à cette pratique.
Source : https://www.gennievre.net/portail/index.php/wiki58-l-encyclopedie
http://player.ina.fr/player/embed/DXC9809302281/1/1b0bd203fbcd702f9bc9b10ac3d0fc21/560/315/0/148db8
Reportage INA 1979 sur le Pont de Loire
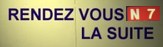

Retour au sommaire

