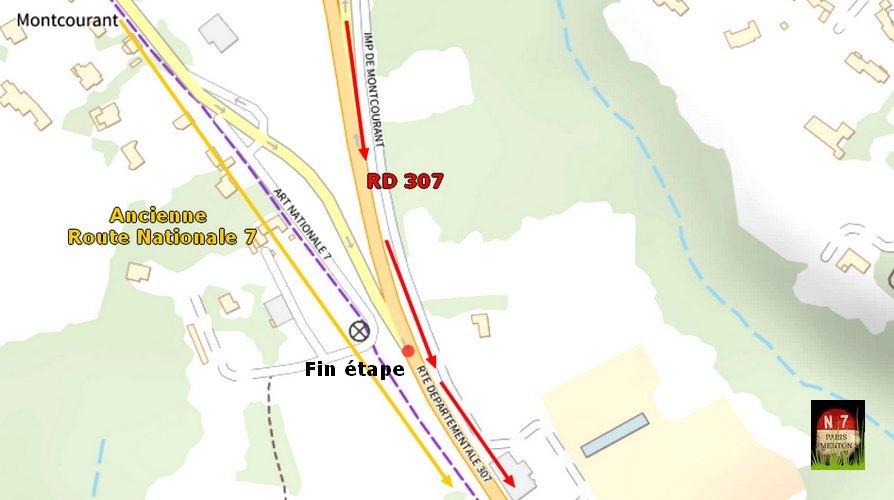Bully Km 0435 
http://www.bully.fr
Bully est un village pittoresque du Beaujolais des "Pierres Dorées".
Dominant la vallée de la Turdine, le clocher de l'église (1861)
et le donjon du château du XVe siècle invitent le passant à
pénétrer dans le bourg pour y découvrir de nombreuses
constructions en pierre de Glay.
Extrait de la tablette Randoland.
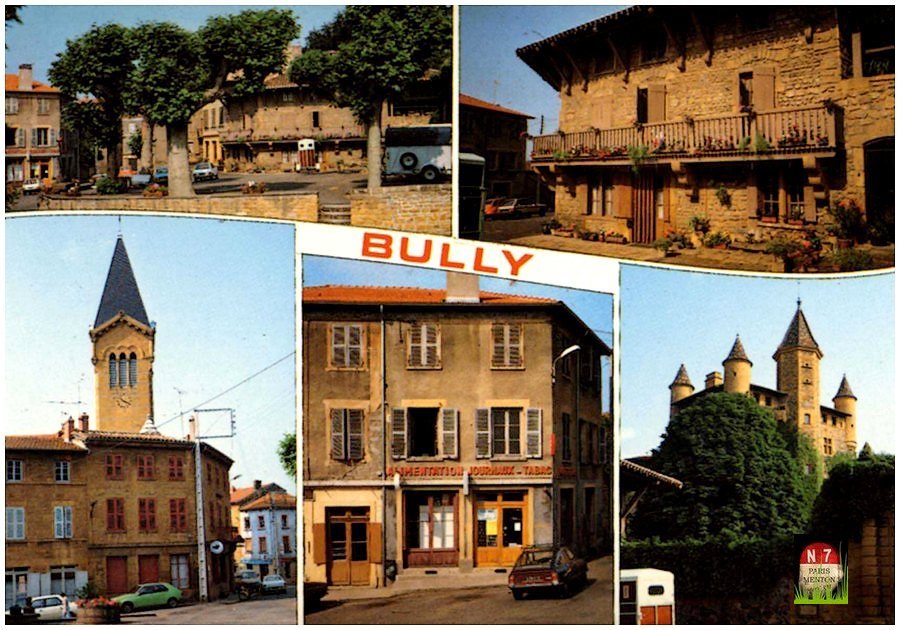
Aux Pays des Pierres Dorées. Une sympathique bourgade.
La commune de Bully sur l'Arbresle est connue depuis l'époque
Gallo-Romaine.
Des médailles et monnaies Romaines retrouvées dans le fond
de bassin d'antiques stations thermales, attestent de la connaissance de
sources d'eaux en cette période de domination Romaine.
Un recensement en 1880 dénombrera pas moins de 53 sources d'eaux
minérales aux diverses propriétés.
On attribue au bouillonnement de ces sources l'origine du
nom latin Bulliacus qui est donné à cette localité
dans toutes les chartes du Moyen-Âge.
Bulliacus deviendra plus tard Bully. (Une autre version propose Bulliacus,
un nom d'origine gallo-romaine qui signifierait "propriété
de la famille de Bullieu")
Aux temps des invasions barbares, les stations thermales seront abandonnées,
oubliées de tous, pour toujours.
Si les eaux de Bully cessèrent d'être fréquentées
pendant la longue période qui s'étend du commencement du IVe
siècle jusqu'à nos jours, une œuvre essentiellement Romaine
continua de subsister sur le territoire de cette localité.
Il s'agit de la voie antique de Lyon à Roanne, à laquelle
les plus anciens documents du Moyen-Âge donnent le nom de Via Francisca,
la voie Française.
L'existence de cette route est attestée au Moyen-Âge à
Bully et dans diverses localités alentours.
Sources et extraits de la Notice Historique et Archéologique
par A Vachez imprimerie générale de Lyon 1884.
Dans l'antiquité la Via Francisca empruntait donc l'antique
voie Romaine, actuels "chemin sous Bully" puis "chemin du
pavé", qui arrivait "rue de la Poterne" au cœur
du village fortifié de Bully.
La route subira plusieurs déviations au fil des siècles.
Les cartes indiquent qu'au XVIIIe siècle, elle ne passe
déjà plus par le centre, mais par la montée de Laval,
actuelle rue de France, un peu plus à l'Ouest, hors les murs et fossés
de la cité.
Jusqu'au milieu des années 1950, ce sera le tracé officiel
de la nationale 7.
En 1955, un nouveau contournement voit le jour, sur à peine 500 mètres,
il évite définitivement le bourg.
En route -
On remonte la petite rue d'Aquitaine - bordée de quelques rares
platanes - où l'on peut admirer de belles maisons en pierres dorées
spécifiques à la région.
http://www.carrieres-de-glay.fr/

Si l'on reconnaît d'emblée la pub Picon, celle pour le
Cognac ADET est plus difficile à déchiffrer. Photo JF lobreau.
Cela dit, permettez moi de douter du cocktail Picon Cognac ! Aujourd'hui
la plaque Picon a disparu.
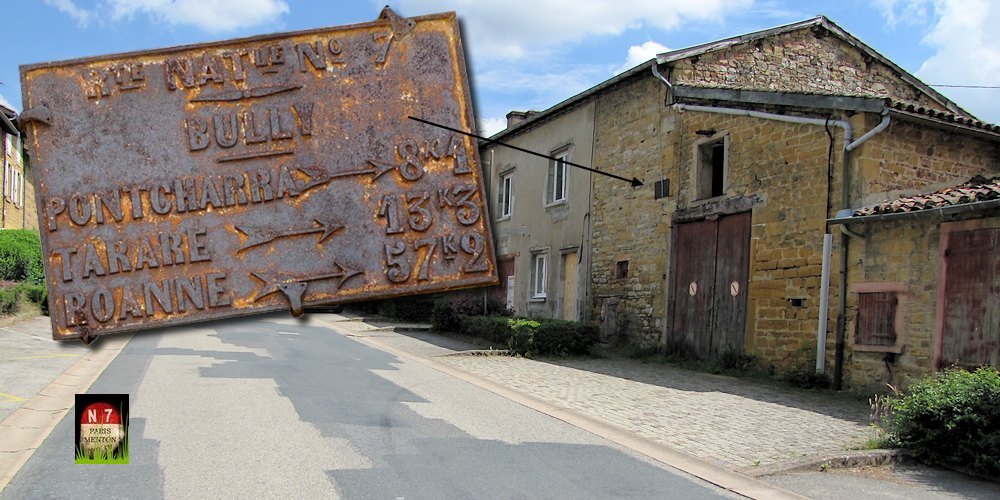
Pierres dorées et plaque de cocher. Photo Claude K. Photo gros
plan J.F Lobreau.

La rue d'Aquitaine et la Place du Trève. Avant / après.
Image réactive.
Devant l'Hôtel Durand, visible au fond, la RN7 tourne à droite.
Remontons la rue d'Aquitaine jusqu'au carrefour avec la rue
de France, qui part sur la droite, à angle droit. 
Au coin une agréable surprise, côté gauche quelques
plaques Michelin nous rappellent le passage de l'ancienne RN7, sur la droite
une vierge à l'enfant.

Des plaques Michelin nous invitent à emprunter la RN7 par la
rue de France. Photo Claude K.
Collection de plaque Michelin à gauche et vierge
à l'enfant sur la droite. Photos Claude.K

Peut-être sort-il encore de l'eau minérale de cette pompe
située rue de France. Photo Claude.K

Camion Berliet avec remorque s'engouffrant dans la rue de France et
s'apprêtant à descendre la "Montée de Laval"
en direction de Lyon.
Cette photo illustre bien la nécessité de faire passer
le trafic routier hors du centre ville.
Remarquez la borne d'angle et la plaque Michelin sur le mur du fond.
Toutes deux ont disparu aujourd'hui. Photo ???
Même lieu aujourd'hui. Photo Claude.K
Tournons à droite et empruntons la Rue de France, autrefois
appelée la "Montée de Laval"... sauf que là
nous descendons "la Montée"...

Autrefois la Montée de Laval, aujourd'hui la Rue de France, vu
d'en bas. Même point de vue aujourd'hui. Image réactive.
On retrouve rapidement l'actuelle RN7 (déviation de
1955) en direction de Lyon.
A la jonction des deux tracés une ancienne station-service, transformée
en boulangerie. 

A la jonction des deux tracés, une station Mobil. Même
point de vue aujourd'hui. Image réactive.
En route -
La route de Lyon amorce une descente de 5 km à travers les Monts
du Beaujolais pour rejoindre tranquillement la ville de l'Arbresle.

Hotchkiss et Dubonnet, dans la descente vers L'Arbresle. Photo Claude.K

Hotchkiss. Photo Claude.K


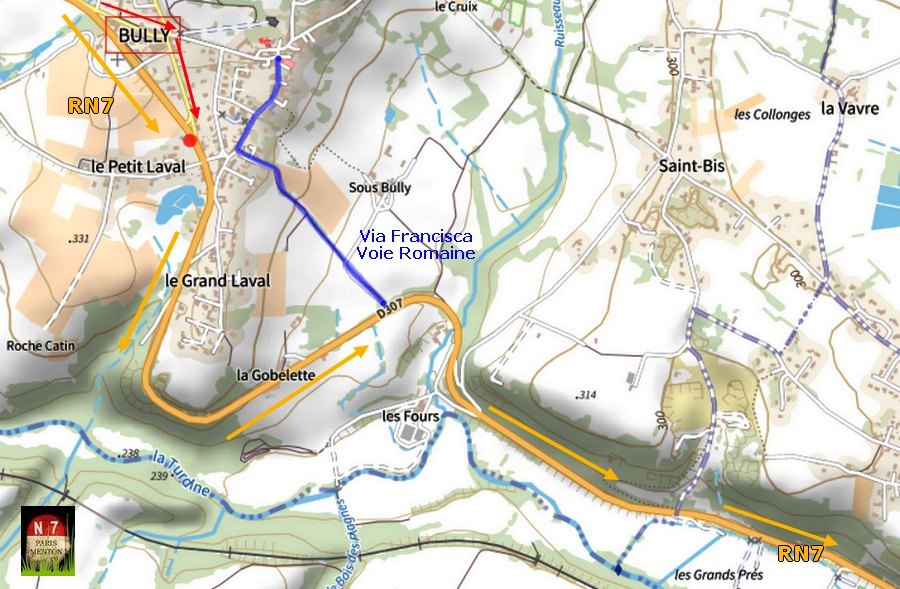
En bleu, le Chemin Pavé, ancienne voie Romaine / voie Francisca.

Votre attention à négocier les courbes de la route pourrait
vous faire manquer le petit cul de sac sur la gauche.
Sur la gauche, voici le "Chemin Pavé", c'est
par ici que passait la Via Francisca pour rejoindre Bully, l'ancêtre
de notre Route Nationale 7. (voir carte ci-dessus).
S'il fut autrefois pavé, comme le suggère son nom, le chemin
est aujourd'hui en partie goudronné ou simple chemin de terre.

La fabrique Gaillard, dernier des fours à chaux de l'Arbresle.
Photo Claude.K
Depuis l’Antiquité, les sols riches en carbonate
de calcium des environs de l'Arbresle, sont exploités pour la fabrication
de la chaux utilisée dans la construction ou pour l'agriculture.
A la fin du XIXe siècle, l'arrivée du train, et la concurrence
de la Chaux de Bourgogne, moins chère et de meilleure qualité,
précipitera la fermeture des fours à chaux de la région.
En 1936 on ne recense plus que quatre fours à Chaux dans tout le
département du Rhône.
L'un de ces quatre, le Four Gaillard est la dernière fabrique de
chaux à l'Arbresle.
Source : Les Amis du Vieil Arbresle.

Four à Chaux Gaillard et son café en terrasse.
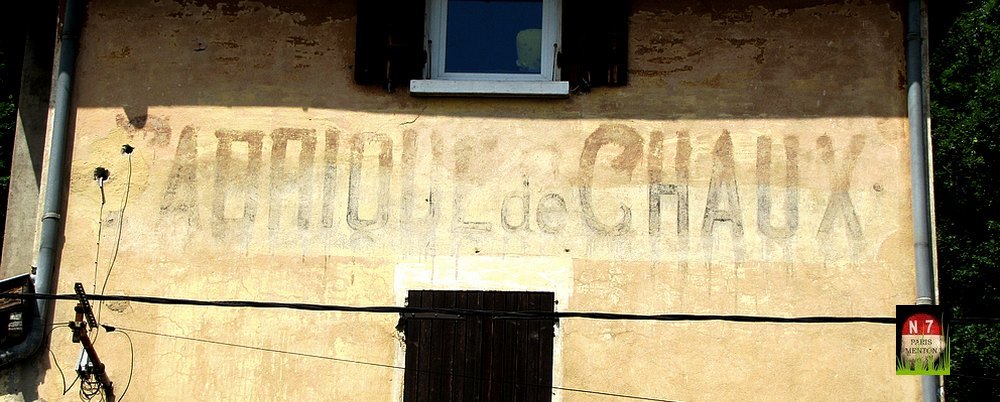
Le Four Gaillard. Photo Claude.K
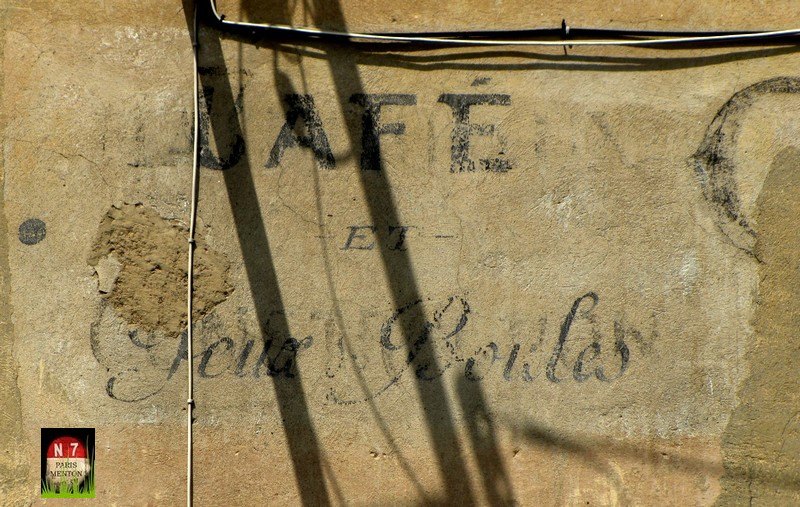
Café Gaillard et Jeux de boules. Photo Claude.K
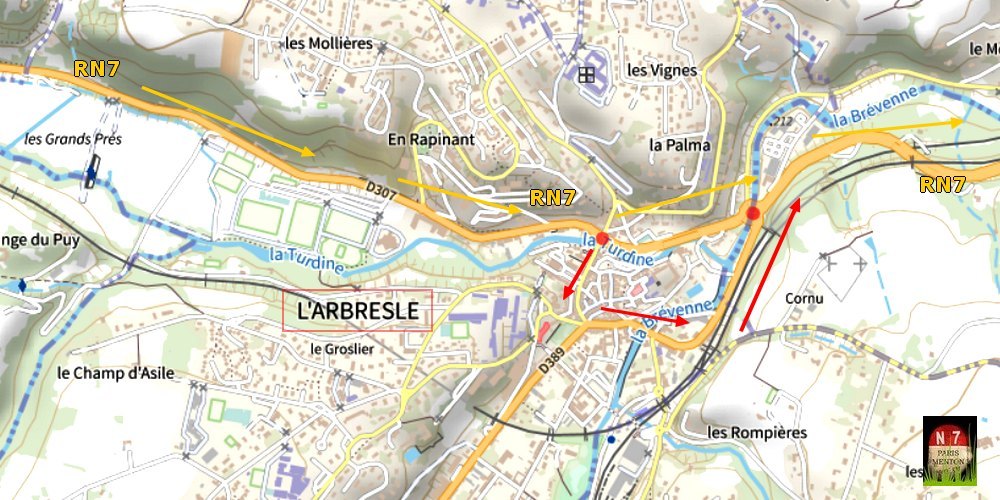
Flèches rouges, le tracé historique.

Depuis le 1er janvier 2024, cette portion de route a été transférée
au département.
Le cartouche N7 est remplacé par D307. Photo Claude.K

Station service Total flambant neuve en 1966 à l'entrée
de la ville. Image réactive.
L'Arbresle Km 0440 
http://www.mairie-larbresle.fr
Dès l'époque néolithique, le site de L'Arbresle est
occupé par l'homme.
Cette occupation humaine plusieurs fois millénaire, l'Arbresle la
doit à son emplacement privilégié.
Située au confluent de la Brévenne et de la Turdine, à
la jonction des monts du Lyonnais et du Beaujolais, au carrefour de deux
routes importantes, la route du Bourbonnais (RN 7) et la route d'Aquitaine
(RN89),
la petite ville de L'Arbresle propose dès le Haut Moyen-Âge,
une halte bienvenue sur le Grand Chemin Français qui est l'itinéraire
le plus court et le plus fréquenté reliant Paris à
Lyon.
Pendant des siècles, marchands, soldats, pèlerins, voyageurs
illustres ou anonymes s'arrêteront pour boire, manger et dormir dans
les nombreuses auberges et hostelleries que propose la ville.
Essentiellement localité agricole, sa proximité avec la ville
de Lyon, attire les bourgeois et les nobles Lyonnais qui y font bâtir
au XVIème siècle, des maisons dans le style de l'époque
Renaissance.
A partir du XIXe siècle l'essor industriel de la capitale des Gaules
bénéficiera à L'Arbresle qui se spécialise dans
l'industrie textile.
Sources et extraits : https://www.amis-arbresle.com
L'Arbresle viendrait du terme "arbre" et du suffixe féminin
"elle" signifiant le petit arbre. Toponymie générale
de la France
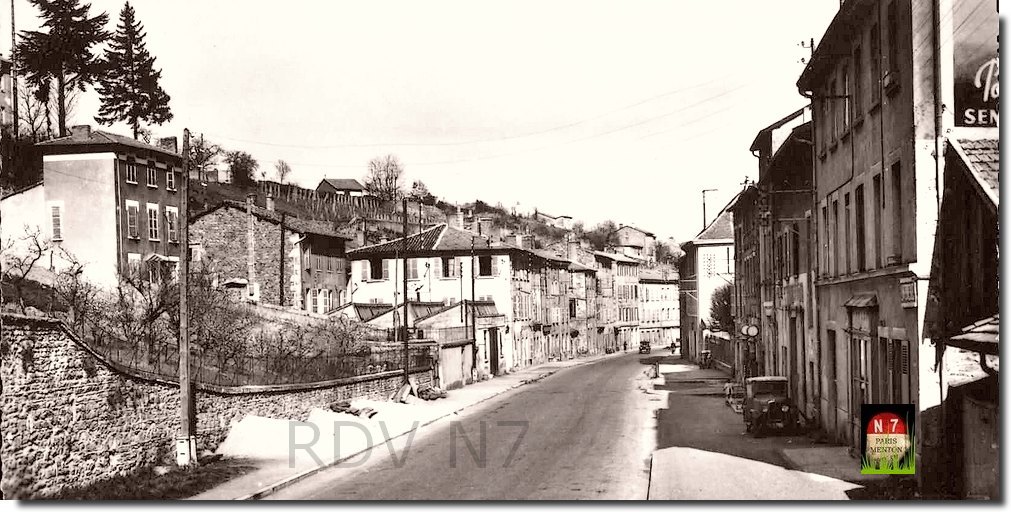
Entrée du Bourg, Rue de Paris - années 30.
En route :
La traversée de la ville est simple.
Il suffit de suivre la "Rue de Paris", qui, dans sa première
partie, a conservé ses alignements de maisons aux façades
colorées typiques de la région, faisant vaguement penser aux
rues d'une ville italienne, le folklore en moins.

La rue de Paris avant / aujourd'hui. Image réactive.
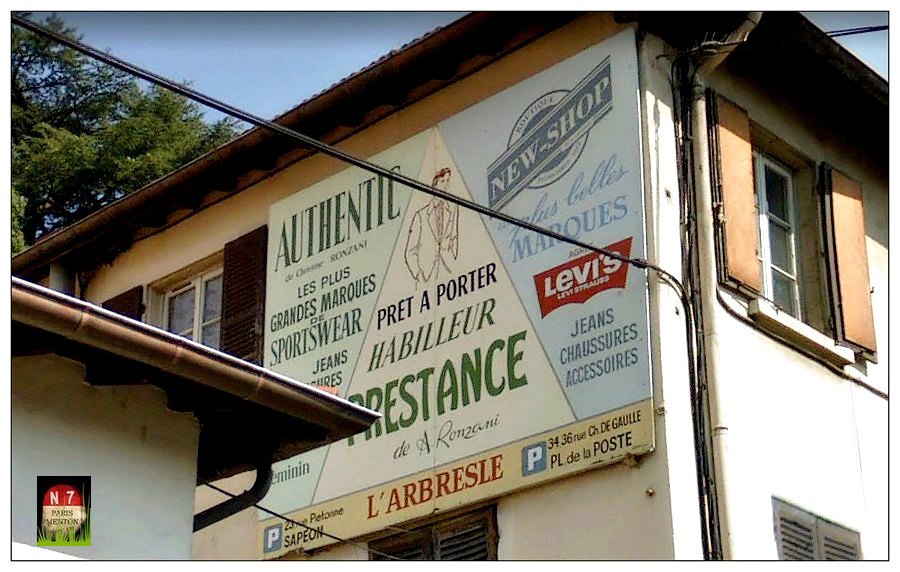
Ce n'est certes pas un mur peint, mais ce panneau 4 x 3 possède
le style désuet des réclames que l'on trouvaient dans les
catalogues des années 1950.
La boutique de prêt à porter existe toujours aujourd'hui.

Enseigne Rue de Paris. Notez le n° de téléphone à
2 chiffres, les Écuries et la Remise pour les équipages attelés.

De nombreuses hostelleries s'établirent à L'Arbresle et notamment
autour du quartier de la Porte du Beaujolais.
Image réactive.

Quartier de la Porte du Beaujolais vu en 2016. Photo Claude.K
L'agréable Café des Chasseurs a définitivement baissé
le rideau en 2018.
 Porte du beaujolais.
Porte du beaujolais.
Vous avez deux minutes de libre ?
Alors, à quelques mètres du carrefour, sur la
gauche, allez jeter un œil à l'hôtel des Trois Maures,
édifié à la fin du XVe siècle.
Plus question d'y passer une nuit, la bâtisse est aujourd'hui transformée
en habitation, mais en faire le tour vous plongera en plein Moyen-Âge.
Construit à l'extérieur de la ville fortifiée, dans
un faubourg réputé pour ses auberges, le bâtiment échappa
miraculeusement à la terrible crue de 1715.
Seuls subsistent quelques vestiges moyenâgeux, des fenêtres
à meneaux, une tourelle d'escalier, une porte cochère et l'enseigne
aux " Trois têtes de Maures" restaurée.

Rue des Trois Maures, l'hôtel des Trois Maures et son enseigne
restaurée. (en cartouche l'enseigne originale)
Au Moyen-âge, les enseignes étaient très souvent imagées
pour être mieux comprises des illettrés et des analphabètes.
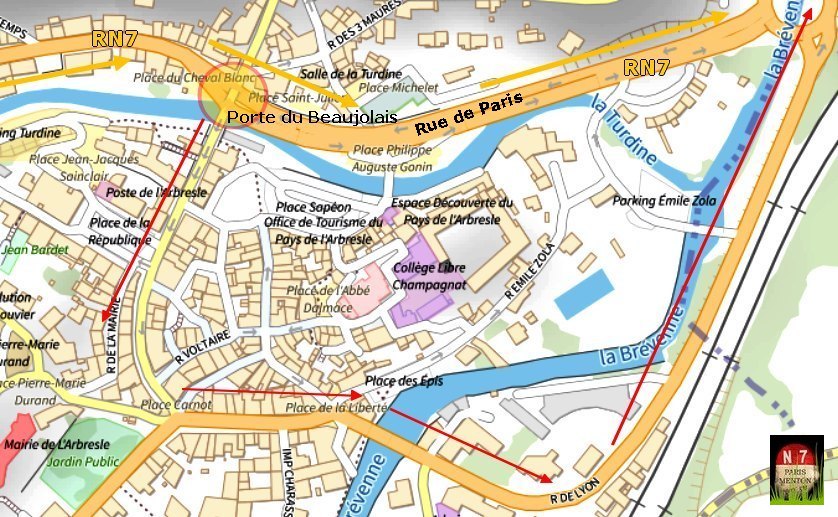
Flèches rouges le tracé historique |
|
Quartier de la Porte du Beaujolais, dont le qualificatif
nous rappelle que l'Arbresle est une commune viticole du vignoble du Beaujolais,
poursuivons la Rue de Paris tout droit.
En route -

Sur cette seconde partie, la Rue de Paris devient une sorte
de passerelle longeant la Turdine, surplombant d'anciens quartiers et de
laquelle on a une jolie vue sur l'église et sur l'ancien château
médiéval .
Ce tronçon de Route N7 a été créé tardivement
au début des années 1980, afin de se détourner du tracé
originel qui traversait alors les étroites rues du centre ville.
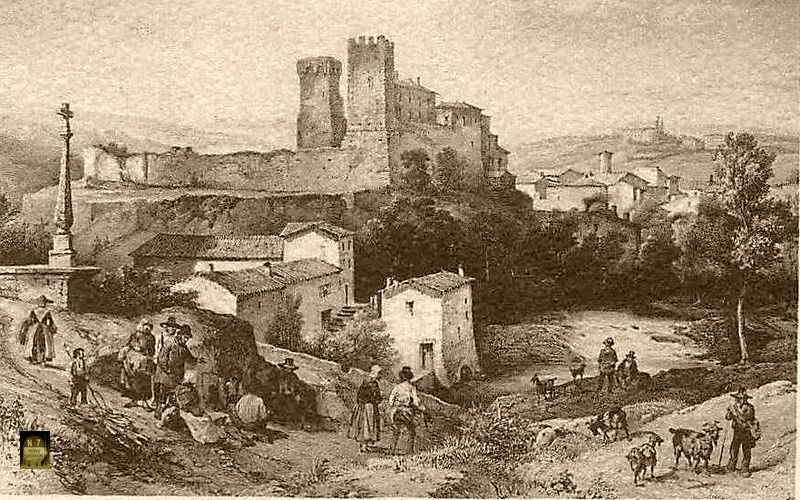
Vue du château de L'Arbresle vers 1850.

De la passerelle Sapéon, on a un bon aperçu de la route
nationale construite en encorbellement le long de la Turdine. Image réactive.
Photos Claude.K
On quitte L'Arbresle au rond-point où l'on croise la D89, la route
d'Aquitaine reliant Lyon à Bordeaux. 

A la sortie de l'Arbresle, la RN7 (D307) croise
la RN89 (D389) en direction de Clermont-Ferrand.
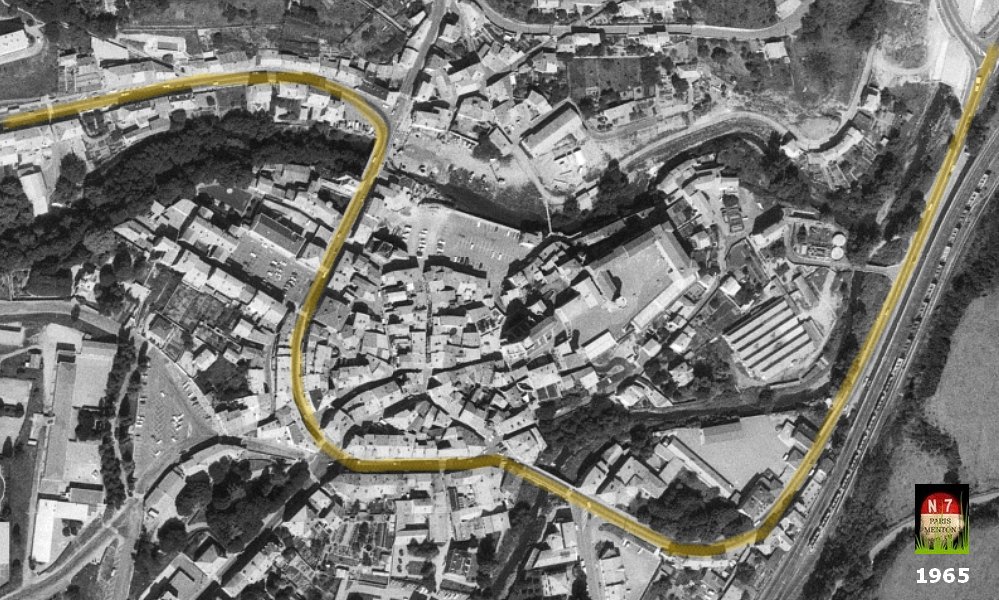
Sur le cliché des années 60, la RN7 arrive de la Rue de
Paris (à gauche) tourne sur la droite à la porte du Beaujolais,
emprunte l'étroite rue Charles de Gaulle
qui serpente dans le centre ville (ex rue Centrale), puis quitte L'Arbresle
en direction de Lyon (en haut à droite). Image réactive.
Depuis 1980, la route évite le centre ville.
Au Carrefour de la porte du Beaujolais, la Rue de Paris se poursuit désormais
tout droit
et rejoint directement la direction de Lyon en évitant la rue Charles
de Gaulle.
Ne quittons pas L'Arbresle sans avoir fait notre voyage nostalgique
et historique par le tracé d'avant les années 1980.
Il y eu jadis, au temps du Grand Chemin de Paris à Lyon, un tracé
encore plus ancien, mais les inondations de septembre 1715 détruisirent
en totalité le pont et les quartiers que la voie traversait.
Au XVIIIe siècle, une nouvelle rue dite "Centrale" fut
construite, traçant ainsi pour plusieurs siècles l'itinéraire
de la N7 et ce jusqu'aux années 1980.
Revenons donc à la Porte du Beaujolais, et empruntons l'étroite
rue Charles de Gaulle qui n'est autre que l'ancienne rue Centrale mise en
service au XVIIIe siècle, 

Bonne idée de faire cohabiter les deux plaques de rue. Ancienne
et nouvelle appellation. (photo cartouche Claude.K)
On entre dans la Rue Charles de Gaulle par le pont sur la
Turdine.
Ce pont relativement récent a été reconstruit lors
de l'aménagement de la déviation de la nationale 7 en 1980.
Mais de quand datait l'ancien pont ?
Remontons quelques siècles en arrière.
Les premiers documents attestant d'un pont, datent du XVIe siècle.
En 1668, la description de l’état du Grand Chemin Royal de
Paris à Lyon mentionne :

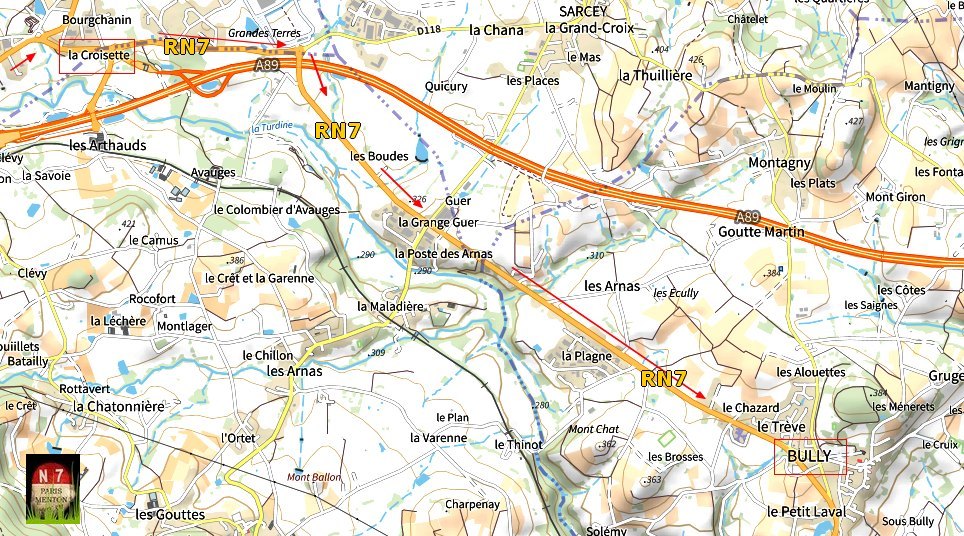

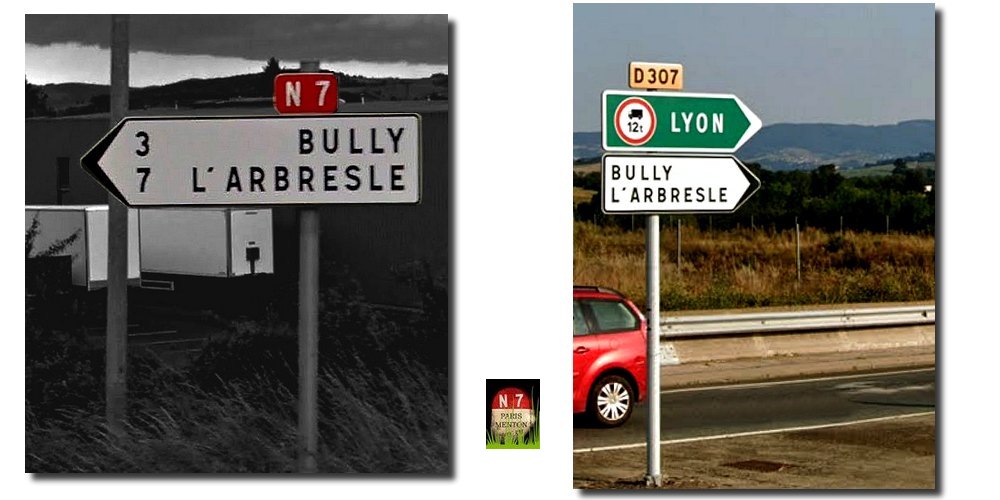
![]()

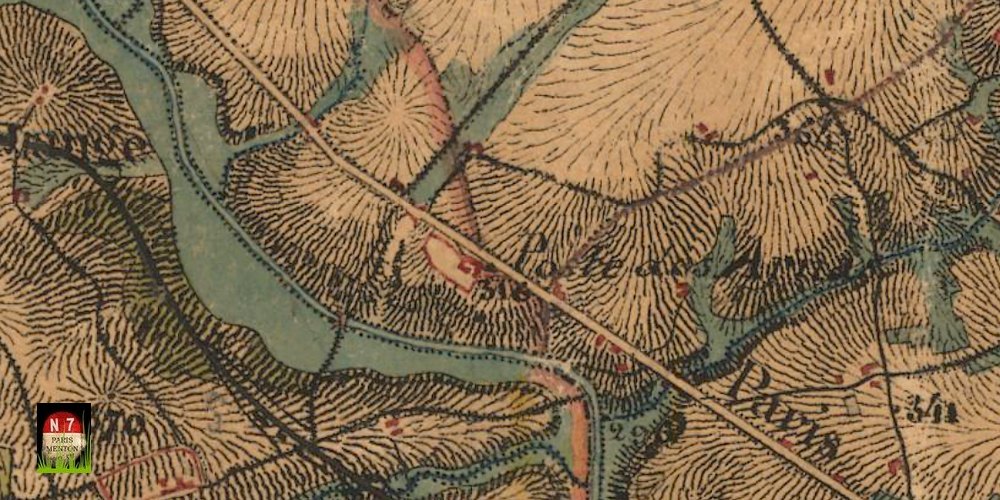
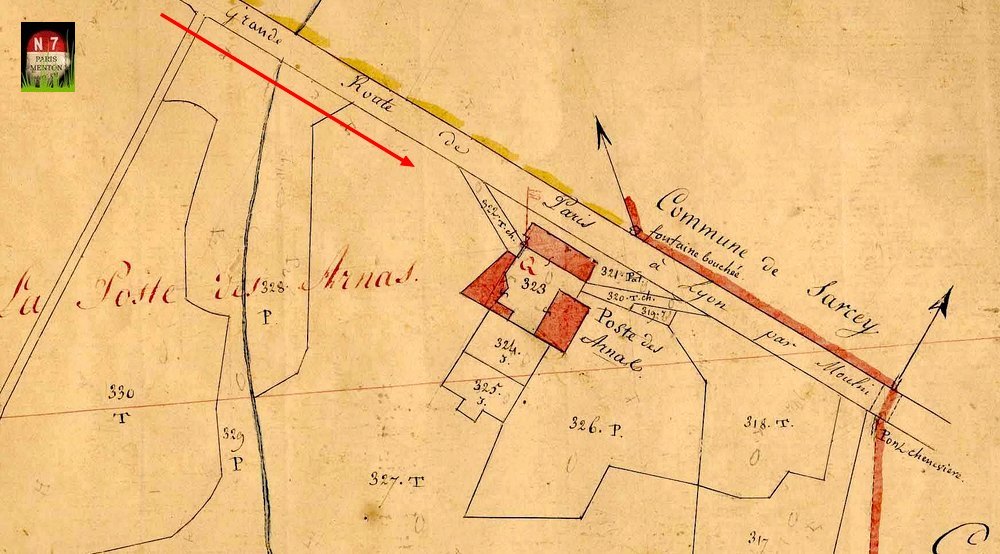






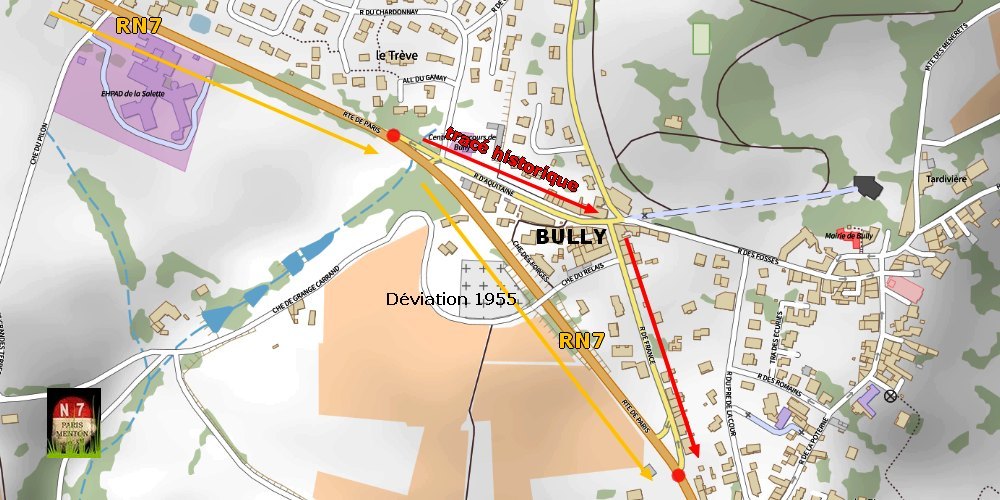
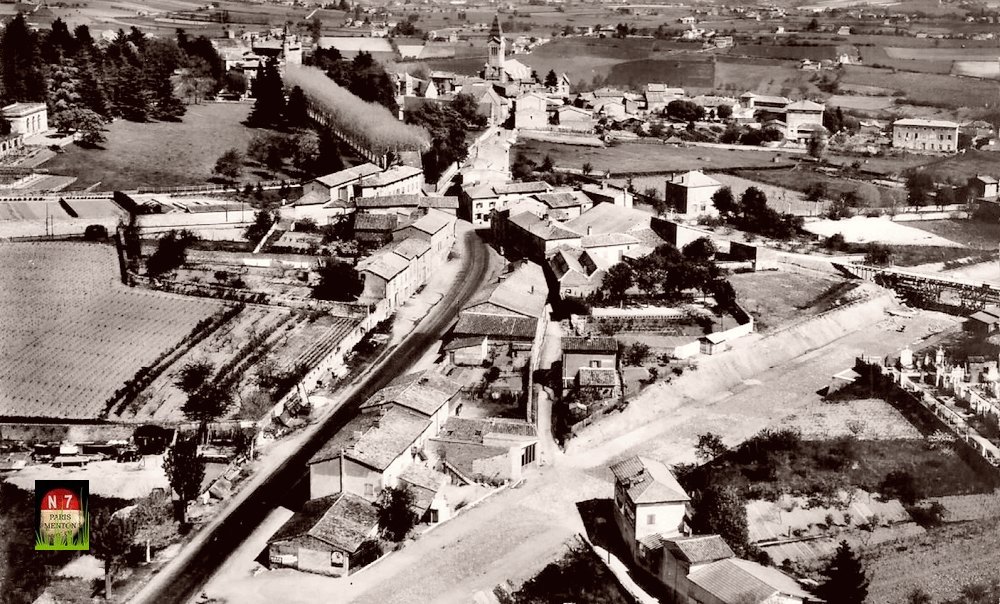

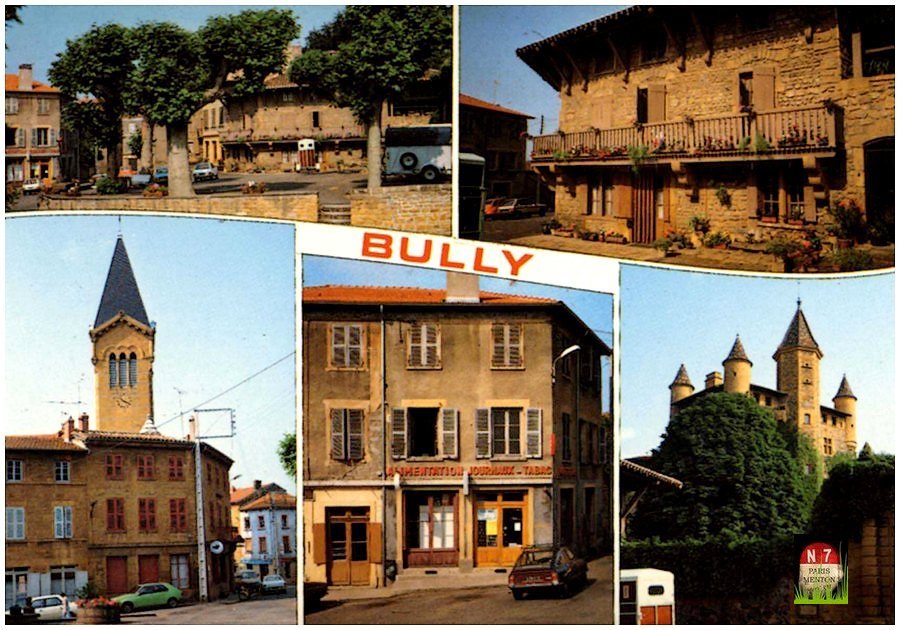






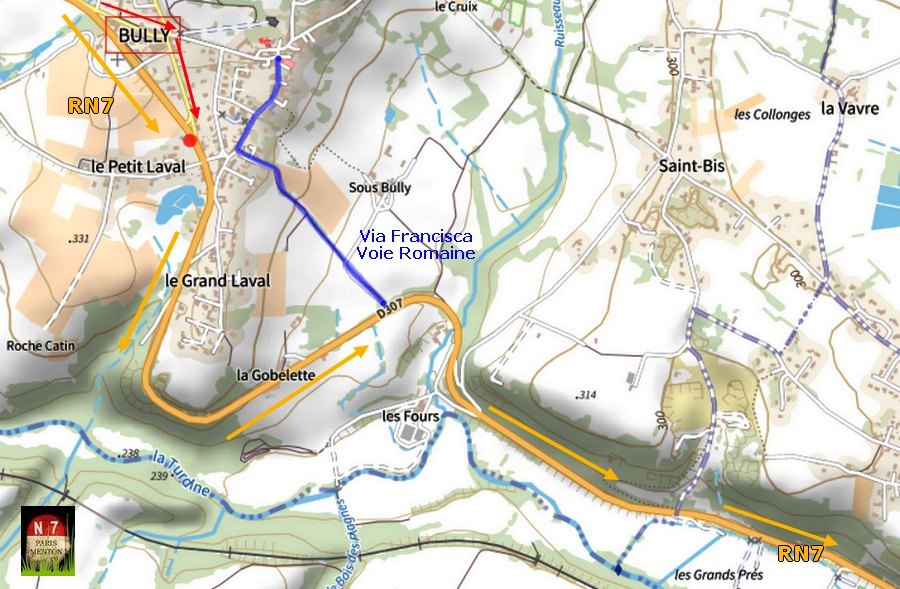


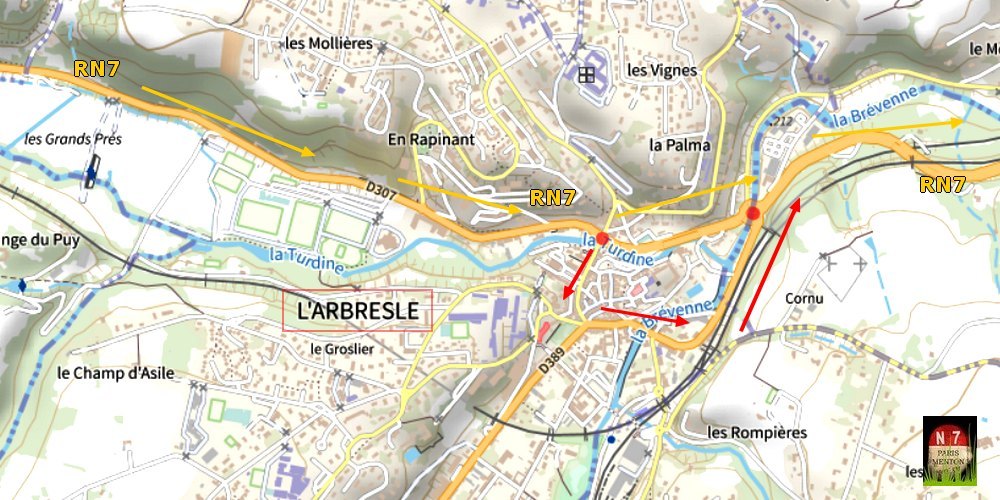

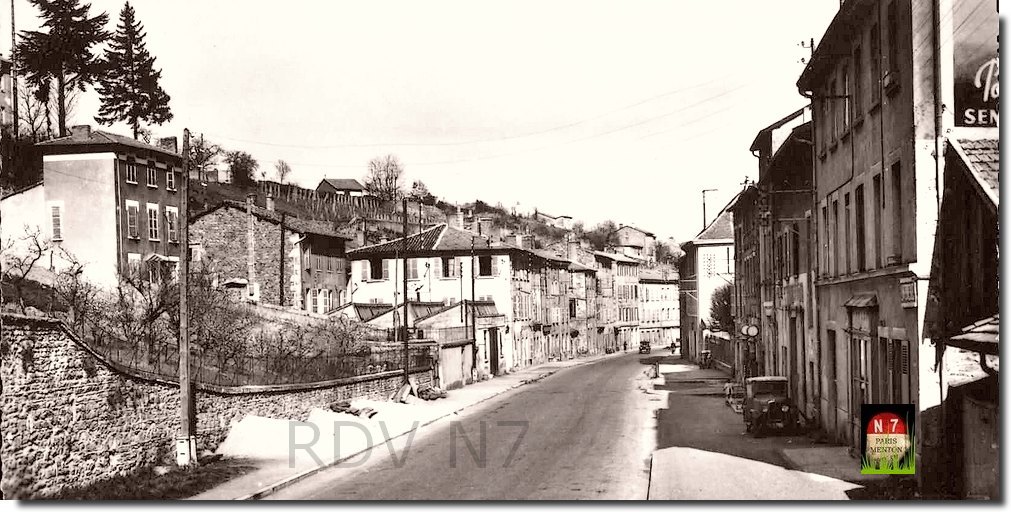

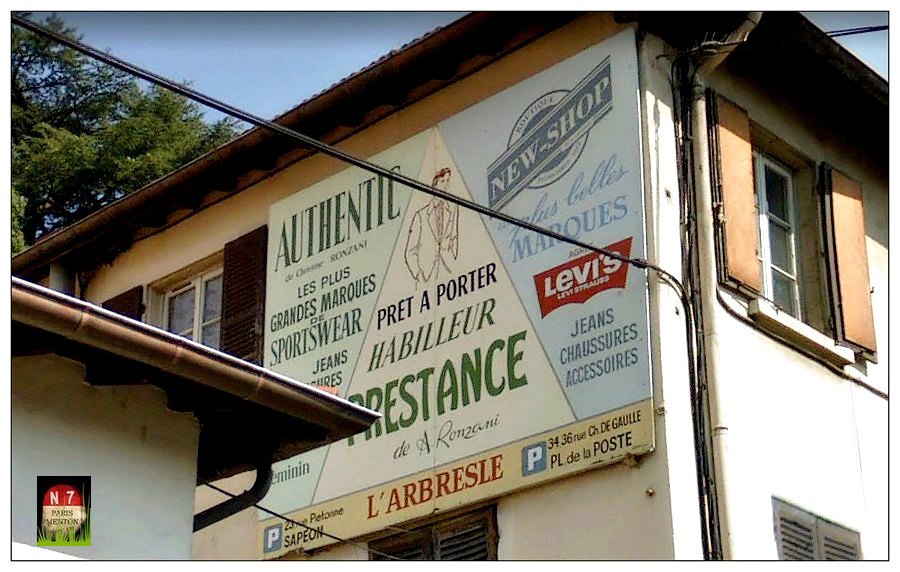



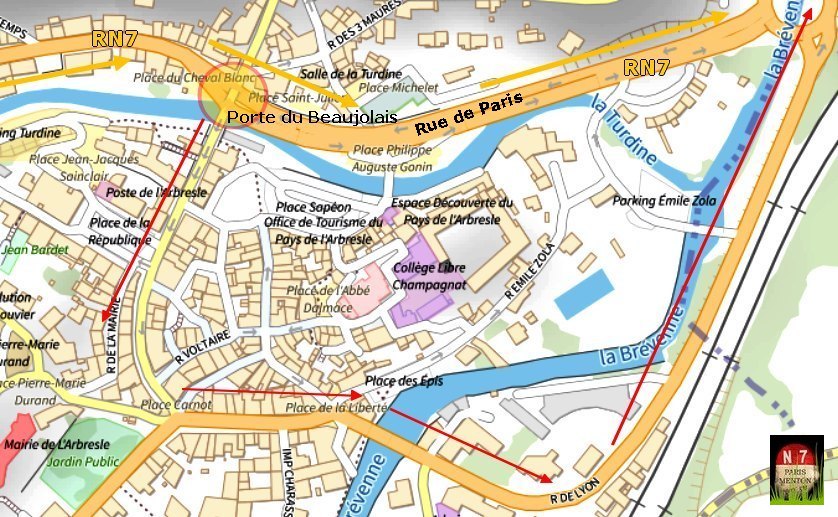

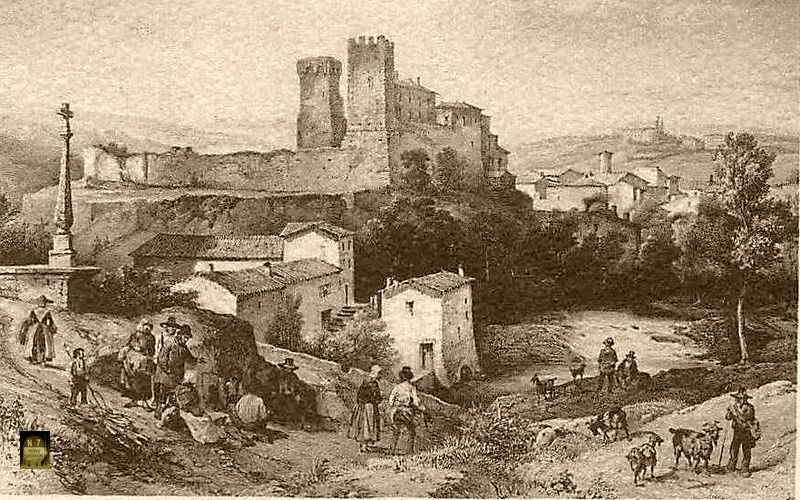

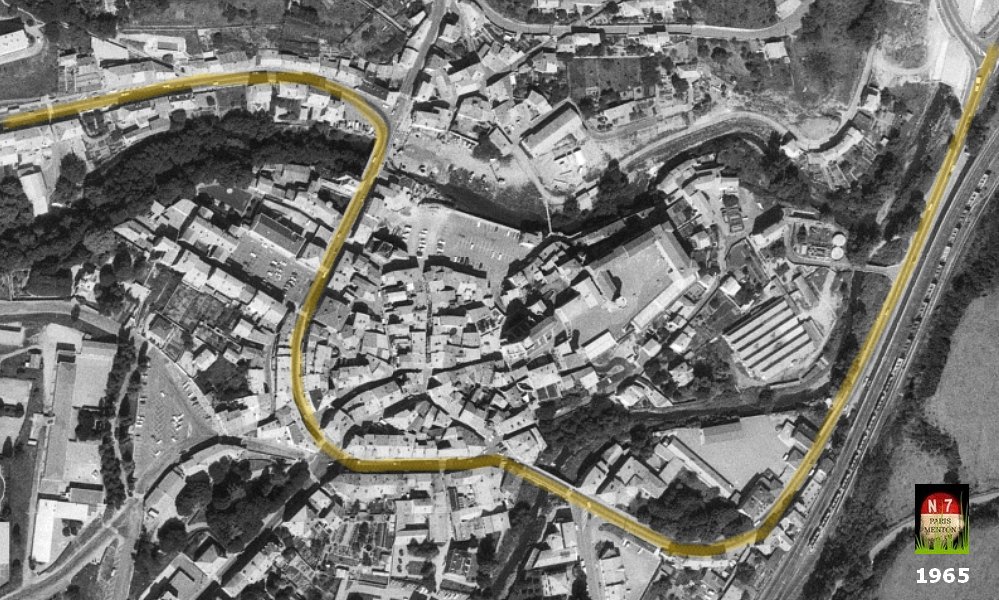

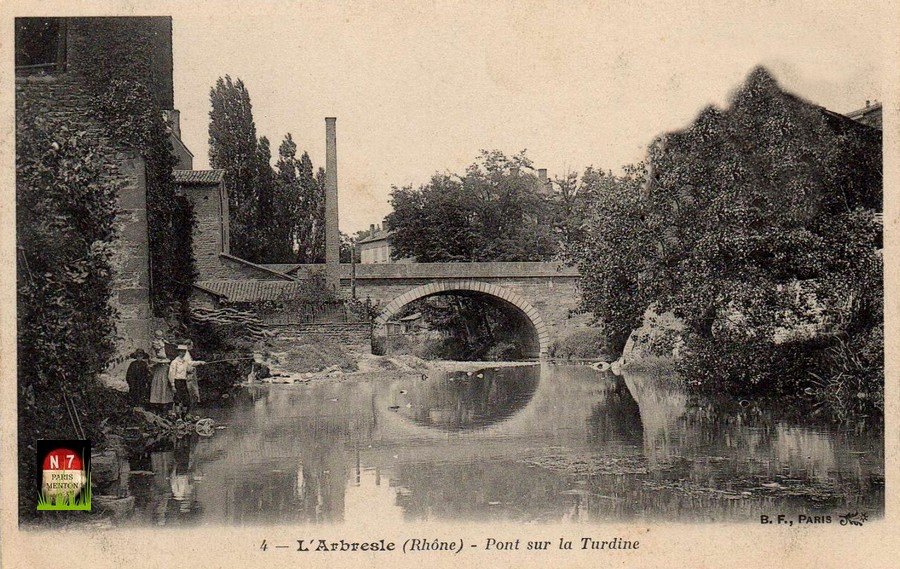
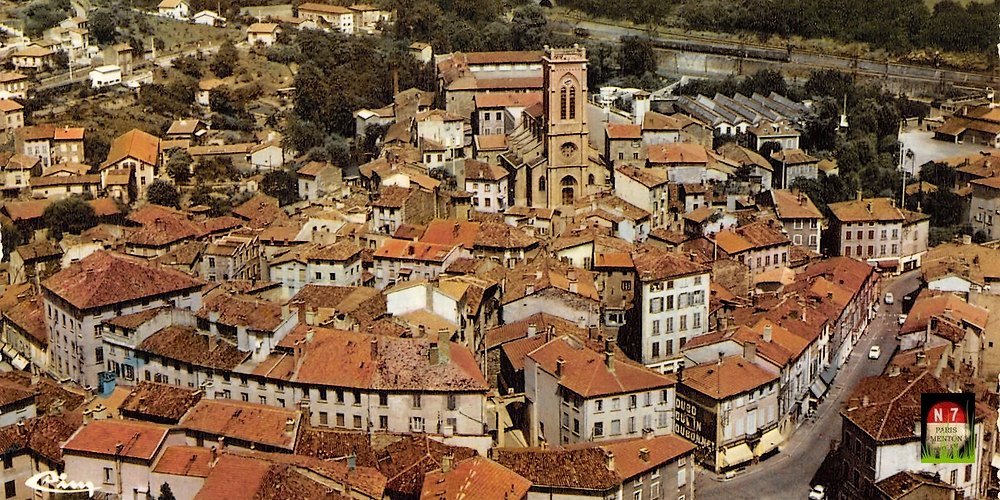
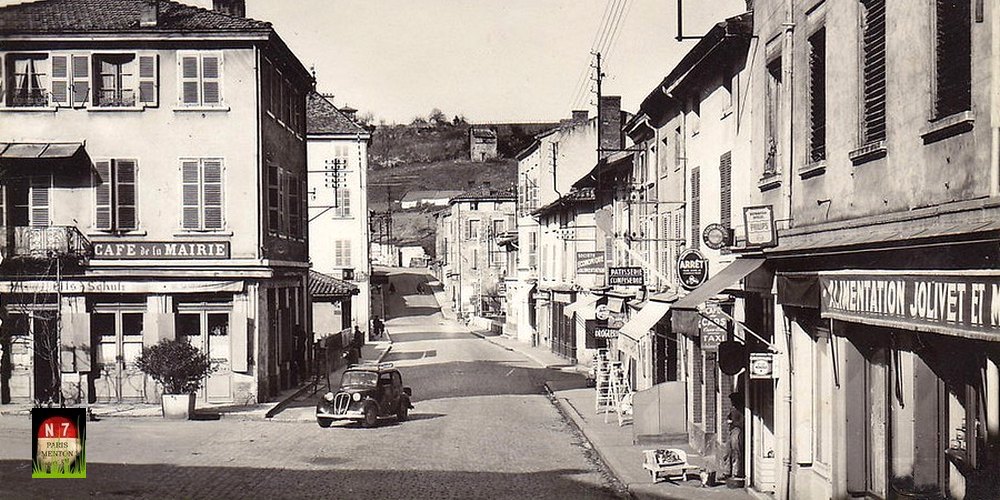
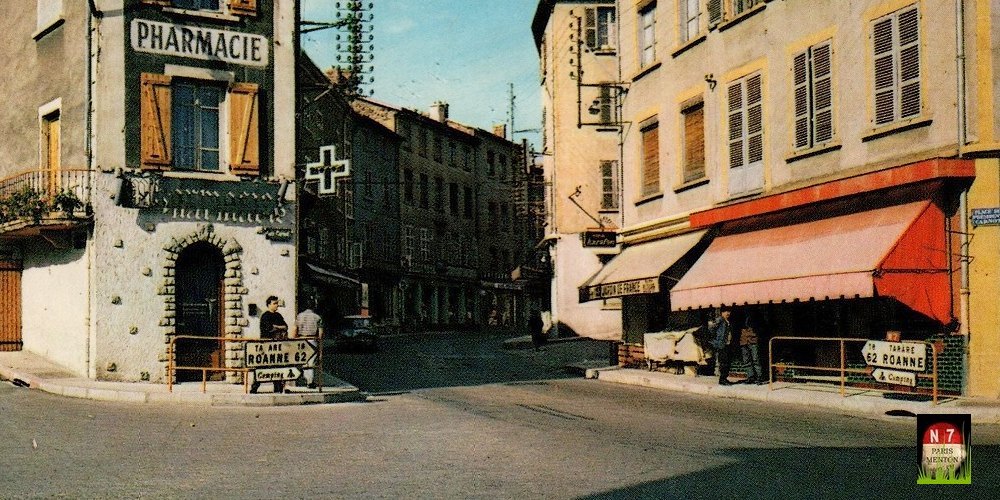

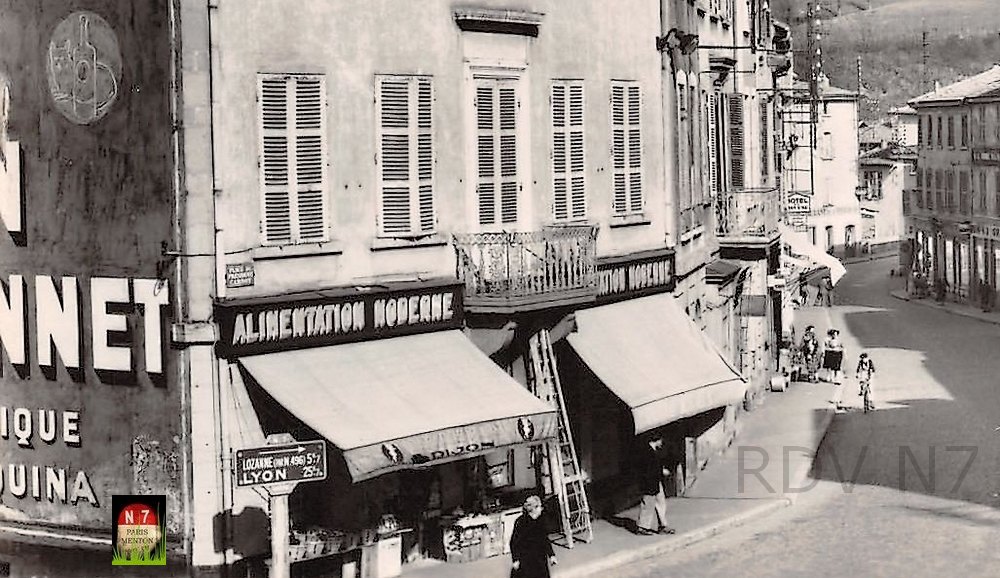
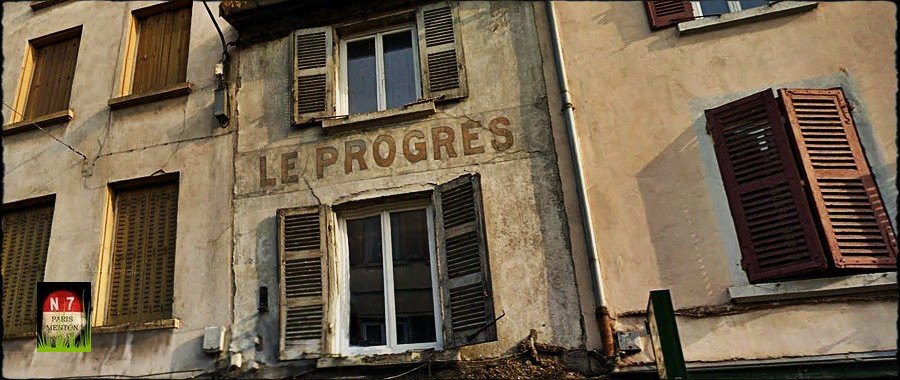


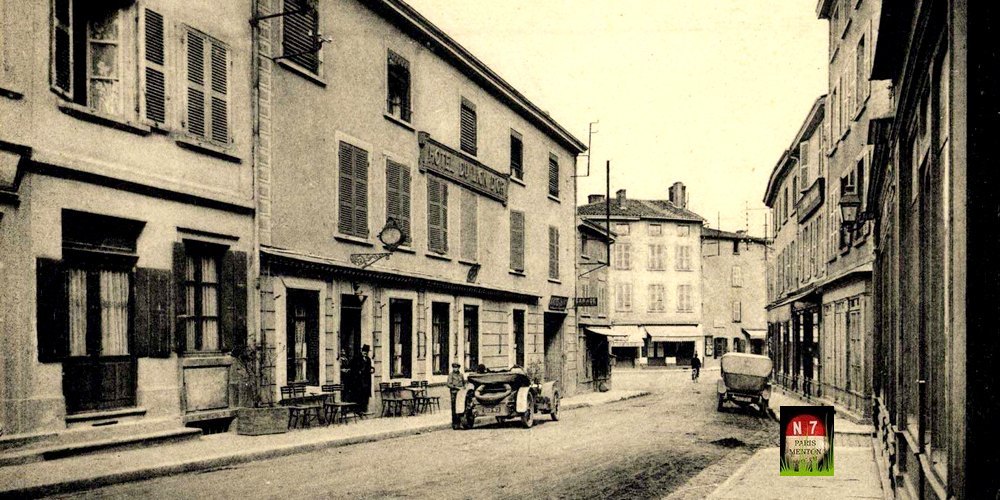
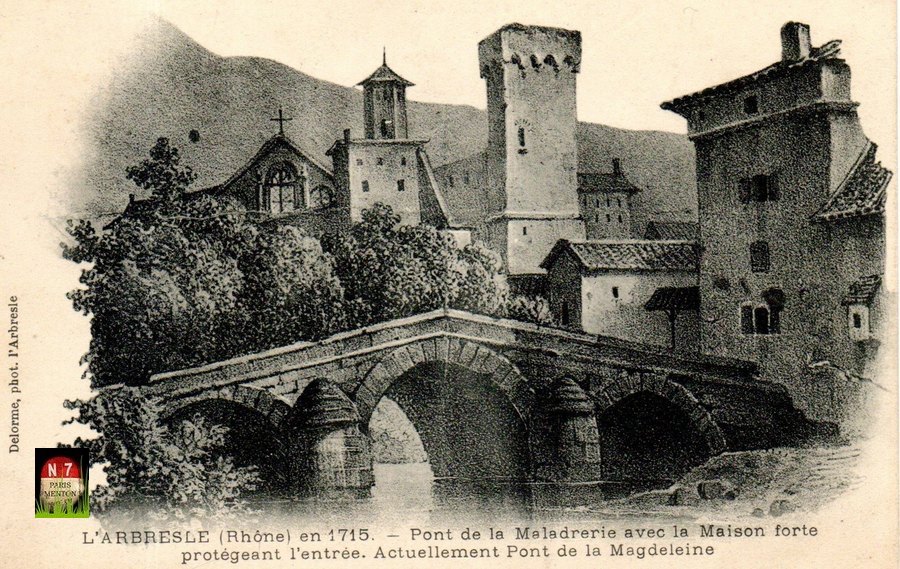

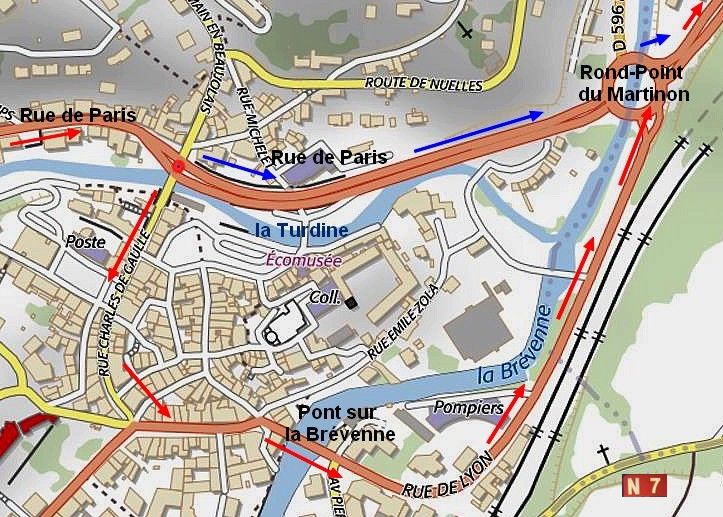
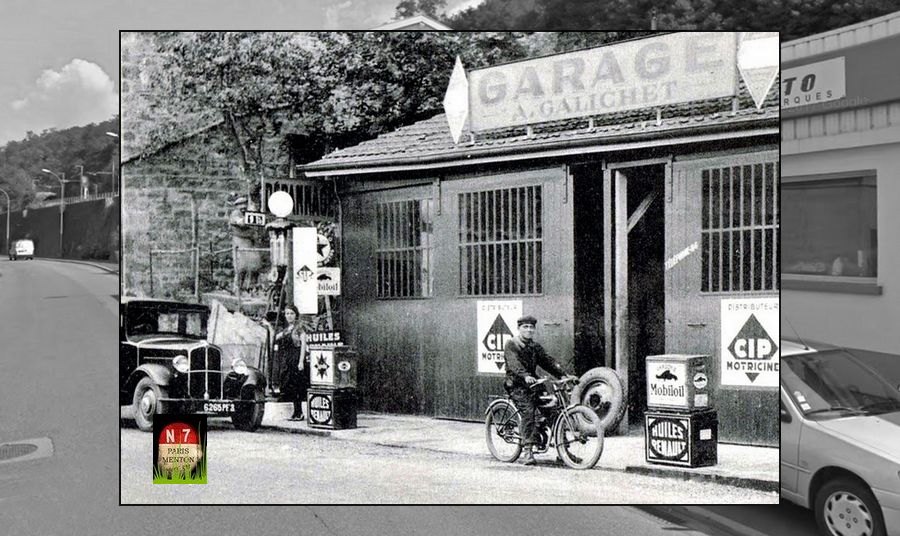
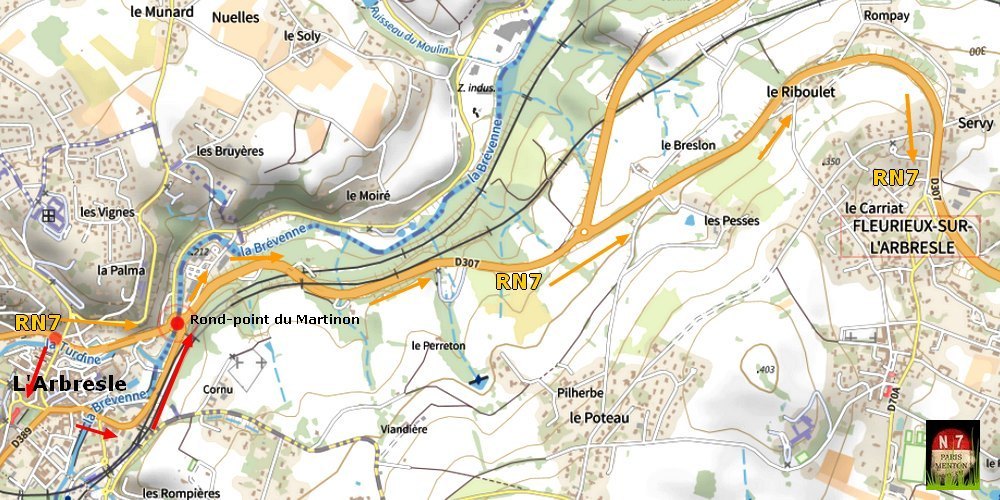

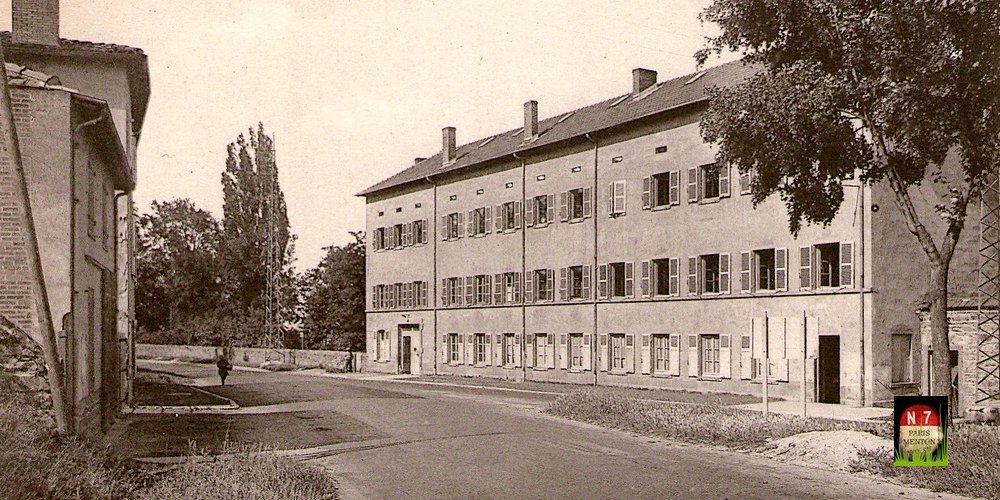



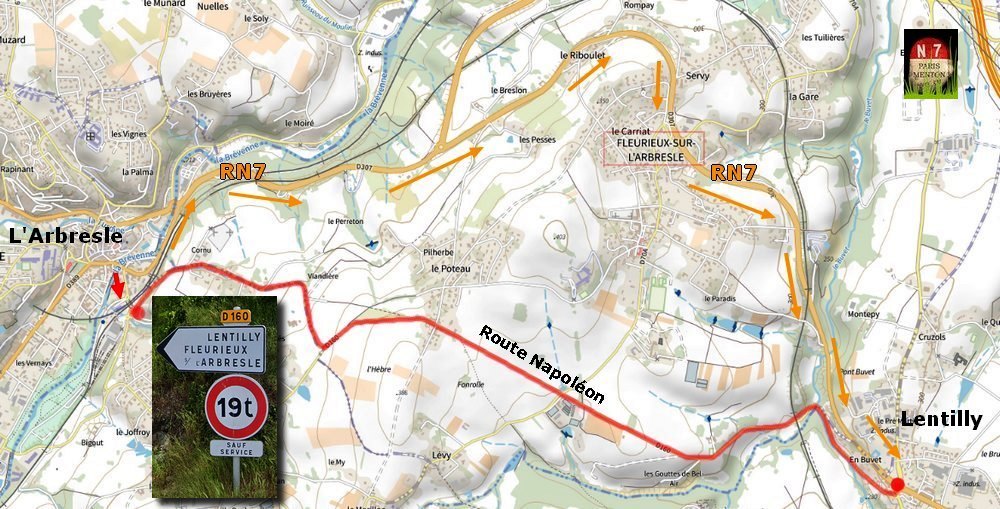
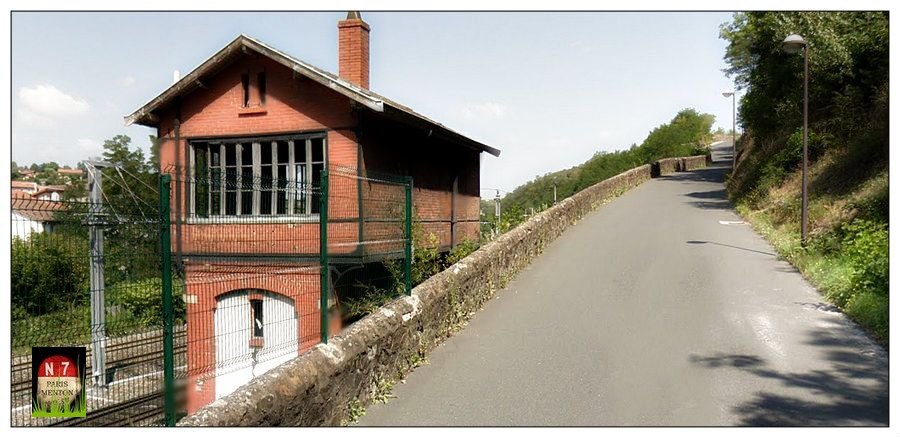





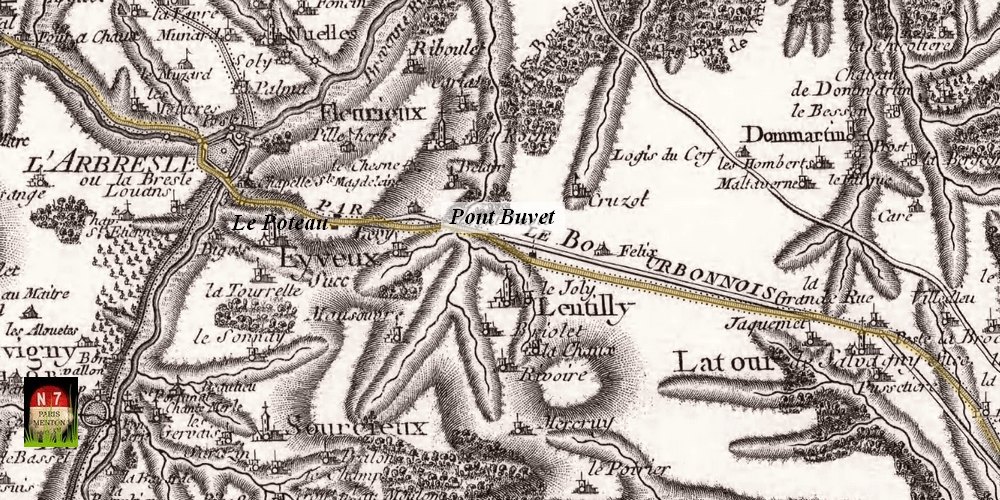
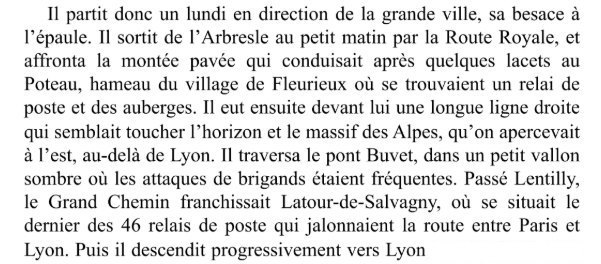

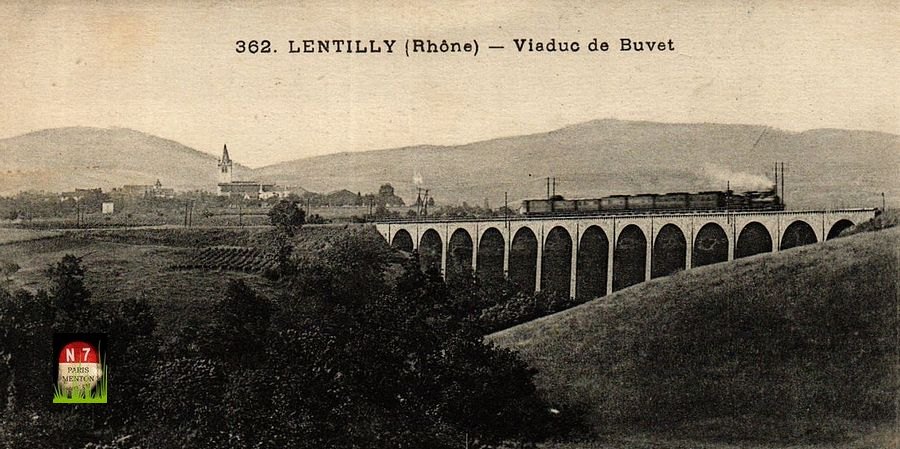

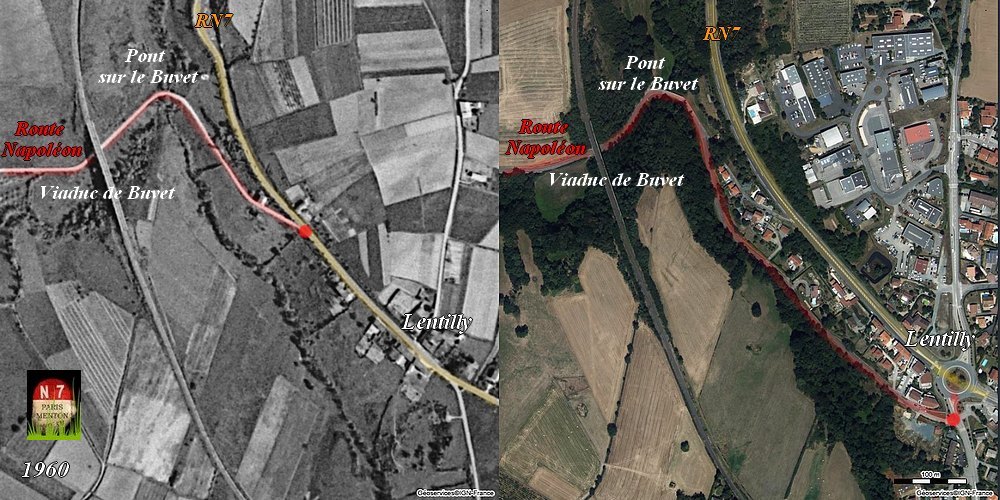
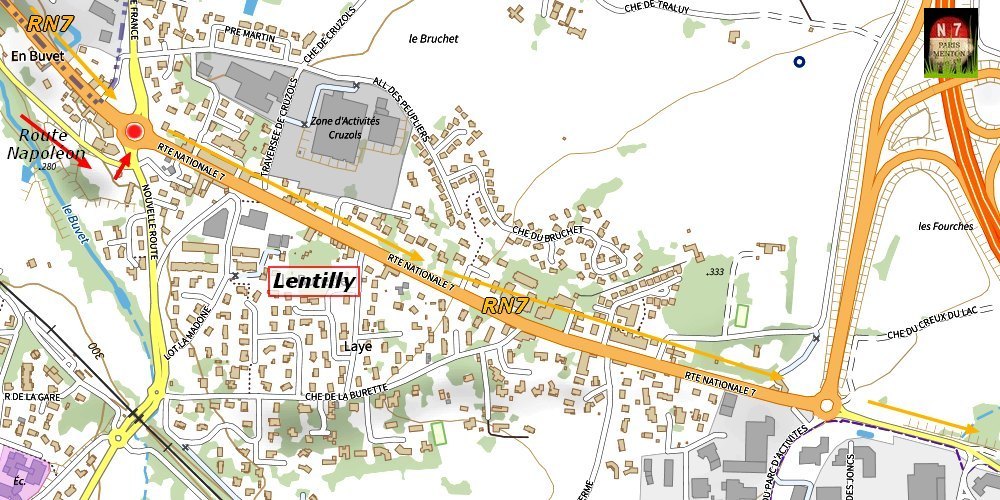





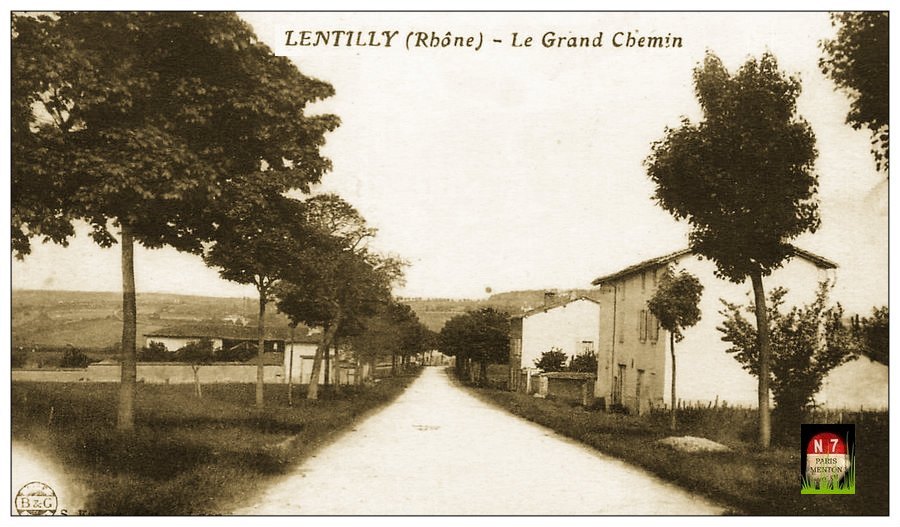





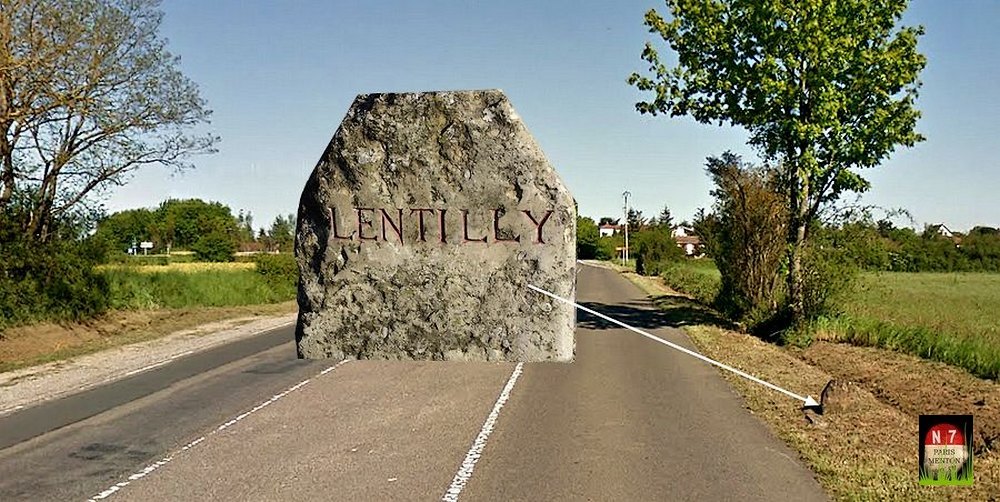
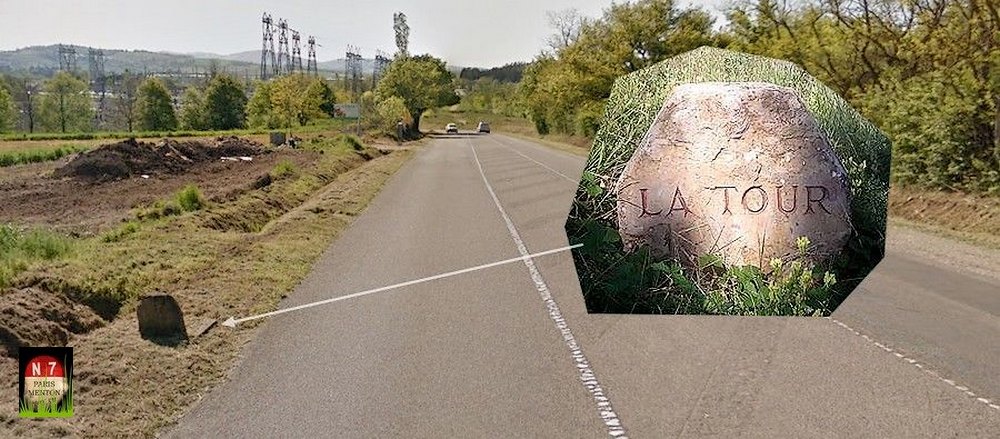


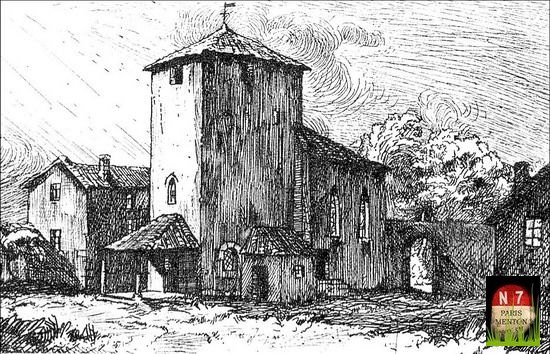
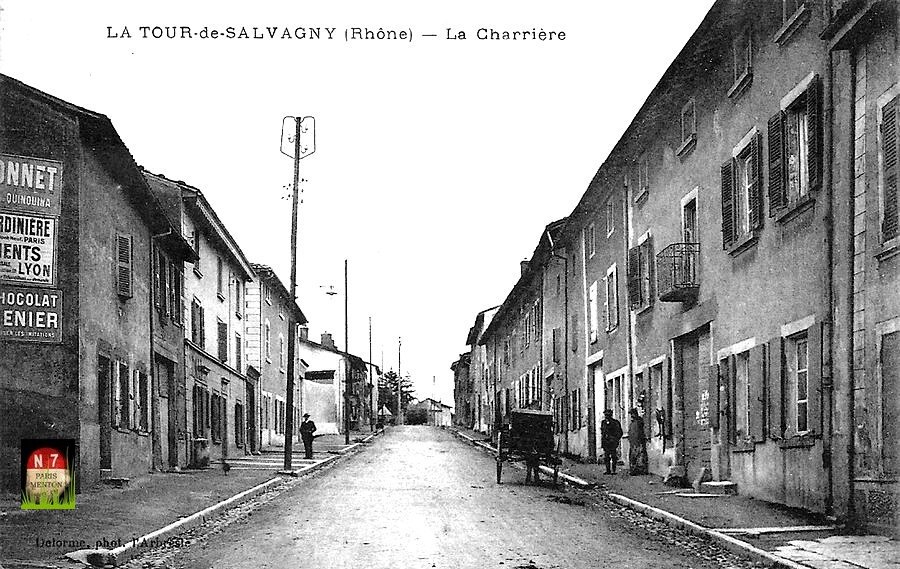
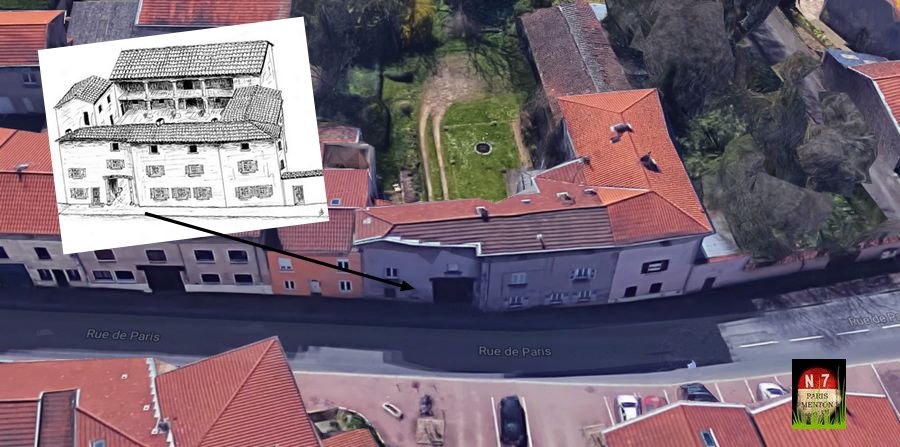

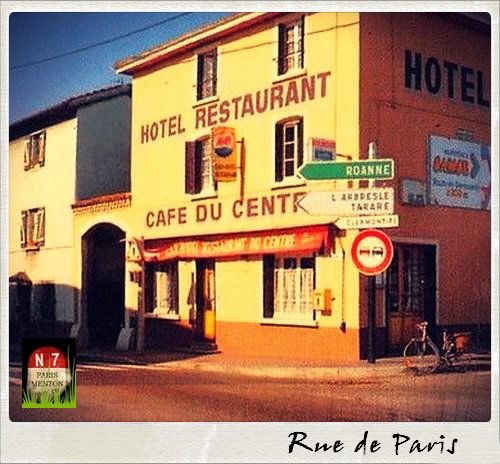
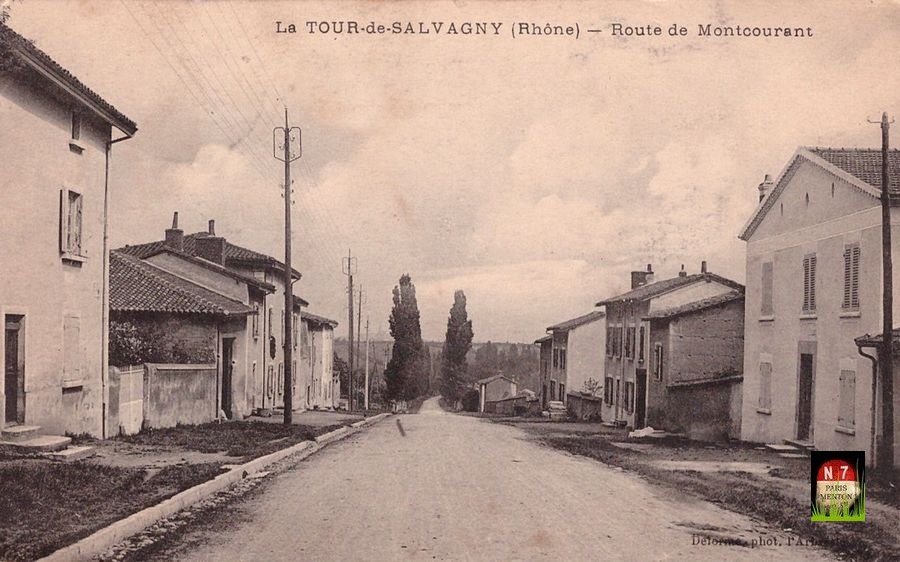

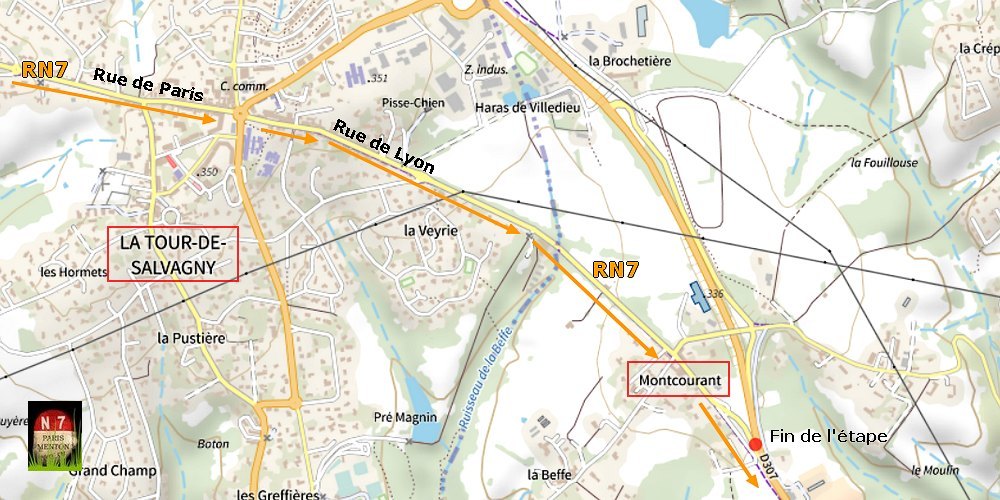



 .
.