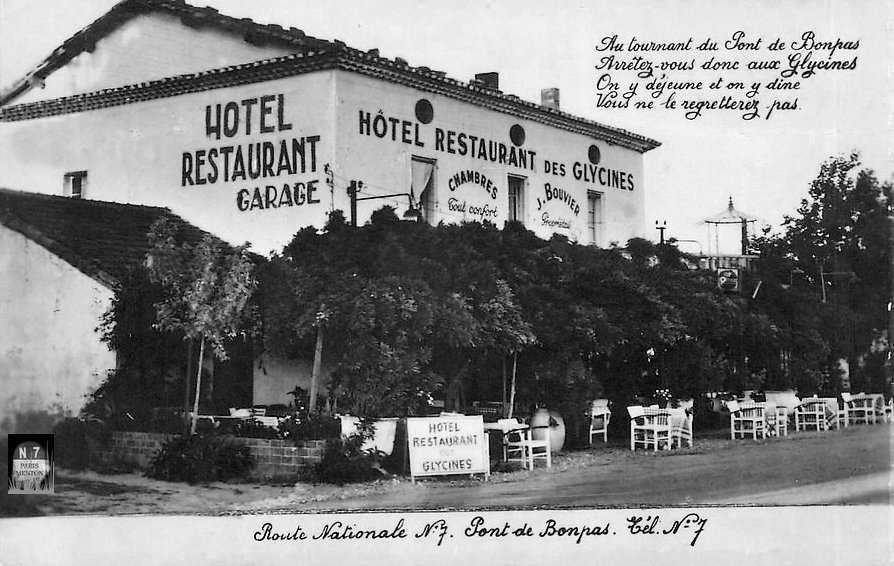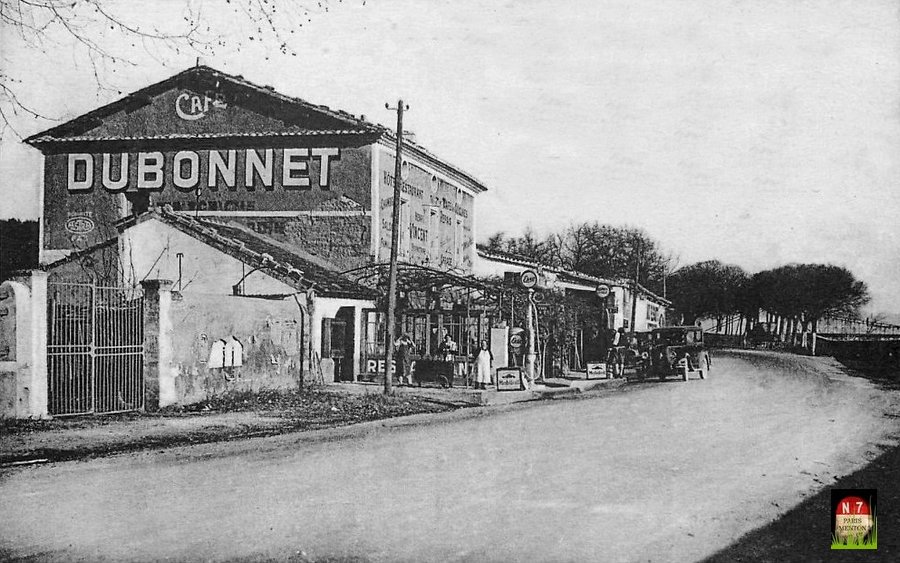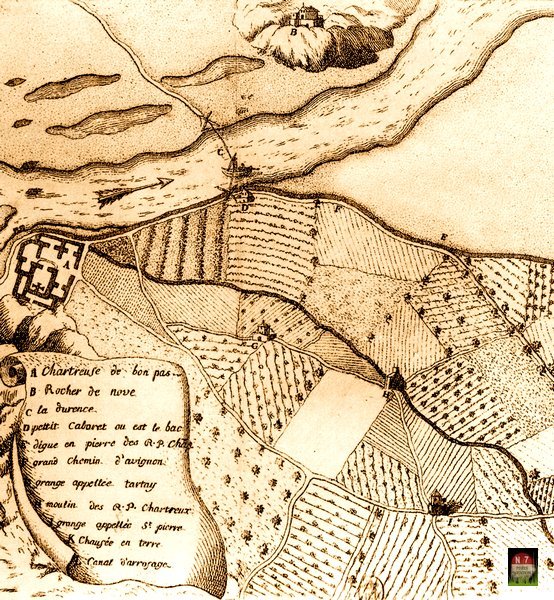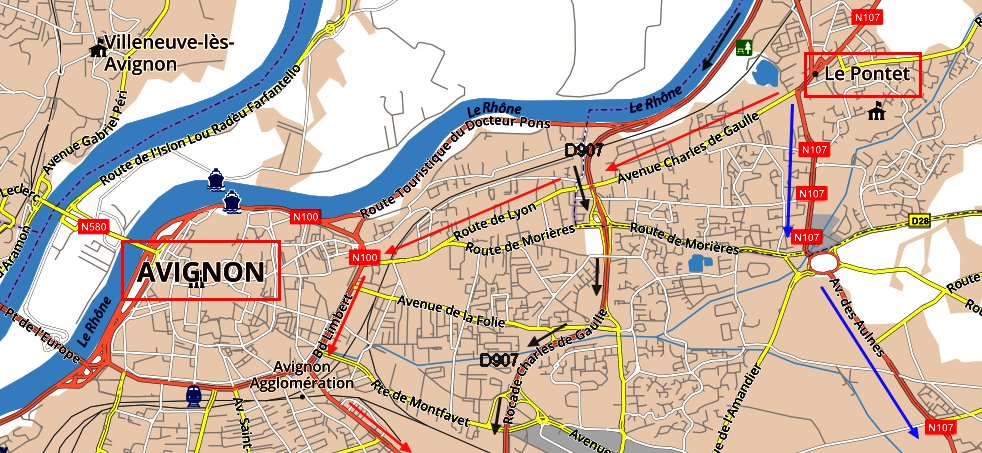
Flèches rouges : ancienne RN7. Flèches noires :
actuelle RN7 /D907. Flèches bleues : RN 107 alternative au
tracé N7.
La limite entre Le Pontet et Avignon se situe sous le
pont, sur lequel passe la rocade D907 que nous avions abandonnée
avant Sorgues pour découvrir le tracé original de la
route. 

Avignon fut fondée par les Phocéens de
Massalia vers 539 av. J.-C.
L'Auenion du Ier siècle av. J.-C. s'est latinisé en
Avennio (ou Avenio), pour s'écrire ensuite Avinhon en graphie
occitane classique ou Avignoun en graphie mistralienne.
Ce thème serait un hydronyme, c'est-à-dire une appellation
liée au fleuve Rhône. (source wipédia)
Nous voici donc Route de Lyon à Avignon.

La capitale des Côtes du Rhône, comme elle se surnomme,
est pour l'instant dans la continuité directe de l'avenue du
Général de Gaulle au Pontet.
Derrières d'immeubles crasseux, stations service en ruine ou
transformées en dépôts vente, supermarchés
discount et autres réjouissances visuelles, parfois dignes
d'un polar noir...
J'aime assez ces décors qui nous laissent entrevoir les souvenirs
du passé. Tout juste ont-ils besoin d'un peu d'imagination
pour reprendre vie...

Route de Lyon, ambiance très Polar Noir.
A chaque instant on s'attend à voir surgir l'ombre d'un commissaire
Maigret blasé,
ou celle d'un Gil Jourdan en planque.

Ancienne entrée du site EDF/GDF. Aujourd'hui le site reconverti
en résidence de standing a conservé son portail d'entrée.

Curiosité architecturale...
Depuis quelques années, on assiste à un
renouveau des quartiers.
Les promoteurs sont en marche et font table rase des vielles bâtisses
encore pleines de fantômes.
La municipalité se lance dans un vaste plan de renouvellement
urbain et utilise désormais le jargon nébuleux que seuls
les cabinets d'urbanistes-designers sont à même de déchiffrer.
Au programme : réflexion globale et enjeux urbains, restructuration
des équipements, requalification des espaces, dynamique globale
de territoire, espaces de centralités...blablabla aux résultats
hélas pas toujours convaincants.
Bref, à Avignon, les quartiers d'entrée de ville font
peau neuve !
Après le pont SNCF, les murs de la cité
papale apparaissent enfin. 

Voici donc Avignon intra-muros. Face à nous la
porte de l'université.
Avignon Km 0689
Si vous n'êtes jamais passé par Avignon,
vous en avez pourtant forcément entendu parler.
En partie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité
est dotée d'un très riche passé historique et
culturel, jugez plutôt : entre le pont sur lequel on danse tous
en rond depuis notre plus tendre enfance, le centre historique comprenant
le palais des Papes, les remparts du XIVe siècles et le festival
considéré comme la plus importante manifestation de
théâtre et de spectacle vivant au monde, vous l'aurez
compris, la ville mérite qu'on lui consacre une étape
à elle seule.
Mais ce serait nous éloigner fortement de notre
thème préféré, la nationale 7.
Je vous laisse donc le soin d'organiser par vous même cette
étape hautement multi-culturelle, selon vos goûts et
vos envies.
Contentons nous ici de survoler quelques points, histoire tout de
même, de ne pas paraître trop inculte lors d'une causerie
sur le sujet. N'est-ce pas !!!

Avignon, le pont, les remparts et le palais des papes.
Aouen ??? locution bretonne ou terrible
dilemme ?
Faut-il dire "à ", ou "en"
Avignon, comme certains le prétendent ?
À l’origine, la locution "en Avignon" désignait
l’État pontifical d’Avignon qui fut rattaché
à la France en 1791.
Jusqu’à la Révolution, on résidait donc
"en Avignon" comme on pouvait résider en Provence.
l’Académie française ne condamne pas la tournure
"en Avignon" , mais elle en reconnaît le caractère
archaïque et régional.
Elle précise que l’emploi de la préposition "en"
devant les noms de ville est en régression, et ne saurait s’appliquer
à d’autres villes.
Par ailleurs, la ville d’Avignon indique sur son site Internet
qu’il convient d’utiliser la préposition "
à " devant son nom.
Alors vous voyez ? question causerie vous ne serez pas à court
d'argument.

Le Pont Saint Bénezet. Peinture d'Isidore Dagnan, musée
Calvet Avignon.
Sur le pont d'Avignon, on y danse...
Le Pont Saint Benezet, plus connu sous le nom de Pont
d’Avignon, est une véritable prouesse technique !
Édifié à partir du 12e siècle, il reliait
autrefois les deux rives du Rhône.
Porteur de légendes, monument emblématique du territoire,
il ne conserve aujourd’hui que 4 arches sur les 22 d’origine.
Cette bizarrerie architecturale qui suscite beaucoup d’interrogations
et d’interprétations plus fantasques les unes que les
autres, a accentué l’aura de ce pont, célèbre
dans le monde entier grâce à la chanson « sur le
pont d’Avignon ».
Bien que classé au patrimoine Mondial par l’Unesco, il
est réellement permis de danser dessus !
Justement sur le pont depuis quand y danse-t-on ?
Cette ronde mimée, remonterait au XVe siècle.
Mais personne n'en connaît vraiment l'origine, ni l'auteur.
L’air de la comptine, sous sa forme actuelle, apparaît
en 1853 dans l’opérette d’Adolphe Adam intitulée
'l’Auberge Pleine'.
Le succès international vient quelques années après
avec une autre opérette, lancée en 1876, qui s’appelait
finalement 'Sur le Pont d’Avignon'.
Les danses se faisaient à l'origine sur les berges, c'est
pourquoi certains anciens parlent encore de la chanson en disant "sous
le pont d'Avignon" et non pas "sur le pont".
Ce n'est pas une chanson finie, ce qui peut expliquer le grand nombre
de variantes qui existent. Ainsi, tous les métiers de l'époque
peuvent être représentés dans la ronde.
Le pont n'est hélas pas sur la route nationale 7, mais il
est tout de même possible de s'y rendre en voiture, en empruntant
les boulevards qui longent les remparts de la ville.

Le Palais des Papes, intra-muros. Aujourd'hui impossible de se
garer sur l'esplanade rendue intégralement aux piétons.
Le palais des Papes
Avant l’installation de la papauté, un patrimoine existait
: une centaine de maisons fortes, crénelées, dominées
par la cathédrale Notre-Dame des Doms, caractéristique
du roman provençal et enfermées dans de forts remparts,
avec à l’extérieur, des couvents de grands ordres
masculins (prêcheurs, cordeliers, carmes, augustins), et sur
le Rhône impétueux et violent, un pont à 22 arches,
le seul édifié entre Lyon et la mer, construit par le
petit pâtre Bénézet à la fin du XIIe siècle.
Lorsqu’Avignon devient le centre de la Chrétienté,
la ville offre un lieu de séjour très commode pour les
pontifes successifs.
S’élève alors la masse imposante d’un des
plus beaux édifices d’Europe, "la plus forte maison
du monde "(Froissart), le Palais des papes : œuvre d’architectes
français, mais décoré en grande partie par des
peintres italiens, de l’illustre Ecole Siennoise du Trecento,
avec à leur tête, Matteo Giovannetti, de Viterbe.
L’essor démographique est énorme : de 8000 âmes
environ, la Cité devient une ville de près de 80 000
habitants.
Cour pontificale, clergé, noblesse, banquiers et marchands
s’installent et construisent.
Livrées cardinalices, églises, couvents, s’édifient
au gré des ruelles tortueuses, l’aspect urbain et architectural
se modifie.
De nouveaux remparts sont construits, constituant l’une des
plus belles lignes de fortifications médiévales d’Europe.
https://avignon-tourisme.com
http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/patrimoine/
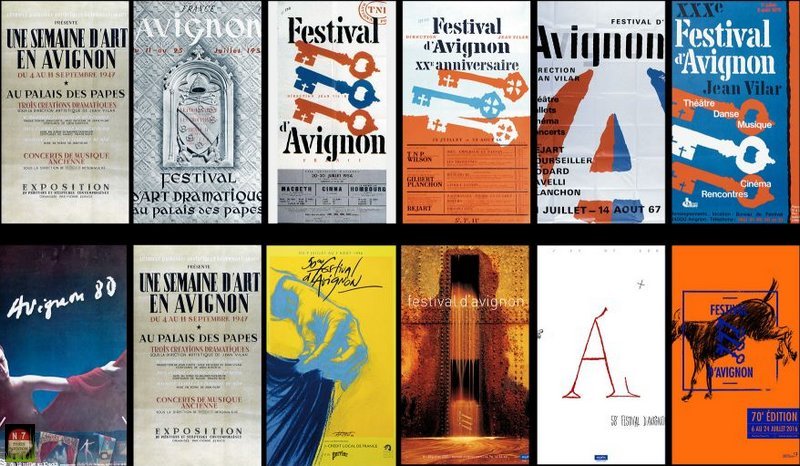
Le Festival d'Avignon
Fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d'Avignon est aujourd'hui
l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle
vivant contemporain.
Chaque année, en juillet, Avignon devient une ville-théâtre,
transformant son patrimoine architectural en divers lieux de représentation,
majestueux ou étonnants, accueillant des dizaines de milliers
d'amoureux du théâtre de toutes les générations.
http://www.festival-avignon.com/fr/
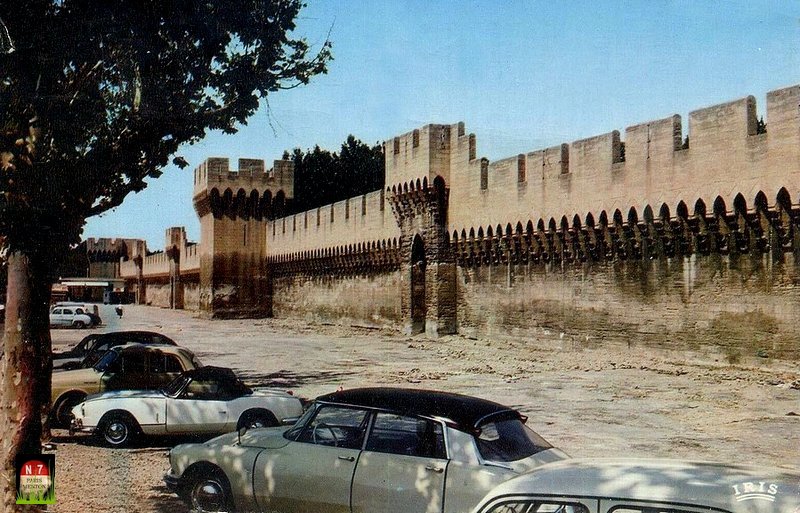
Mal entretenus, plusieurs fois menacés de destruction par
les municipalités de l'époque,
les remparts au cours du XIXe siècle furent sauvés par
la campagne menée par Prosper Mérimée (1847)
, alors inspecteur général des Monuments historiques.
En 1860, les travaux de restauration seront confié à
Viollet-le-Duc.
Les Remparts
Même si l'absence des fossés, des tours
à pont-levis, des portes de bois bardées de fer altère
sa physionomie initiale, ils offrent un témoignage saisissant
des entreprises de fortifications du XIVe siècle en France.
Depuis l'époque romaine, au cours des années et des
aléas historiques, le périmètre de la ville s'est
progressivement étendu et ses protections furent successivement
modifiées.
Avignon eut donc plusieurs remparts différents au cours de
son histoire.
Avec l'arrivée des papes, l'agglomération
s'est rapidement agrandie et de nouveaux bourgs se formèrent
à l'extérieur des murs.
Le pape Innocent VI commence en 1355 la construction d'une nouvelle
muraille protectrice qui englobera les nouveaux édifices. C'est
le rempart actuel.
La totalité de son périmètre est de 4.330 mètres,
délimitant une surface de 151 hectares 71 ares, trois fois
et demi supérieure à la superficie que limitait l'ancien
rempart.
Un large fossé profond de quatre mètres,
alimenté par les eaux de la Sorgue et de la Durançole
en défendait l’accès.
Les sept portes de la ville, munies de ventaux de bois bardés
de fer, que l'on fermait le soir, étaient commandées
par des tours précédées de pont-levis, auxquels
s'ajoutaient des herses par mesure de protection supplémentaire.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remparts_d%27Avignon#Projets_de_démolition_au_XIXe_siècle
https://www.avignon-et-provence.com/monuments/remparts-davignon
https://journals.openedition.org/ceroart/2927
Je ne voudrais pas vous presser... mais nous avons une
étape à terminer.
En route -
Notre route ne pénètre pas dans la cité
des Papes.
Elle se contente de longer une partie des remparts ouest, de la porte
de l'Université, anciennement porte de l’Hôpital
Sainte Marthe, à la porte Limbert. 
700 mètres d'un large boulevard aujourd'hui à
double voies, coincé entre les remparts rénovés
et l'ancienne caserne Chabran, inaugurée en 1906, pour accueillir
à l'origine le 7em régiment de Génie.
Aujourd'hui la caserne est réhabilitée en cité
administrative. Le quartier à fait peau neuve, classement UNESCO
oblige.
https://lachezleswatts.com/fr/articles/11/84000-avignon/la-prefecture-du-vaucluse-une-ancienne-caserne
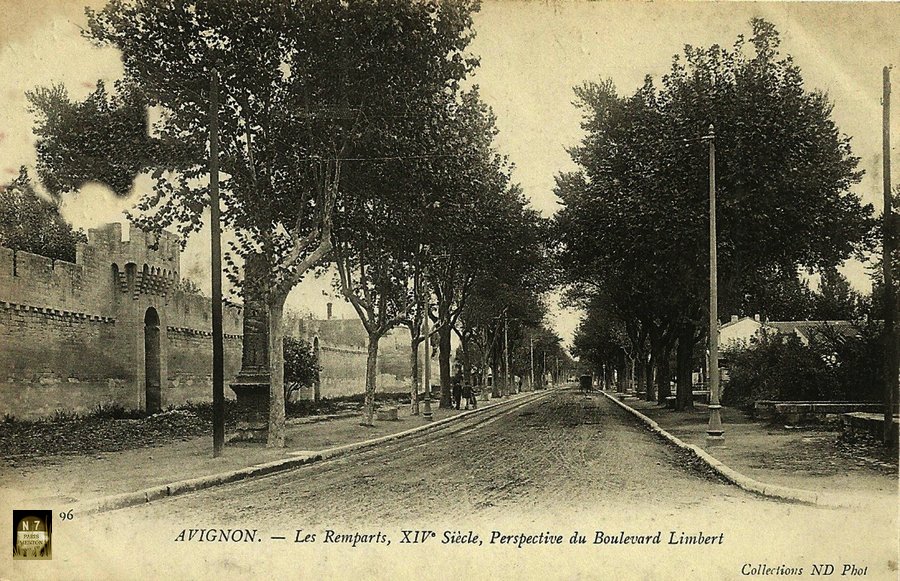
Vue en direction de Lyon. Le Boulevard Limbert. Image réactive.
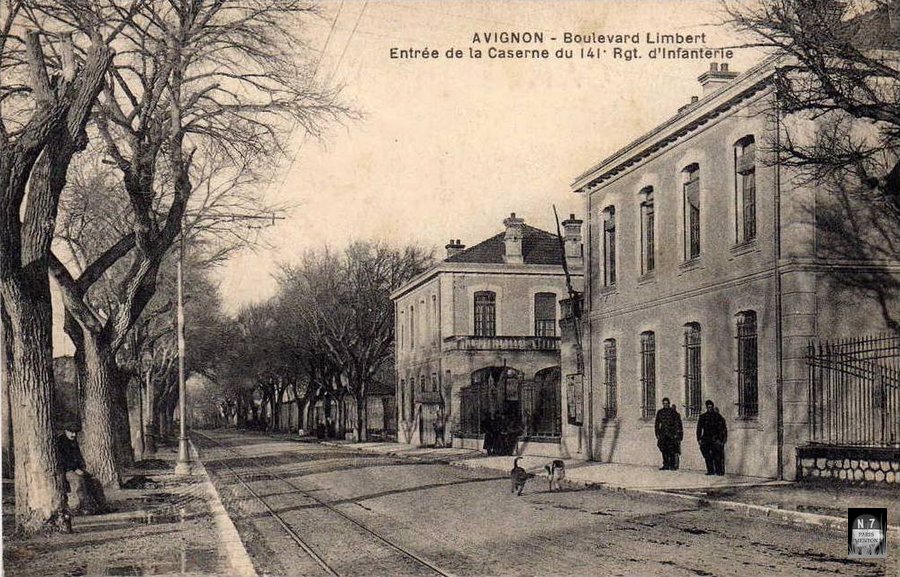
Toujours vue en direction de Lyon, le Boulevard Limbert et la caserne
Chabran. Image réactive.
Juste devant la Porte Limbert, il nous faut prendre
la direction de Cavaillon et Aix en Provence sur la gauche, par l'avenue
Pierre Semard, copie conforme de la route de Lyon... faubourgs populaires
et cités ouvrières.

Une étonnante cathédrale se dresse soudain
sur notre gauche. 
Une gigantesque arène de béton, tout droit issue de
la révolution industrielle du XIXe siècle.
Il s'agit de la rotonde ferroviaire d'Avignon.
Un dépôt, desservi par une plate-forme tournante, qui
permettait de remiser les locomotives sur des voies de garage, pour
la réparation ou simplement l'entretien des machines à
vapeurs.
En 1885, deux rotondes sont construites sur le site
de Fontcouverte à proximité de la gare de triage de
la ville d'Avignon.
Dès lors, ces installations ne vont cesser de s'agrandir.
Avec ses parcs découverts, ses ponts tournants, ses places
de garages et ses voies de remisage, le dépôt Avignonnais,
devient le plus important dépôt ferroviaire du Sud Est
de la France.
A son apogée, avant la guerre, le site emploie près
de 1500 cheminots qui s'occupent de plus de 200 machines.
Durant la seconde guerre mondiale,
Après la seconde Guerre mondiale, la SNCF reconstruit
son patrimoine immobilier détruit.
La rotonde d'Avignon fait partie d'un ensemble de 19 remises à
locomotives reconstruites entre 1946 et 1952 par le service des bâtiments
de la SNCF dirigé par Paul Peirani.
La conception de ces rotondes a été confiée
à Bernard Lafaille.
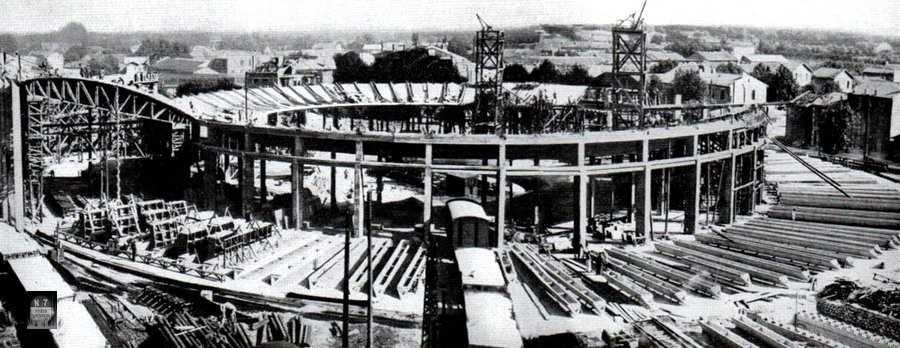
Construction de la nouvelle rotonde d'Avignon. 1946.
Construite en 1946, la rotonde mesure 107 mètres de diamètre.
Depuis 1984, elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques.
Source et extraits :
https://rail-en-vaucluse.blog4ever.com/le-depot-d-avignon
https://monumentum.fr/rotonde-sncf-pa00081944.html
https://autrecarnetdejimidi.wordpress.com/2015/08/16/rotonde-ferroviaire-davignon-bernard-laffaille-1947/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotonde_ferroviaire_d%27Avignon
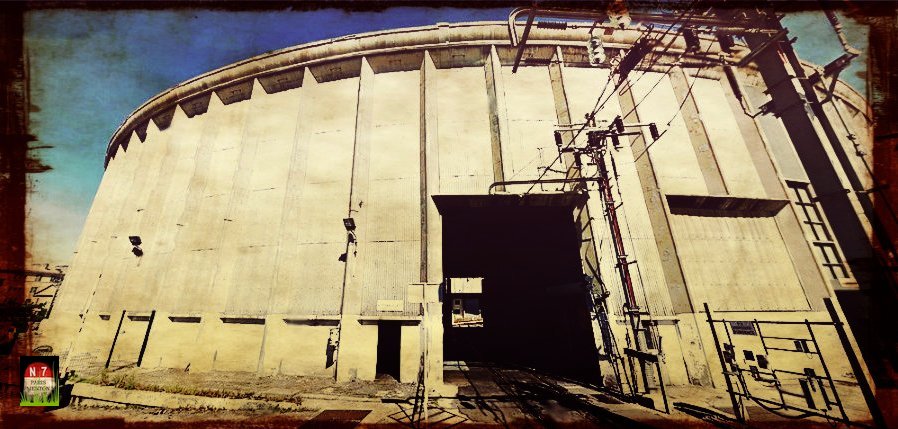
La rotonde accueille aujourd'hui 3 locomotives préservées
par l'association pour la préservation de la CC6570. APCC
En route -
Plus loin, nous croisons une nouvelle fois la rocade D907 (également
repérée N7R), qui termine ici son contournement d'agglomération
et rejoint la N7 qui file tout droit sur 2x2 voies, au milieu des
complexes géants en tous genres, qu'ils soient commerciaux,
sportifs, cinématographiques hôteliers ou aquatiques
...

Par endroit, une maison ou un mur ont été préservés
de la frénésie des promoteurs immobiliers. Image réactive.

La route nationale 7 typique, au sortir d'Avignon vers 1935.
Une chose est sûre, ici, le décor actuel
n'a plus rien à voir avec la route des vacances d'autrefois.
A partir de 1968, dès l'apparition des premiers supermarchés
sur les bas-côtés de la chaussée, la route va
s'adapter au trafic automobile devenu de plus en plus important.
L'élargissement nécessaire de la chaussée entre
Avignon et Bonpas va exiger l'arrachement de quelques 500 platanes
sur la Nationale 7, événement dont vont s'emparer les
journaux de l'époque.

1968 Provence Actualité. Cliquez sur l'image.

Château d'eau dans un style néo-gothique. Image réactive.

Au rond-point de Cantarel, la RN7 retrouve la RN107
(RN7F), raccourci en provenance du Pontet, permettant d'éviter
le centre d'Avignon.
, 
Sur la gauche, un long bâtiment que l'on devine
très ancien, avec son portail surmonté d'armoiries,
abrite aujourd'hui un restaurant mais aussi une brocante, si l'on
s'en réfère à l'enseigne moderne et à
ce qui est inscrit sur le mur.
Il s'agit, comme il est encore gravé sur le fronton du portail,
de l'usine de Cantarel, la célèbre fabrique de réglisse.

Même point de vue de l'usine de Cantarel. Si le bâtiment
n'a pas changé, ce n'est pas le cas de la route nationale 7.
Image réactive.
C'est en 1854 que Paul Florent achète une fabrique
de jus de réglisse installée dans un local d'une petite
auberge située à Cantarel, tout prés d'Avignon,
sur la route de Marseille.
En 1870, il transforme complètement l'industrie de la réglisse
en fabriquant non plus du jus mais des pastilles parfumées
à la menthe, vanille, violette ou anis.
Pour fabriquer ces nouvelles pastilles, il fait construire une usine
selon ses propres plans et y installe les machines construites d'après
ses données personnelles.
La Réglisserie Florent a cessé son activité en
novembre 1975 suite à sa fusion avec le groupe Ricqlès-Zan.
La construction d'une cité ouvrière à l'intérieur
même de l'usine permettait à bon nombre de familles de
loger sur le lieu même de leur travail.
https://avignon-tourisme.com/activites/ancienne-reglisserie-florent/
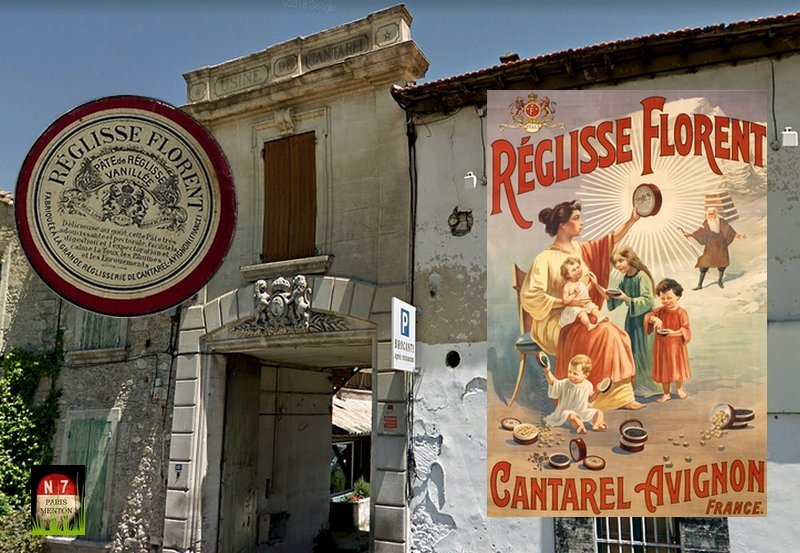
Le portail de l'usine de Cantarel. Sur les boites de pastilles
on retrouvait les armoiries qui ornaient l'entrée de l'usine.

En venant du Sud, l'usine était annoncée quelques mètres
avant.
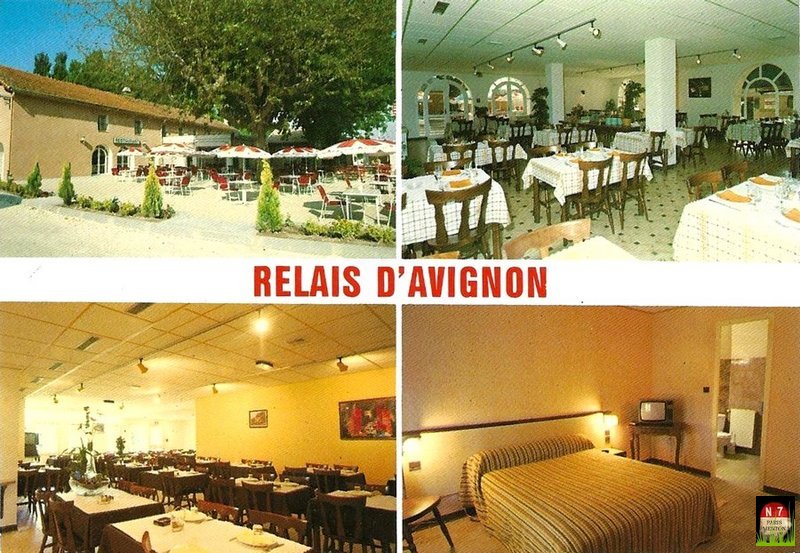
Le Relais
d'Avignon est toujours en activité aujourd'hui...mais rassurez
vous... c'est plus la même déco.. ;-)

C'est en 2001 qu'est inaugurée la ligne du TGV
Méditerranée, qui dessert Avignon.
Pour faire passer ce nouveau réseau ferré grande vitesse,
le tracé de la route nationale 7 est réaménagé
dès 1998.
La route amorce désormais un léger décrochage
vers le sud, pour ensuite longer les rives de la Durance.
Du coup, subsiste encore dans la zone située à proximité
de l'aérodrome, un délaissé de l'ancienne route.
Ce délaissé n'est hélas pas praticable sur la
totalité de sa longueur, puisqu'il est d'une part coupé
par la ligne TGV, et d'autre part il traverse une partie de l'aérodrome.
On peut cependant en parcourir certaines portions. 

En 1955, la route nationale passe encore par le hameau de la Croix
d'Or. On distingue même une station service. Image réactive.
A partir de 1998, le tracé de la route est dévié
vers le sud. Le hameau de la croix d'or devient un délaissé.
La station service, se situe juste sur le passage des voies du TGV.

Mur peint, face à la station service du hameau de La Croix
d'Or. Là où passent aujourd'hui les lignes du TGV.

L'ancienne route, oubliée depuis 1998. Jonction Nord

Hameau de la Croix d'Or, sur l'ancienne route nationale 7.

L'ancienne route, oubliée depuis 1998. Jonction Sud
|
|
Bonpas Km 0700 
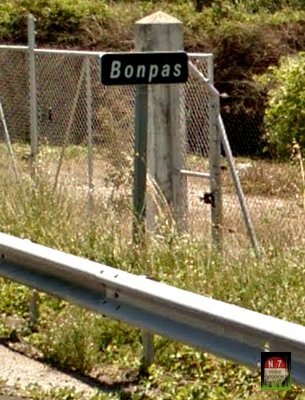
Voici le hameau de Bonpas, dépendant
de la commune de Caumont sur Durance.
Hameau est d'ailleurs un bien grand mot pour à peine
quelques maisons alignées en bordure de route, pour
la plupart d'anciens hôtels-restaurants-routiers.
|
C'est que l'emplacement est stratégique.
Situé juste avant, ou selon la direction, juste après
le pont sur la Durance, à la limite des départements
du Vaucluse et des Bouches du Rhône, c'est ici que se croisent
les routes d'Aix en Provence et de Cavaillon.
A la grande époque de la nationale 7, il n'était pas
rare à l'heure de midi, de rencontrer de longues files de camions
rangés sur les bas côtés de la route ou garés
sur les vastes aires de parking de ces restaurants routiers.
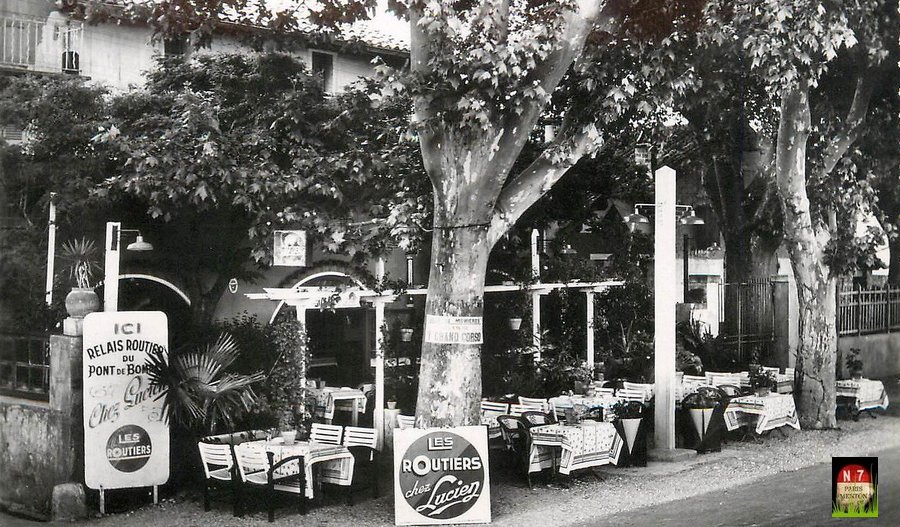 .
.
Comment résister à la charmante terrasse de Chez Lucien,
en bordure de route nationale ?
Comme il devait être agréable le pastis frais sous les
platanes !!

Etape croquignolette, et rafraîchissante Chez Lucien.
Les platanes abattus, une nouvelle terrasse couverte accueille les
touristes . Image réactive
"Ici on mange bien pour 6 Nouveaux francs, vin compris"
... 90 centimes d'euros... une autre époque....
Rendez-vous nationale 7 : Lundi 4 août
1969 - 15h30. Bonpas - Episode 16.
| |
"Chutttt ! Il
y a comme un bruit".. nous dit mon père arborant
son air soucieux. "Tous les oiseaux et tous les bateaux"
chantés par Michel Polnareff à la radio en ont
le sifflet coupé.
Silence complet dans l'habitacle de la petite Opel.
Difficile tout de même d' identifier un hypothétique
cliquetis au milieu du chant strident des cigales. "Vous
n'entendez pas" ???
Devant notre air dubitatif, mon père nous demande de
fermer toutes les vitres de l'automobile.
Au bout de quelques minutes passées l'oreille aux aguets,
nous nous désolons de ne rien entendre, et manifestons
notre très vif désir d'aller boire un verre, après
la grosse suée que nous venons de subir.
Finalement, devant notre insistance, l'Opel se range sur le
bas côté de la route, face à un charmant
petit café à la terrasse ombragée de laquelle,
tout en sirotant notre diabolo menthe, nous pouvons observer
mon père, allongé sous la voiture, toujours à
la recherche de son supposé bruit.
Quelques minutes suffiront pour qu'il vienne enfin nous rejoindre
en terrasse, sa chemisette souillée mais exhibant joyeusement
une petite vis. "On a perdu un boulon, c'est le pot qui
bouge".
Le patron du café, amusé par notre mésaventure,
viendra lui même constater les faits de visu, et proposera
à mon père quelques décimètres de
fil de fer, "histoire que ça tienne le coup jusqu'à
votre arrivée en vacances".
Ahh !! qu'il était doux le temps où les contrôles
techniques n'existaient pas...
|
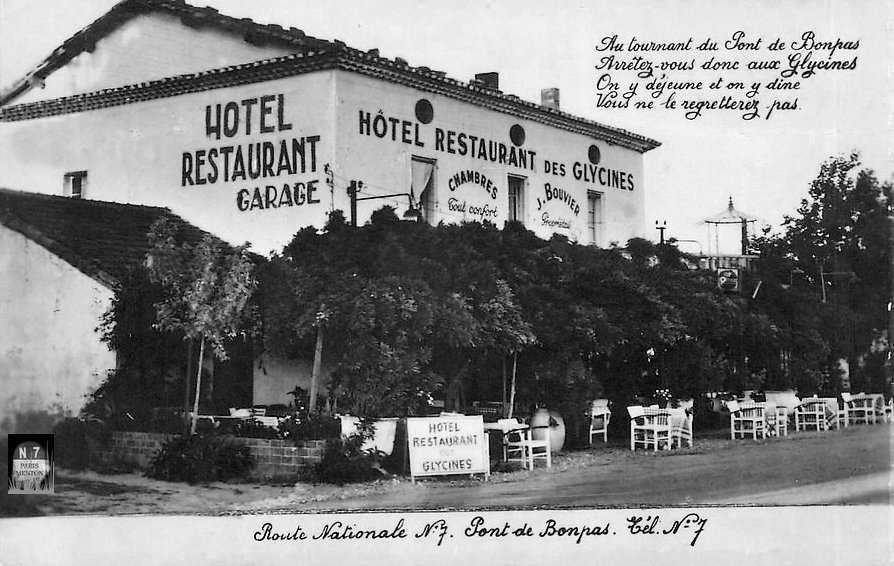
Tout aussi agréable que Chez Lucien, le restaurant des
Glycines, au tournant du Pont de Bonpas. Image réactive
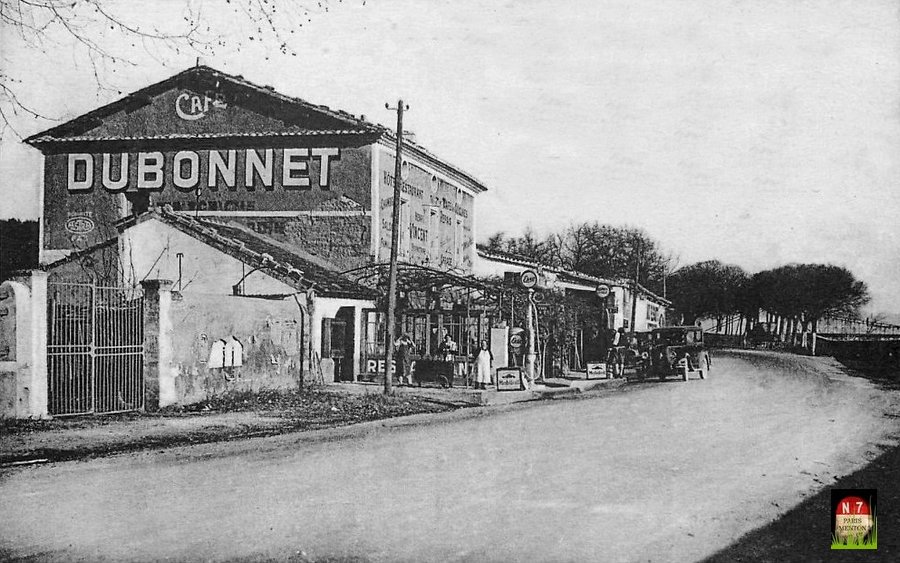
Sur cette autre vue des Glycines, bien antérieure à
la précédente, on aperçoit le pont sur la Durance.
|
|
Il est temps pour nous de traverser
la Durance.
Si l'opération s’avère aujourd'hui d'une
simplicité extrême, voir imperceptible pour peu
que l'on soit distrait, ce ne fut pas toujours le cas.
L'histoire du pont de Bonpas se perd dans la
nuit des temps...
En fait avant 1166, date des premiers documents authentiques
attestant de la présence officielle du pont, il n'existe
que très peu d'archives.
Avant cette date, seuls quelques actes, bulles,
manuscrits ou chartes y font de vagues références.
D'où une certaine confusion sur la nature du pont :
pont de pierre, pont de bois, pont de barque, bac ? difficile
d'y voir clair.
Les historiens s'accordent tout de même sur le lieu
du pont, qui se situait un peu plus en amont, au pied de la
Chartreuse de Bonpas.
Sans doute à l'emplacement de l'actuelle retenue d'eau.
Dès la préhistoire, existait
ici, entre les communes de Caumont et Noves, un passage praticable
à pied.
Un passage à gué, soumis aux eaux capricieuses
et torrentielles de la Durance qui en rendaient la traversée
si périlleuse, que le lieu prit le nom de "malipassus",
le mauvais passage, ou "maupas".
On suppose la présence d'un premier pont
de pierre ou de bois dès l'antiquité, peut-être
était-ce même un pont romain.
Le pont détruit fut en tous cas reconstruit au XIe
siècle par un ordre religieux Hospitalier, les "frères
pontifes" (bâtisseurs de ponts), qui édifièrent
également à proximité du pont, un relais
pour les pèlerins, l'ancêtre de nos relais routiers
en quelque sorte.
Une nouvelle fois emporté par les eaux, le pont ne
sera reconstruit qu'après la révolution.
En attendant, dès 1166, le pont détruit
est remplacé par un bac à trail qui permet le
transport des hommes et des marchandises en toute sécurité.
Toujours placé sous la direction des moines qui y instaurent
un péage, le passage devenu beaucoup moins dangereux
devient alors "Bonipassus", le bon passage ou "bonpas".
Après la révolution, en 1804,
la première pierre des culées d'un nouveau pont
en charpente de mélèze est posée.
Un nouvel ouvrage de près de 550 mètres de long
et de quarante-sept travées enjambe alors la Durance.
Mis en service en 1812, le pont de Bonpas est le premier d'une
longue série de ponts qui, d'Avignon à Pertuis,
vont permettre les liaisons interdépartementales.
Ci-contre, la traversée de la Durance,
par le bac à trail, au pied de la chartreuse de Bonpas.
|

Le pont suspendu Arnodin, inauguré en 1894 et détruit
en 1944.
En 1886, une nouvelle crue arrache neuf arches du pont
de bois.
L'ingénieur entrepreneur Arnodin, qui restaure alors le pont
suspendu d'Avignon, remplace la section emportée par une travée
unique de 103,65 m de longueur, montée sur pylônes en
bois.
Mais le pont en bois reste fragile face aux crues du gigantesque torrent.
La décision de faire édifier un pont suspendu
est adoptée.
Ce pont de « type Arnodin » est inauguré en 1894.
Situé une centaine de mètres en aval de l'ancien pont
de bois, il mesure 520 mètres de long et repose sur quatre
travées.
Le pont suspendu sera détruit en août 1944
par les armées allemandes en retraite.
Reconstruit en 1954, la traversée de la rivière se fait
sur un nouveau pont de 500 mètres de long soutenu par douze
arches.
En 1969, le pont routier sera doublé d'un pont autoroutier
situé plus en amont.
L'entrée du pont de Bonpas marque pour nous la
fin de cette étape. 
Nous voila à 700 km de Paris.

Fin de l'étape




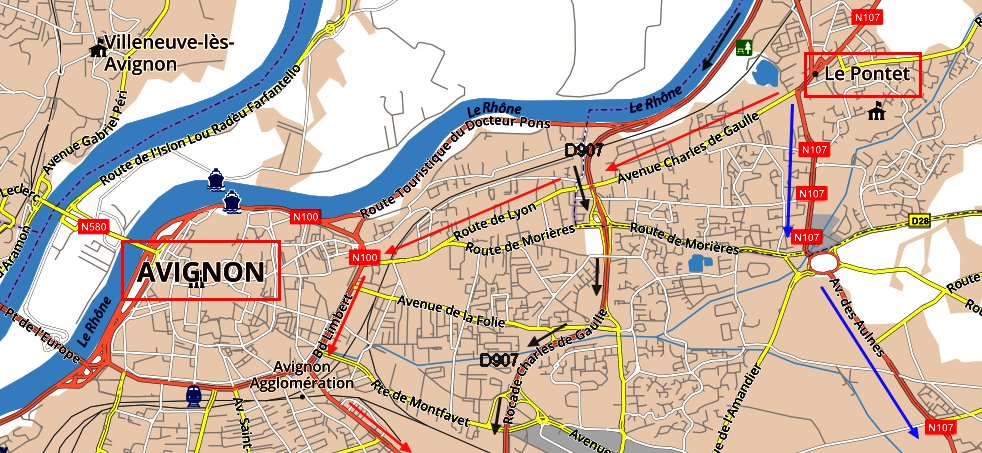









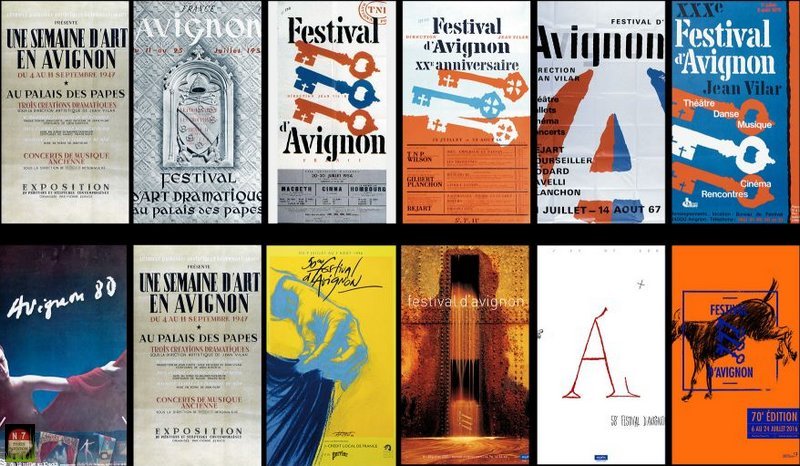
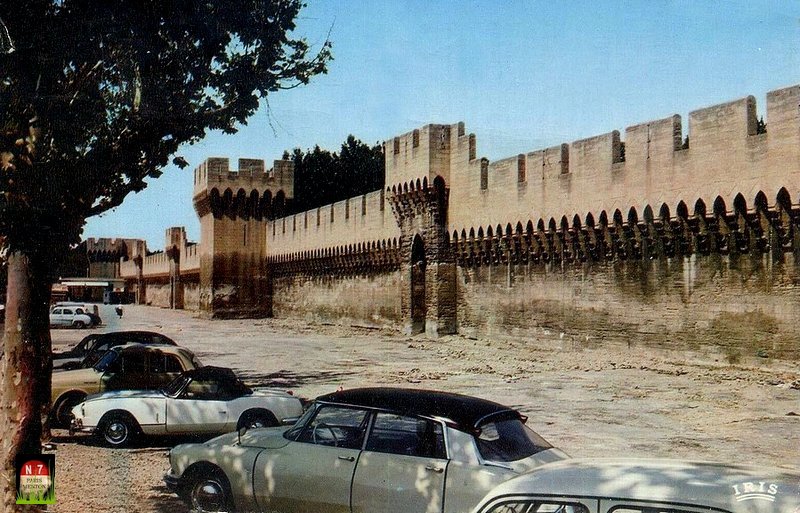
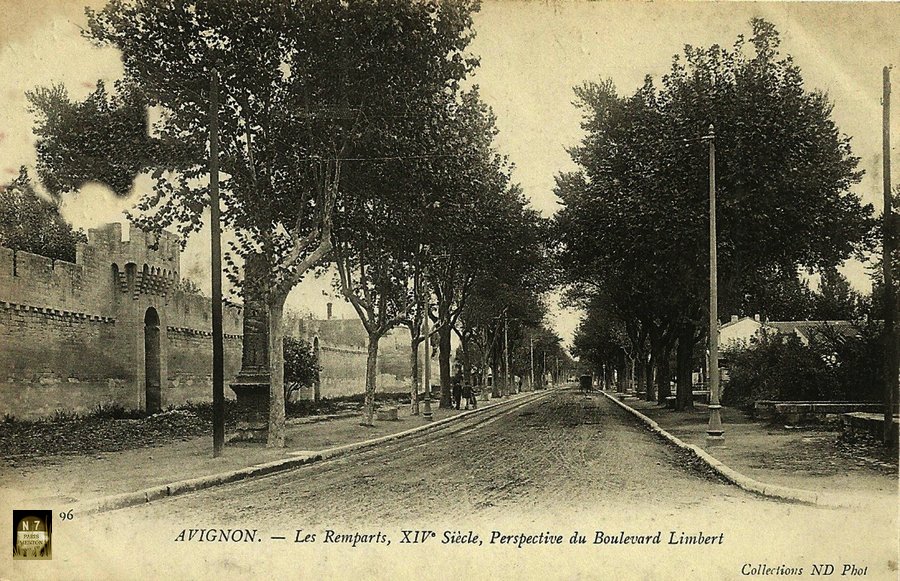
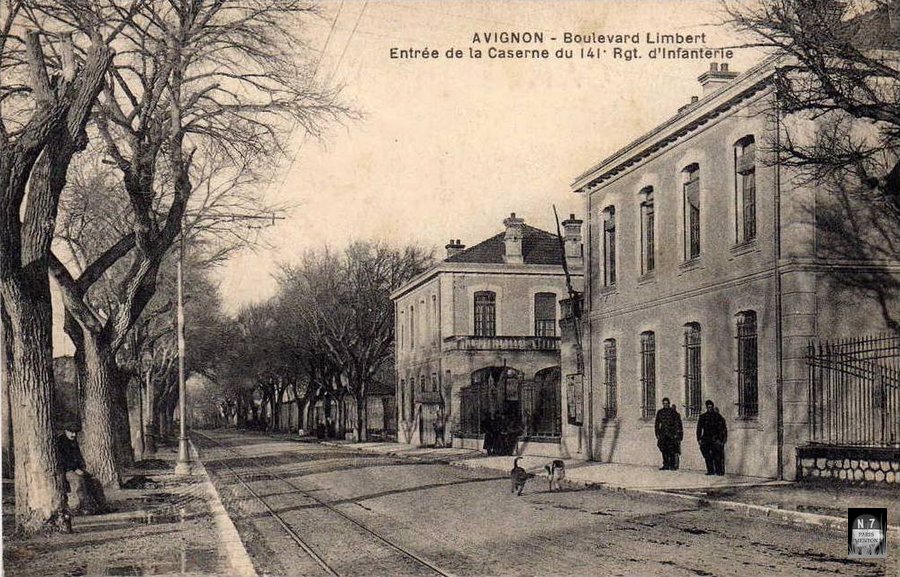

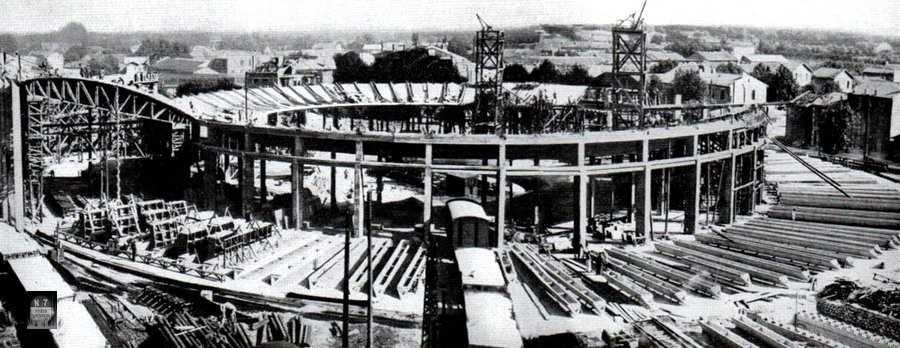
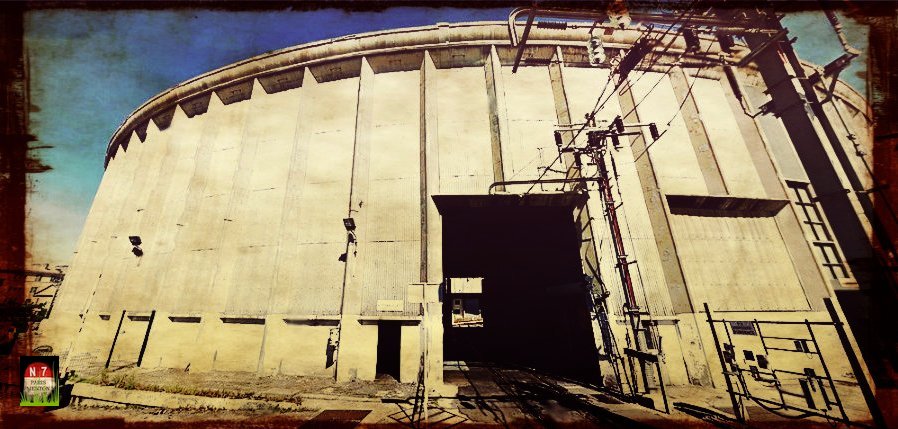






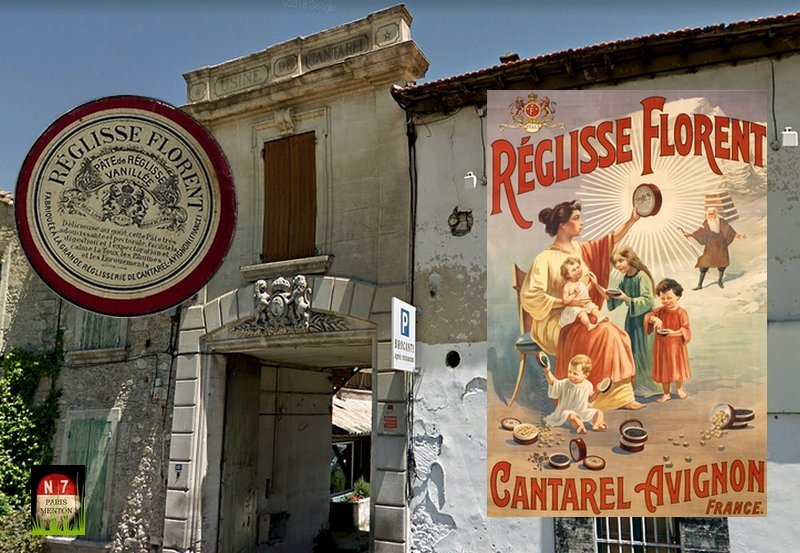

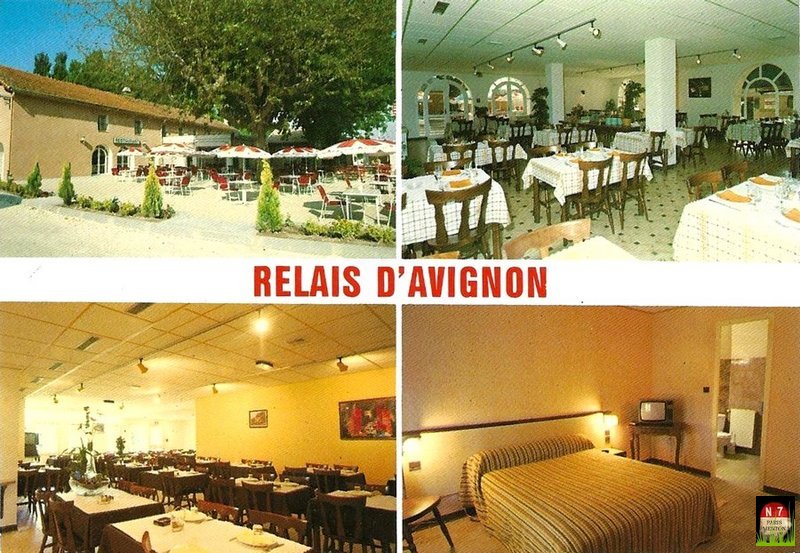







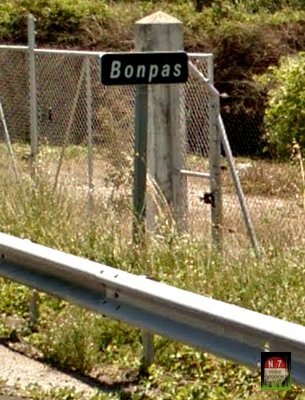
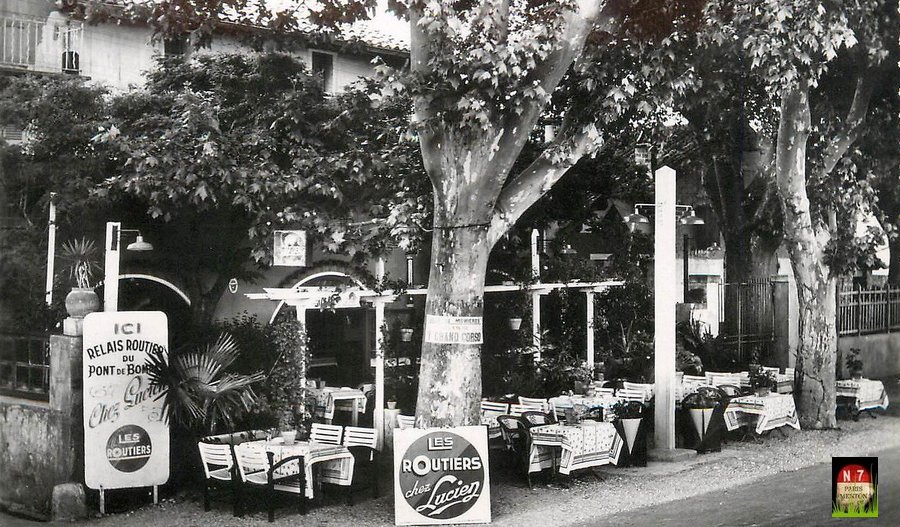 .
.