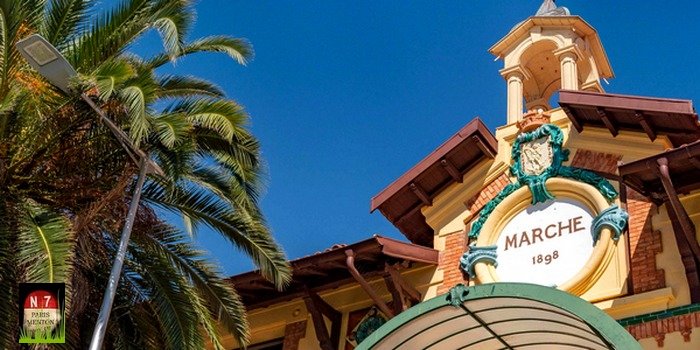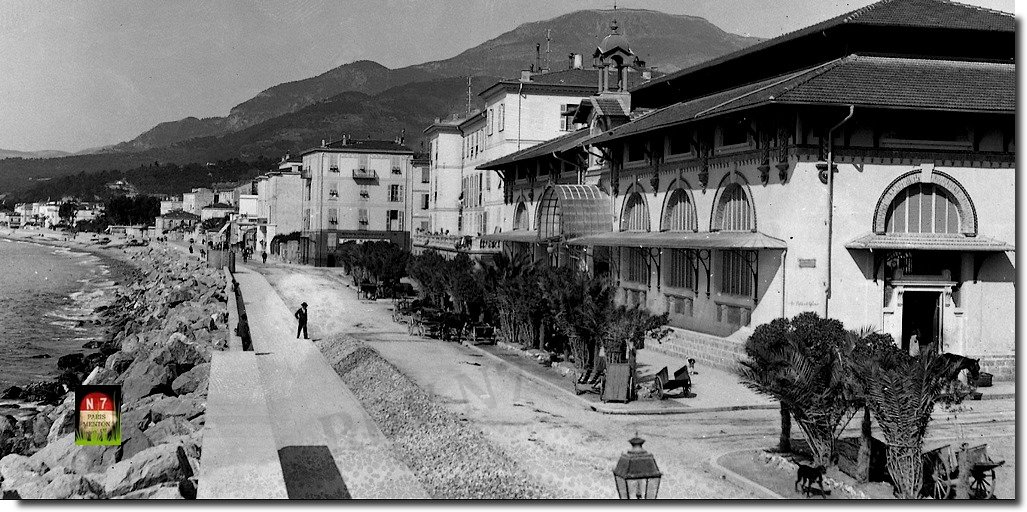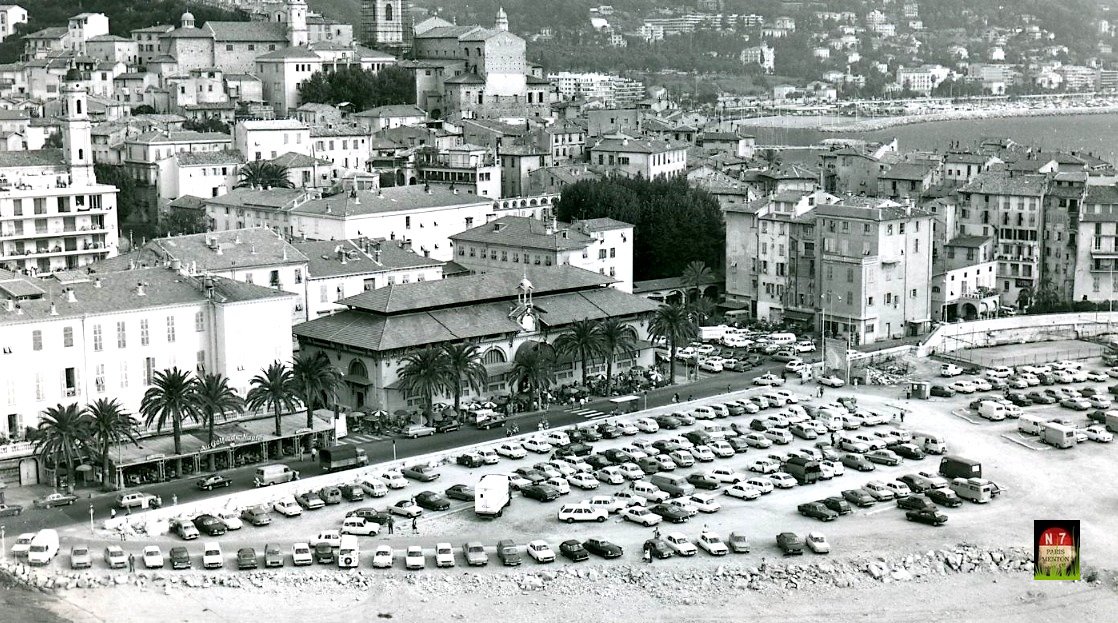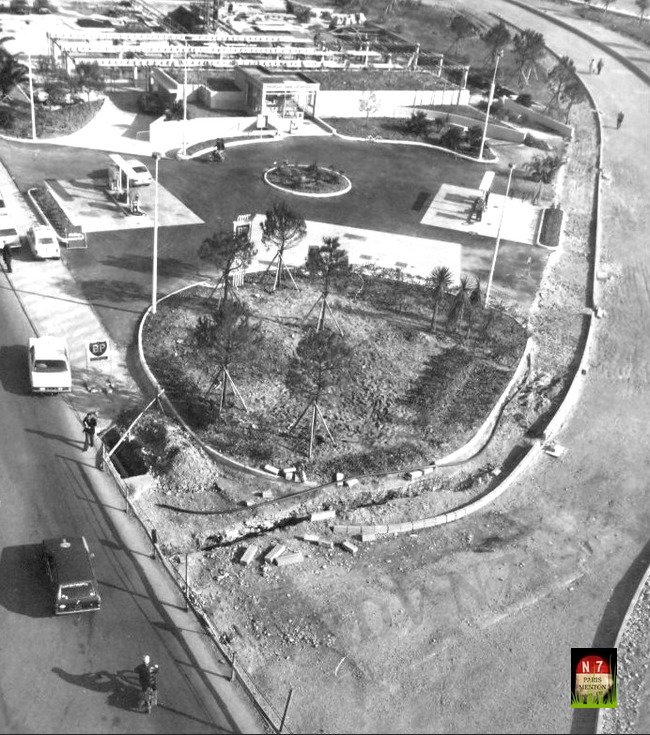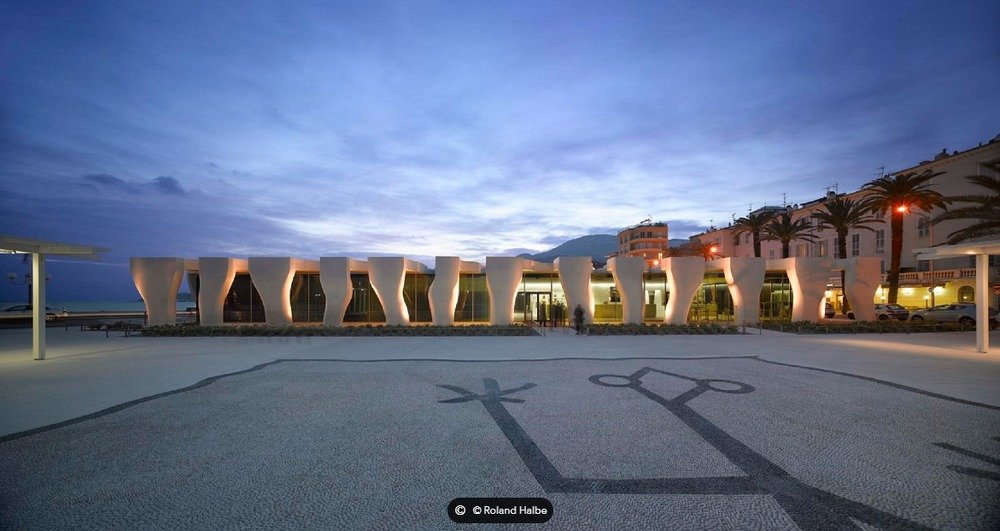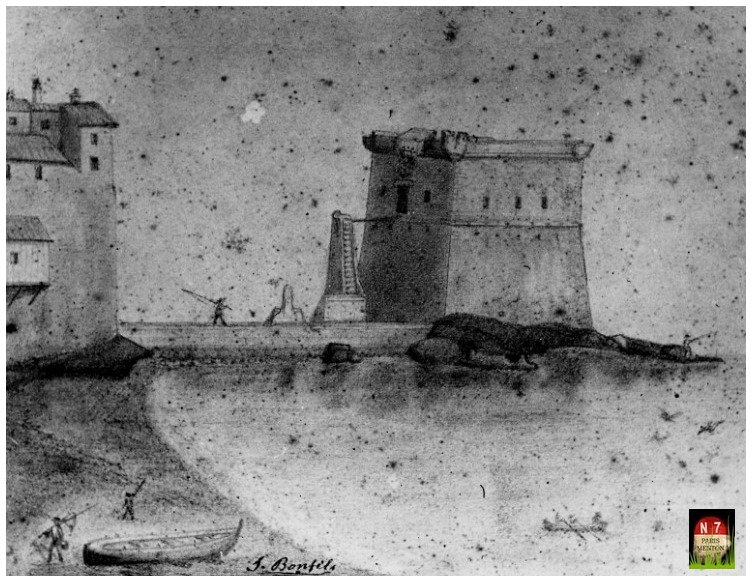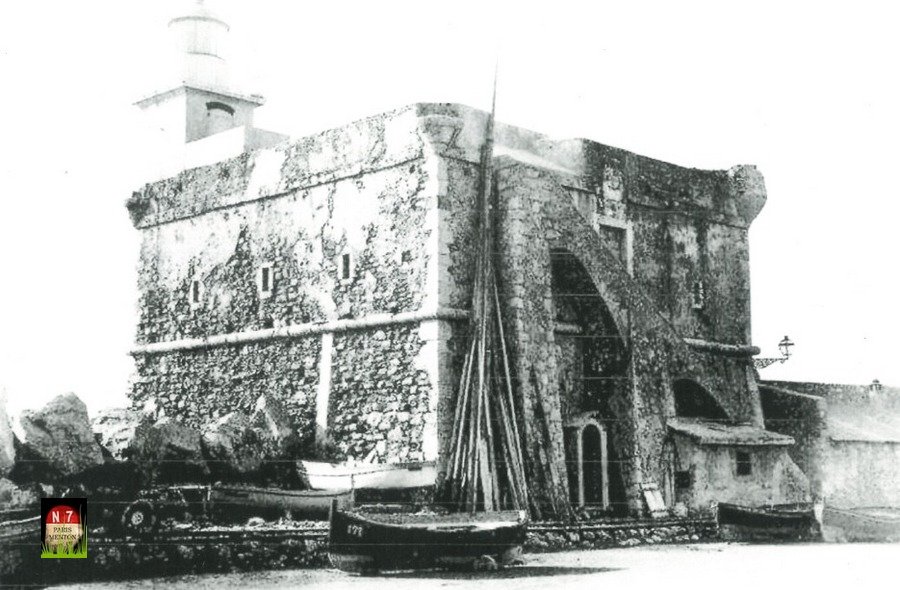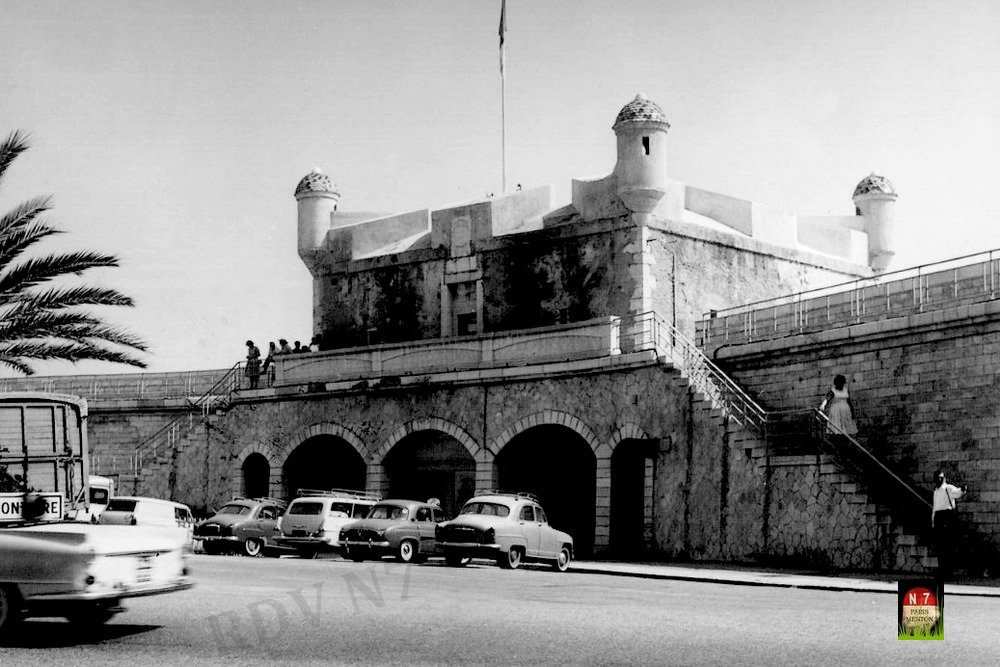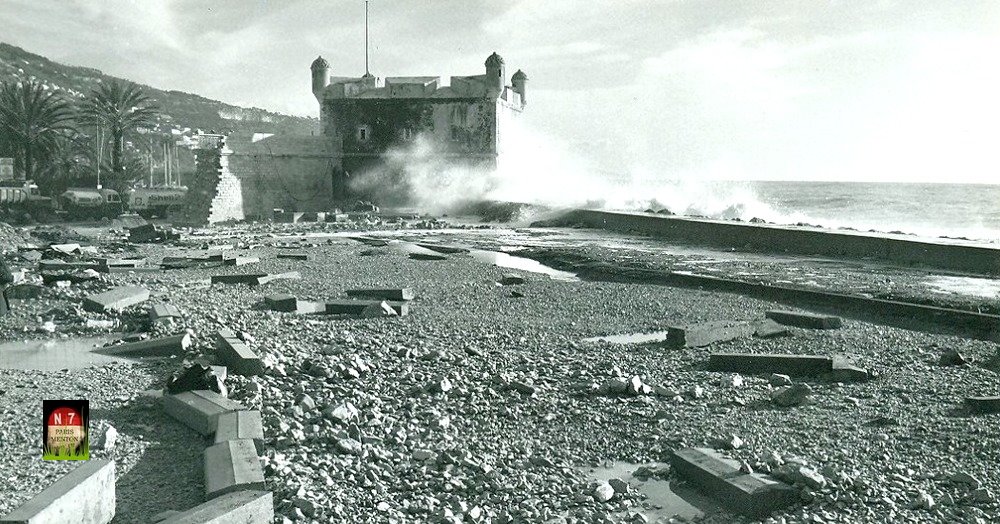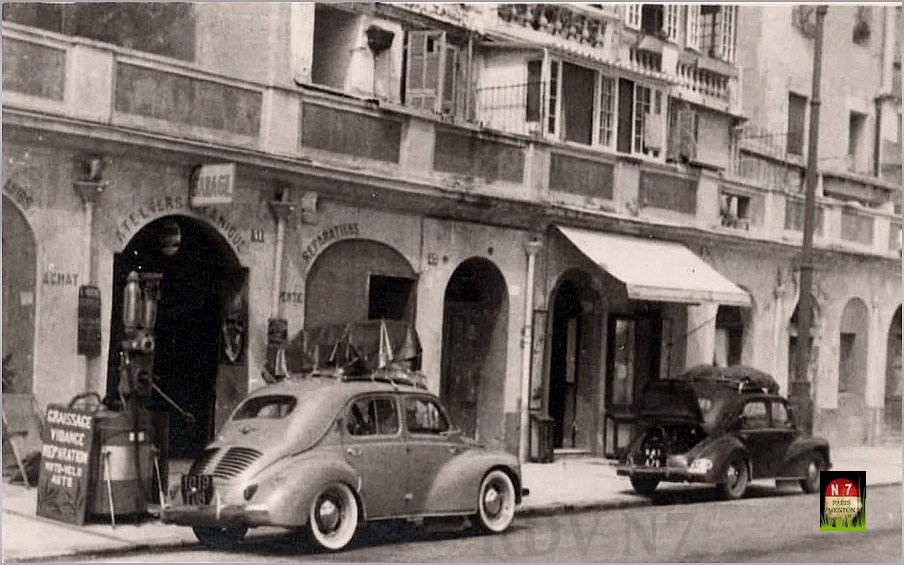|
Quai Monléon :
Le quai Monléon - en sens interdit dans notre sens
de circulation - est intéressant à plus d'un titre.
Tout d'abord, il s'agit du tracé historique de notre RN7. Bien
avant l’extension de la ville sur la mer, des travaux de construction
de l'esplanade Francis Palmero et de la réhabilitation du Bastion.
Ensuite, à défaut de ne plus longer la mer
comme auparavant, le quai longe toujours le vieux Menton, l'occasion
de découvrir des ruelles étroites, des placettes ombragées,
des constructions aux couleurs typiquement méridionales.
Ce quai dont la construction se termine en 1891, permetait de relier
le vieux port de pêche à la Promenade du Soleil.

Vue du quai Monléon en 1950. Le secteur n'a pas encore subi
les grands travaux des années 70.
En route -
A l'entrée du quai, sur la gauche, un bâtiment
au ton rosé surplombe la route de toute sa longueur. Il s'agit
de l' Hôtel particulier dit "Palais Trenca de Monléon",
construit en 1780.
Les Monléon sont une famille d'origine italienne, établie
à Menton au début du 15e siècle où ils font
une carrière militaire auprès des princes de Monaco.
Charles Trenca est le chef du gouvernement des Villes libres de Menton
et Roquebrune lorsque celles-ci font sécession en 1848.
La Mairie de Menton occupa le Palais Trenca de 1882 à
1902.

Le 23 février 1887, tout le quartier situé
le long du bord de mer, fut terriblement éprouvé par un
tremblement de terre alors sans précédent qui toucha toute
la Côte d'Azur.
La ville de Menton fut la plus endommagée. Le Palais Trenca fut
lourdement affecté par les secousses sismiques.
Aujourd'hui le palais, dont l'entrée et la façade
se situent côté place Clémenceau, est devenu un
immeuble d'habitations.
Pour tout savoir sur le tremblement de terre de 1887
: https://www.azurseisme.com/Effets-sur-Menton.html
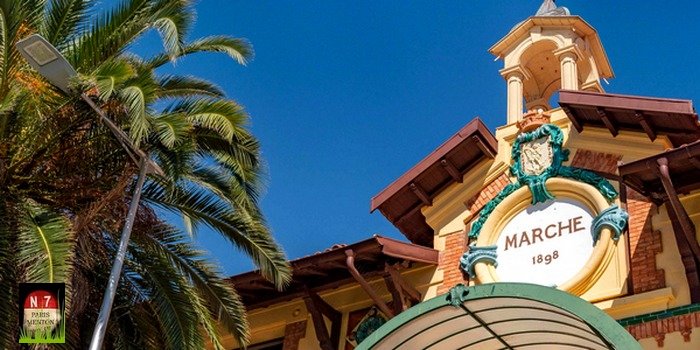
Après le Palais Tranca-Monléon, un autre
bâtiment bien plus remarquable, la Halle au marché. 
En 1882, le maire de Menton, Emile Biovès, décide de
créer un marché couvert. Le projet est réalisé
par l’architecte mentonnais Adrien Rey (1865-1959). Il est achevé
en 1898.
Le bâtiment devait répondre à deux conditions
principales requises pour un bon fonctionnement du marché :
le besoin d’une très large ventilation combinée
à la nécessité de créer le plus d’ombre
possible.
Une bonne protection solaire est établie sur toute la façade
et forme un porche protégé jusqu’à l’entrée
principale.
L’architecte n’a pas oublié l’esthétique.
Le bâtiment est animé par une grande diversité
de matériaux et de couleurs : sol en pierre, plâtre,
brique, bois, décors en céramique de la fabrique Mentonnaise
Saïssi.
Source et extraits : https://cityxee.com/fr/marche-couvert-a-menton/
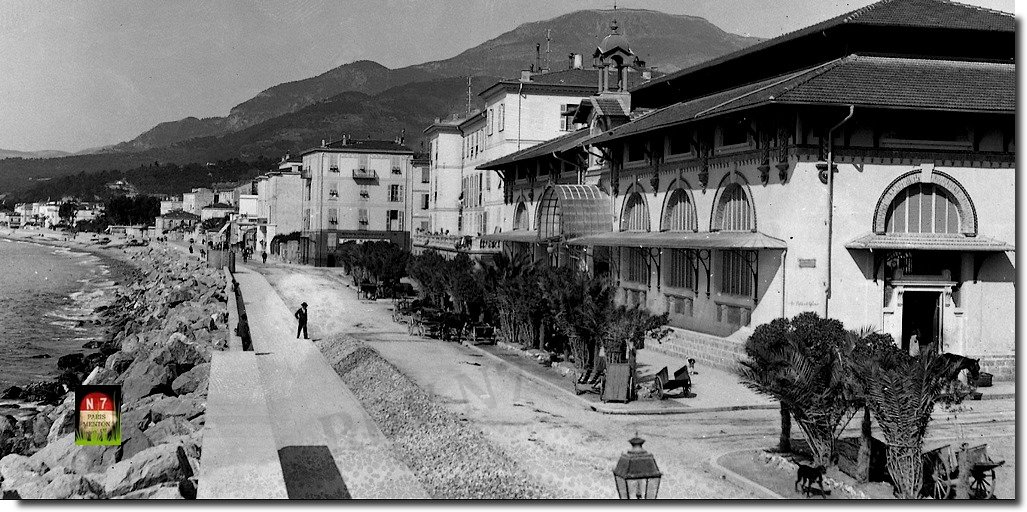
Le quai Monléon fin du XIXe siècle.
Au premier plan, la halle au marché nouvellement construite,
puis le palais Tranca Monléon.

La Halle, jour de marché, en pleine activité. Image
réactive même lieu aujourd'hui.
Arrivée en bout de quai, la route va contourner
le faubourg du Cap, un ancien quartier de pêcheurs, groupé
autour de la chapelle Saint-Sébastien.
La vieille ville a un petit air de dolce vita. Pourquoi ne pas aller
s'y perdre, au gré des ruelles étroites, des escaliers
et des placettes ombragées, bordées de façades
aux ocres lumineux ?

Le quai Monléon / RN7 passe au pied de la vieille ville,
dans les deux sens de circulation.
A gauche, les remparts du bord de mer. Même lieu aujourd'hui,
image réactive.
L'esplanade.
Jusqu'aux années 50, le quai longe le bord de mer.
Au début des années 60, la ville gagne un peu de terrain
sur la mer, terrain vite transformé en un vaste parking urbain,
très pratique à l'époque pour se garer à
proximité du marché ou pour partir explorer la vieille
ville.
Mais les grands travaux débuterons réellement au milieu
des années 70.

Dès le début des années 60 on gagne du terrain
sur la mer.
L'esplanade prend forme. Le quai Monléon (à gauche) se
retrouve séparé de la berge par un vaste terre-plein.
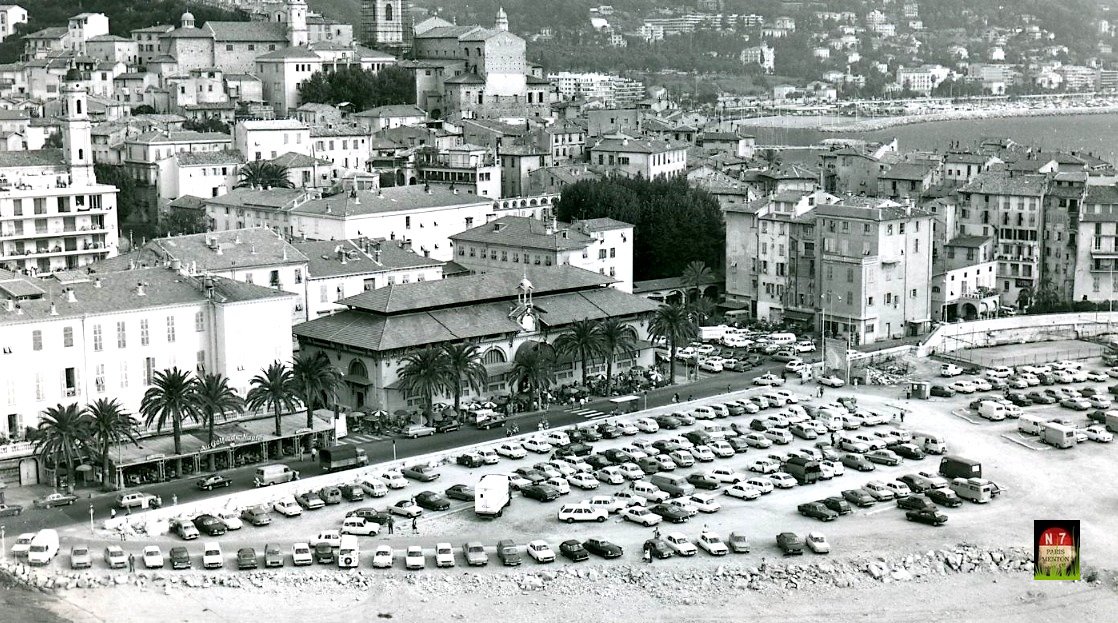
A partir des années 60, la ville s'étend sur la mer.
La halle au marché, n'est désormais plus en bordure de
mer, et l'automobile y gagne un vaste parking urbain.
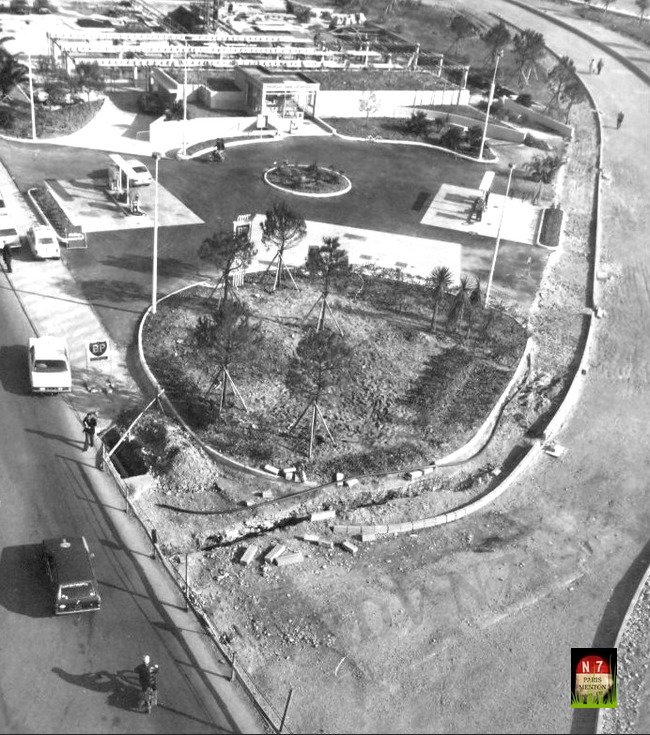
En 1974, le parking devient une esplanade, une route de contournement
est créée afin d'éviter le quai Monléon.
Au centre de l'esplanade, apparaît une station BP.

La station BP de l'esplanade en 1975. Au fond on aperçoit le
Bastion.

Un sens giratoire est instauré autour de l'esplanade.

En 1977, les travaux sont terminés

Face au quai Monléon en sens interdit, sens giratoire oblige,
contournons par la droite.
En route -
Aujourd'hui, le centre de l'esplanade est occupé
depuis 2011 par un bâtiment aux lignes modernes, en lieu et place
de l'ancienne station BP.
Il s'agit du Musée d'Art moderne Jean Cocteau - Collection Séverin
Wunderman, abritant des œuvres de Jean Cocteau sur différents
supports.
En octobre 2018, des vagues de 7 mètres, provoquées
par la tempête Adrian, inondent et endommagent plusieurs œuvres
du musée.
Comme quoi l'écrin moderne n'était pas si protecteur.
Depuis, le musée semble définitivement fermé.
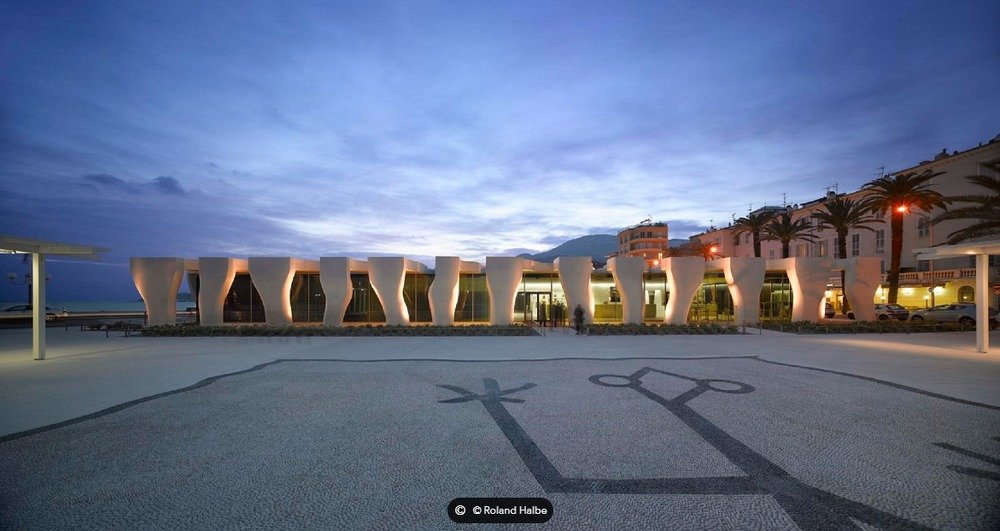
Le bâtiment n'a pas résisté aux assauts de la
tempête Adrian en 2018. Il prend l'eau de toute part et semble
définitivement fermé.
2011-2018, un bâtiment digne de l'émission TV " Combien
ça coûte, ou l'argent du contribuable jeté par la
fenêtre"
Le Bastion.
200 mètres plus loin, voila une construction qui
a traversé les âges, bien plus solide que l'ex musée
d'Art Moderne : le Bastion. 

Le petit fort, dit le bastion, se trouve à la pointe
de la vieille ville entre les deux baies de Menton. Il est construit
sur la volonté du prince de Monaco, Honoré II.
L’ordonnance de 1618 stipule :
« Moi, prince Honoré II désire
que, sur le roc isolé, marquant la pointe de l’éperon
portant la ville fortifiée de Menton,
soit édifié un bastion qui avance dans la mer et devienne
la tête de la dite cité pour la défendre des flottes
ennemies ».
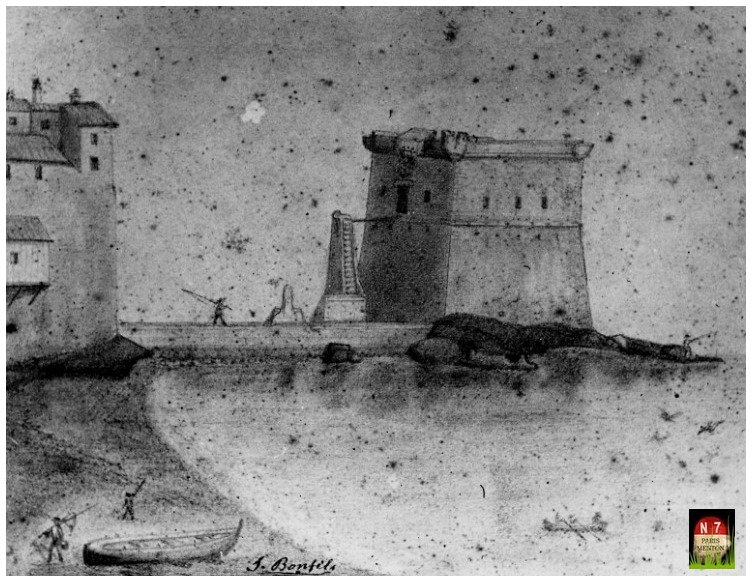
Le bastion défense
Le fort est alors isolé sur un îlot. On y
accède par un passerelle mobile en bois.
L’emplacement des poulies de ce pont-levis est encore visible
au-dessus de l’ouverture du premier niveau.
Il possède deux niveaux : un rez-de-chaussée et un premier
étage servant de magasin de poudre.
La plateforme, à onze mètres au-dessus de la mer, est
constituée d’échauguettes percées de meurtrières.
Quatre canons sont placés aux angles du fort. En plus de leurs
rôles défensifs, ils participent aux saluts des fêtes
religieuses.
Une petite garnison en assure la garde et le service.
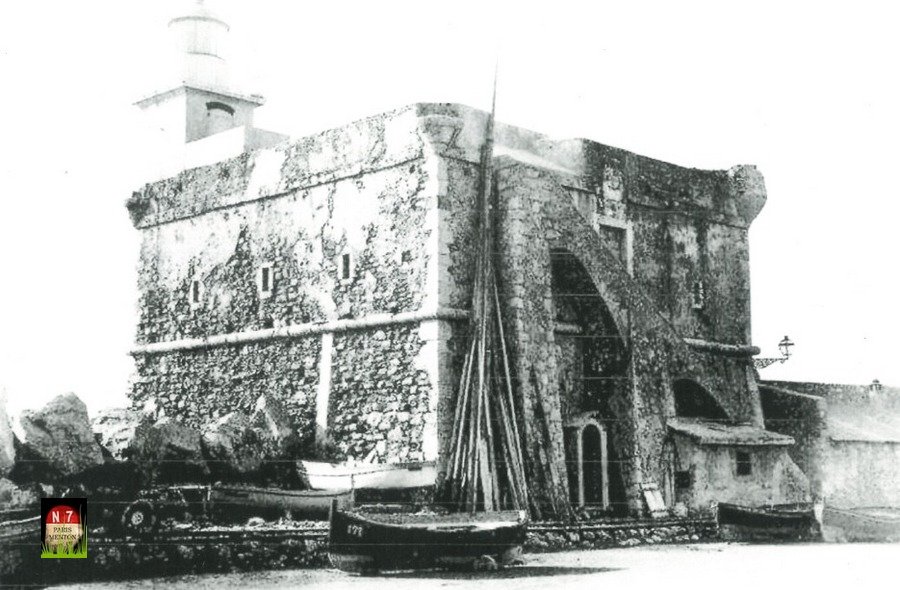
Le bastion phare.
Sous le Premier Empire, au début du XIXe siècle,
un pont-levis est installé en remplacement de la passerelle.
Le bastion fait office de prison durant la révolution de 1848.
Il est désarmé le 2 septembre 1860 et est aménagé
pour servir d’entrepôt de matériel, de grenier à
sel, ou de prison.
Avec les travaux d’aménagement du port (de 1869 à
1890), le bastion sert momentanément de support pour l’édification
d’un phare à feu fixe qui sera déplacé en
fin de travaux au bout de la jetée.
Le fortin n’est plus une forteresse isolée sur les rochers.
Après avoir fait l’objet de nombreuses locations, il est
abandonné en 1914.
Mais il devient à nouveau un bâtiment militaire lors de
la Seconde Guerre mondiale, les Allemands le transformant en blockhaus.
A la fin de la guerre, il est en ruines et délaissé pendant
de nombreuses années.
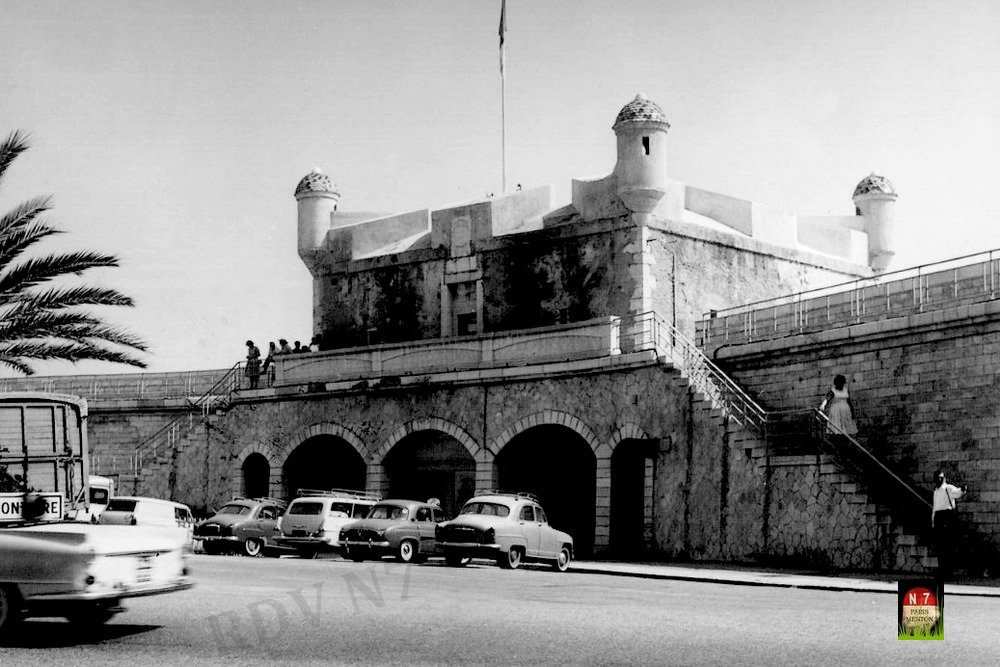
Le bastion musée.
(à gauche, en partie caché par la voiture, on distingue
le panneau Frontière... la fin de notre périple est proche)
Le maire de Menton, Francis Palmero, rencontre Jean Cocteau
au Festival de musique en 1955.
Dès le mois de septembre, il lui demande de décorer la
salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
En 1957, il propose à l’artiste d’installer son musée
dans le bastion.
« A Menton, le maire, Monsieur Palmero, m’offre,
en échange de la salle des mariages que j’ai décorée,
un bastion au bout de la digue, où je pourrais mettre mes œuvres
comme Picasso dans le musée d’Antibes » écrit
Cocteau.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la valorisation
territoriale où de nombreux monuments anciens sont réhabilités.
Il est décidé, par un arrêté du 9 septembre
1959, que le bâtiment, propriété de l’Administration
de Domaine, peut être occupé pendant trente ans par la
ville de Menton pour y faire une salle d’exposition.
Une des conditions est la remise en état du fortin en accord
avec les services des Monuments Historiques et le paiement d’un
loyer. Le bastion sera finalement concédé à la
ville en 1960.
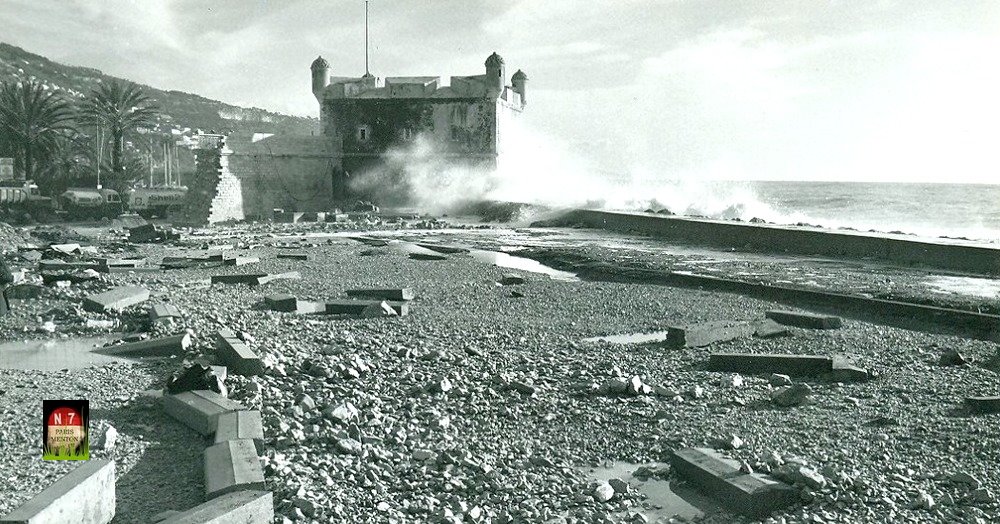
Coup de mer sur le bastion en 1977, lors de la finalisation des
travaux de l'esplanade.
La RN7 (à gauche) reçoit les embruns. Ça va faire
rouiller les bagnoles :-)
Les travaux pour l’aménagement du musée
commencent dès 1959. Il s’agit d’abord de faire restaurer
l’extérieur (les quatre échauguettes et le couronnement)
puis l’intérieur par des sociétés spécialisées
au vu de sa valeur patrimoniale.
La restauration prend en compte les détails composant les lieux
tels que le four qui devient un dispositif d’exposition, l’objectif
étant de conserver l’aspect de fortin au bâtiment.
Sur les plans, Cocteau envisage les salles d’exposition. Il entreprend
sur place des décorations notamment les fameuses calades (mosaïques
de galets).
Le bois est privilégié pour rappeler le plancher d’un
bateau car le lieu a les pieds dans l’eau.
Jusqu’au bout, le poète porte le projet malgré
ses problèmes de santé.
Il disparaît en 1963. Dès 1964, son fils adoptif, Edouard
Dermit poursuit les travaux selon ses vœux.
Le musée est inauguré le 30 avril 1966 en présence
de Francis Palmero, de Son Altesse la Bégum, d’Yvonne Labrousse,
Francine Weisweiller, Edouard Dermit …
Après six ans de travaux, Menton possède le premier Musée
Jean Cocteau au monde.
Source et extraits: https://www.menton.fr/Le-Bastion-retrouve-sa-gloire-d-antan.html

Après le Quai Monléon et le bastion, direction plein
nord par le Quai Bonaparte. (tracé bleu)
Le tracé rouge correspond à la traversée historique
de Menton bien avant la construction des quais.
En route -
Au rond-point, laissons le Bastion derrière nous et empruntons
le Quai Bonaparte. 
Coincé entre le rivage et la vieille ville, ce boulevard du littoral
longe le vieux port et la plage des sablettes.
Aujourd'hui le vieux port est l'un des deux ports de plaisance de Menton
dans la baie de Garavan.
Mais remontons le temps.
Jusqu'au XIXe siècle, la traversée de la ville s'effectue
en partie en suivant l'antique voie romaine, seule voie menant vers
l’Italie, la Via Aurélia, devenue Via Julia Augusta au
premier siècle de notre ère.
Dans la vieille ville, c'est la Rue Longue, rue principale, étroite
et sinueuse, bordée d’échoppes, de tavernes et de
relais muletiers. (Tracé rouge sur la carte ci-dessus)
La voie romaine demeure l’axe de circulation de la ville ancienne
pendant toute la période médiévale, elle est fermée
par deux portes : la porte Saint-Antoine, côté France et
la porte Saint-Julien, côté Italie.
Au début du XVIII ème siècle, avec l’accroissement
de la population, Menton se tourne vers une économie moderne
fondée sur l’agrumiculture, l’oléiculture,
le commerce et le cabotage.
La rue Longue ne permet plus d’assurer le transit entre la France
et l’Italie : il faut désormais s’adapter à
l’évolution des transports et notamment aux activités
commerciales liées à la mer.
A cette époque, pas de quai, le pied des maisons en bordure de
mer donnait directement sur la grève ou reposait sur les rochers.
Tout le trafic pour l’Italie passait donc par l"étroite
rue Longue.
Après un décret de Bonaparte en 1808, pour des raisons
stratégiques et économiques, on décide de construire
un quai entre la mer et le rocher, afin de délester la rue Longue.
Il est construit sous l’Empire par Napoléon Bonaparte.
Il sera terminé sous le Second Empire.
Cet aménagement va radicalement modifier la perception de la
ville, les murs arrières des immeubles de la Rue Longue devenant
les façades donnant sur le quai.
En 1811.le quai Bonaparte a une largeur de 7 mètres et rejoint
la rue Saint-Michel.
En 1858, un rez-de-chaussée à arcades est édifié
devant le soubassement de rochers supportant les façades du quai
Bonaparte. Des boutiques y sont implantées.

Peut-être la plus ancienne photographie de Menton vers 1870.
Le quai Bonaparte est construit ainsi que le soubassement à arcades.
L'arrière des immeubles, qui avant la construction du quai donnait
directement sur la grève ou sur des rochers, se retrouve maintenant
bordé par la Route Impériale.
En 1902, le quai est élargi à 2 x 1 voie.
Pour cela, la voie ajoutée est supportée par une série
de 16 arches côté mer.
Depuis 1963, sept nouvelles arches complètent l’ensemble.

Après 1902, des arches permettent l'élargissement
du quai.
Et bien, maintenant que nous connaissons un peu mieux
l'histoire du quai Bonaparte, allons voir à quoi il ressemble
aujourd'hui.

Le Quai Bonaparte aujourd'hui.
En route -
Le quai, dans sa première partie arboré
de palmiers, est bordé côté mer d'un large trottoir
avec vue plongeante sur la plage des Sablettes en contrebas et la magnifique
baie de Garavan.
D'ici, si vous avez une bonne vue, ou des jumelles, on aperçoit
la frontière, but ultime de notre périple de 1000 Km.

Côté vieille ville, des restaurants, des
cafés, des glaciers et quelques boutiques occupent les fameuses
arcades de 1858, le plus souvent masquées par les auvents des
terrasses.

Les années 60. Quai Bonaparte et ses commerces entièrement
dédiés aux plaisirs de la plage.
Même lieu aujourd'hui, avec des commerces principalement basés
sur la restauration. Image réactive.

Les fameuses arcades, véritable soubassement de la vieille
ville, qui ont permis l'élaboration du quai.
Ici, avant 1858, les rochers sur lesquels se juchaient les immeubles,
étaient balayés par les flots.

Ici au n°11, ambiance estivale, sans chichis sous les arcades. Collection
Nathalie Rateau - Lagarde.
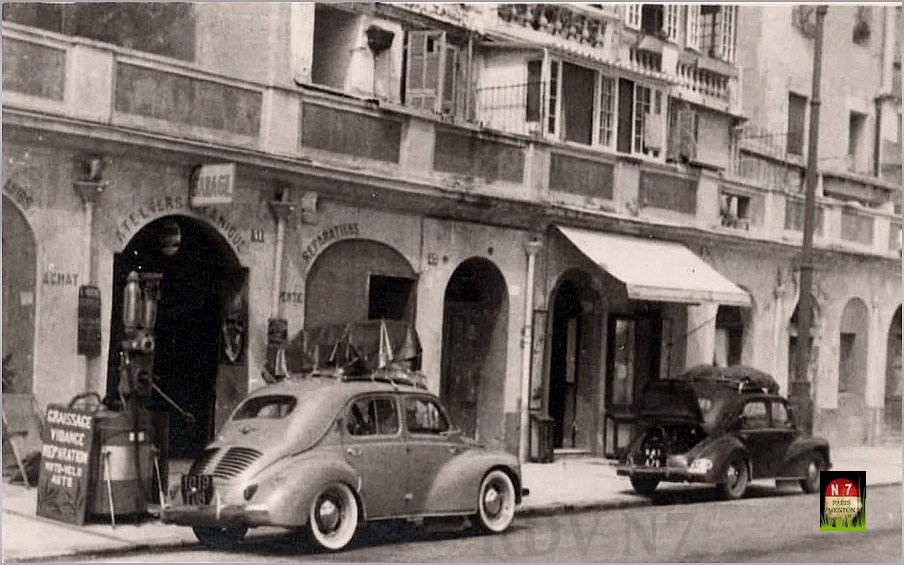
Là, au n° 41, le Garage Bonaparte, occupait 2 ou 3 arcades.

La plage des Sablettes, son parking, ses palmiers.


En 1902, 16 voûtes de soutènement permettent d'élargir
le quai qui devient à double voie de circulation.
|